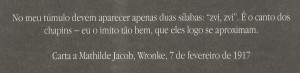La gauche contre elle-même
LE MONDE | 10.05.2014 à 09h20 • Mis à jour le 13.05.2014 à 15h52 | Par Didier Eribon (Professeur de philosophie, sciences humaines et sociales de l’université d’Amiens.)
Il n’est pas très original, j’en ai conscience, de s’inquiéter de l’état dans lequel se trouvent aujourd’hui la gauche et la pensée de gauche, pour autant qu’il soit possible de distinguer ces deux registres. Mais dans la mesure où la gauche politique semble s’enfoncer dans les abîmes d’un désastre qui s’annonce historique, on peut comprendre que ceux qui croient encore aux vertus d’une démarche de transformation sociale cherchent à rattacher le peu d’espoir qui leur reste à tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une contribution progressiste à la réflexion théorique.
La tentation est grande, dans un tel contexte, de prendre pour d’extraordinaires avancées progressistes ce que, en d’autres temps, on aurait considéré comme des concessions destinées à sauver le système, et même d’aller jusqu’à sentir un souffle « révolutionnaire » dans ce qu’il conviendrait d’interpréter comme un aboutissement et un réaménagement de ce qu’a produit la « révolution conservatrice » depuis le début des années 1980.
LES CÉNACLES IDÉOLOGIQUES
Je pense, par exemple, au livre de l’économiste Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle (Seuil, 2013), qui ne peut apparaître comme un livre de gauche que parce que les cénacles idéologiques dont il est proche se sont acharnés à démolir au préalable tout ce qui faisait que la gauche était la gauche. Il suffirait pour s’en convaincre de constater que ceux qui l’applaudissent dans les journaux français sont les mêmes qui insultaient hier Pierre Bourdieu lorsqu’il dénonçait les ravages répandus par le néolibéralisme.
On ne s’en étonnera pas : le livre de Piketty paraît en France dans une collection dirigée par Pierre Rosanvallon, l’ancien animateur de la Fondation Saint-Simon, qui entendait réunir de manière durable des universitaires, des journalistes, des responsables politiques et des grands patrons avec pour objectif d’organiser le basculement du champ intellectuel de la gauche vers la droite, de Marx vers Tocqueville ou, plus exactement, de Sartre, Foucault et Bourdieu vers Raymond Aron.
Le regard porté sur le monde social par Piketty participe de cette problématique aronienne de l’individualisation construite contre l’idée même de classes sociales, contre l’idée de déterminismes sociaux et de reproduction et, par conséquent, contre toute approche en termes d’exploitation et de luttes, de domination et de conflictualité. C’est la démarche qui sous-tend tout son livre : ce qui définit la « modernité démocratique », répète-t-il, c’est que les inégalités sociales sont justes et justifiées si elles sont fondées sur le travail et le mérite individuels.
Son ouvrage constitue ainsi le deuxième temps de l’entreprise de destruction de la pensée de gauche : pour que le capitalisme soit acceptable et que les inégalités soient acceptées, il est nécessaire de limiter – par l’impôt – celles qui deviennent chaque jour un peu plus scandaleuses et un peu moins justifiables. La critique du « capital » et quelques mesures fiscales interviennent ici pour sauver le paradigme où l’on pense le monde social sans les classes et les antagonismes de classes.
SOUTENIR DES POLITIQUES DE REDISTRIBUTION
D’entrée de jeu, il nous avertit que le problème central n’est pas l’ampleur des inégalités, mais ce sur quoi elles s’appuient. Ceux qui possèdent des fortunes colossales les doivent non à leurs mérites, mais à l’accumulation du patrimoine et à sa transmission par l’héritage. D’où l’idée qu’il faut instaurer un impôt progressif sur le capital afin de soutenir des politiques de redistribution.
Qui pourrait être contre de telles mesures ? Et l’on est saisi de stupeur en voyant les gouvernements de gauche – en France notamment – les refuser. Au fond, si le livre de Thomas Piketty est reçu comme un livre de gauche, c’est parce que la gauche au pouvoir est encore moins à gauche que lui.
L’accueil réservé à la traduction anglaise de ce livre par quelques personnalités de l’establishment universitaire américain et le succès international qu’elles lui ont ainsi assuré devraient inciter ses lecteurs à une très grande prudence. Il faut vraiment que ces économistes titrés et nantis évoluent dans un monde coupé des réalités pour pouvoir s’émerveiller qu’un livre vienne, en 2014, leur révéler que le capitalisme est un système dans lequel la richesse produite par la société ne bénéficie pas à tous, mais seulement à une infime minorité. Et leur permettre d’en tirer l’étonnante conclusion que cela prouve que le capitalisme, « ça ne marche pas »…
On pourrait soutenir au contraire que cela prouve que « ça marche », et depuis longtemps, puisque c’est ce qui le définit. Si mes souvenirs d’étudiant ne me trompent pas, un livre intitulé Le Capital (au XIXe siècle) l’avait bien établi.
Dans un article paru dans la New York Review of Books, Paul Krugman opère un déplacement édifiant. Il oriente avant tout l’analyse sur la concentration du capital dans les mains de quelques-uns et non plus sur les inégalités de revenus entre les différentes couches de salariés, comme on le faisait jusqu’ici. Il y aurait d’un côté les (très) riches et de l’autre le reste de la population qui gagne sa vie en travaillant, et les écarts au sein de cette population seraient, dans un tel cadre, relativement secondaires. En ce sens, Paul Krugman ne trahit pas le livre qu’il promeut, et c’est même la raison pour laquelle il affirme le trouver si novateur.
LE MYTHE DE L’IDÉOLOGIE MÉRITOCRATIQUE
La discussion critique que mène l’économiste américain ne se situe pas dans un espace de gauche : ses adversaires sont les économistes de l’école de Chicago, les tenants d’un libéralisme pur et dur, les éditorialistes de la droite américaine… Et, contre eux, il dit et redit que le livre de Thomas Piketty démontre que ceux qui possèdent des fortunes colossales ne les doivent pas à leur travail ou à leur mérite personnels, mais au patrimoine constitué et hérité. Et il peut donc lire l’ouvrage de Piketty comme un démontage en règle de l’idéologie méritocratique, qui sert de mythe fondateur à la société américaine ou en tout cas à ses classes dominantes.
Mais soit il se trompe grossièrement, soit il nous leurre. Car Thomas Piketty ne cesse de promouvoir l’idéologie méritocratique. Simplement, il la situe à l’étage du dessous. On pensera plutôt que la vision méritocratique et inégalitaire de Paul Krugman se trouve confortée par celle que lui offre Thomas Piketty : le mérite ne se situe pas chez ceux dont la richesse est indécente, mais dans les autres strates de la société, où les inégalités de salaire, si amples soient-elles, se voient ainsi légitimées.
Au point qu’on peut se demander comment il est possible que personne, à ma connaissance, n’ait soulevé aux Etats-Unis une question aussi cruciale que douloureuse : en insistant sur le mérite personnel comme fondement juste des inégalités, on renvoie à leur responsabilité individuelle, à leur manque de talent ou de compétence tous ceux qui ne réussiront pas à sortir de la pauvreté. Et comme il est fort probable que cela concernera au tout premier chef les habitants des ghettos noirs des grandes villes, nous nous trouvons finalement devant une idéologie qui n’est pas très éloignée de celle de l’infériorité raciale.
Cela doit nous conduire à interroger les slogans d’un mouvement comme « Occupy Wall Street ». Si intéressant qu’ait pu être ce mouvement, et si prometteur d’un regain des mobilisations contre la violence économique et sociale exercée par le pouvoir de la finance internationale, il faut bien admettre que sa manière d’opposer le 1 % représentant la fraction la plus riche d’une nation aux 99 % qui représenteraient le « peuple » assemblé revient à effacer les différences considérables à l’intérieur d’un groupe si vaste. C’est comme si la hiérarchie entre les classes disparaissait dans le geste de la révolte contre quelques profiteurs et spoliateurs. Mais non !
PERPÉTUATION DES INÉGALITÉS SOCIALES
Ce « peuple » n’est pas un ensemble homogène, dans lequel régneraient simplement des différences secondaires (et méritées) de statuts ou de salaires. Or l’analyse focalisée sur les inégalités les plus obscènes tend à installer pour le reste du monde social un continuum entre les niveaux de revenus, séparés par des « déciles » ou des « centiles », et dans lequel les écarts seraient pleinement justifiés. Cette idéologie du mérite et du talent (attestés et ratifiés par les titres scolaires) est pourtant l’un des vecteurs les plus puissants de la légitimation et de la perpétuation des inégalités sociales.
En réduisant la notion de « capital » au seul capital économique, Thomas Piketty néglige délibérément – c’est inscrit dans sa perspective d’ensemble – le rôle majeur du capital culturel et du capital social comme formes décisives de l’héritage : l’implacable logique de la distribution différentielle des possibilités d’accès à ce qu’il estime fondé sur le mérite (les écoles d’élite, les professions les mieux rémunérées…)
Il n’est pas très difficile d’analyser comment, en défaisant toute perception du monde en termes d’appartenance à une classe sociale, mobilisée ou potentiellement mobilisable par le moyen des luttes ou par celui du vote pour un parti de gauche, on s’exposait à ce qui allait fatalement se produire : la reconstitution de ce groupe par le moyen du vote pour un parti d’extrême droite.
Paul Krugman et son collègue Joseph Stiglitz promettent à Thomas Piketty le prix Nobel (décerné par la Banque de Suède). Cette médaille risque pourtant d’avoir un revers bien sombre : la montée du Front national en France et des partis fascistes en Europe.
- Didier Eribon (Professeur de philosophie, sciences humaines et sociales de l’université d’Amiens.)