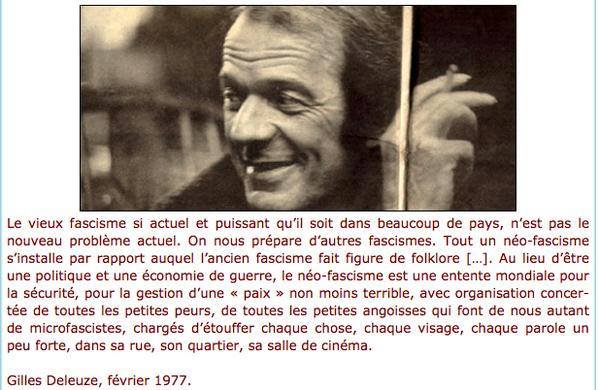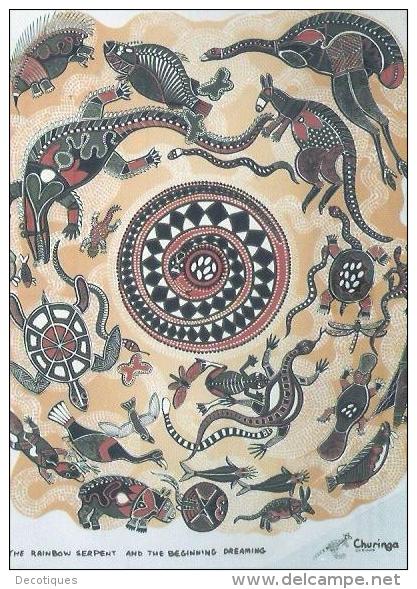Hakim BEY: Religion et Révolution
vendredi, juin 9th, 2017Religion et Révolution
par Hakim Bey
source: http://endehors.net/news/religion-et-revolution-par-hakim-bey
Lu sur Hermesia :
L’argent et la religion hiérarchisée semblent être apparus au même moment mystérieux quelque part entre le début du Néolithique et le troisième millénaire avant J.C. à Sumer ou en Egypte. Mais qui est apparu en premier de la poule ou de l’œuf ? L’un n’est-il que la réponse de l’autre ou bien l’un n’est-il qu’un aspect de l’autre ?
Il n’y a aucun doute que l’argent possède une profonde connotation religieuse car, depuis le tout début de son apparition, il tend à prétendre à la condition spirituelle — se retirant lui-même du monde des formes matérielles –, à transcender la matérialité, à devenir le seul véritable symbole efficace. Avec l’invention de l’écriture aux environs de 3100 avant J.C., l’argent comme nous le connaissons émerge d’un système de jetons d’argile représentants des biens matériels et prend la forme de lettres de crédit inscrites sur des tablettes d’argile ; presque sans exception, ces « chèques » semblent être liés à des dettes détenues par le Temple d’Etat et en théorie pourraient avoir été utilisés dans un vaste système d’échange de notes de crédit « frappées » par la théocratie. Les pièces n’apparaissent pas avant environ 700 avant J.C. en Asie Mineure Hellénique ; elles étaient faites d’électrum (mélange d’or et d’argent) non du fait que ces métaux avaient une valeur marchande mais parce qu’ils étaient sacrés — le Soleil et la Lune ; le ratio de valeur entre eux a toujours été de 14 :1 non parce que la terre contient 14 fois autant d’argent que d’or mais parce la Lune met 14 jours solaires pour passer de sa phase sombre à sa phase pleine. Les pièces peuvent avoir leur origine dans le fait que les jetons du temple symbolisant une part du sacrifice des fidèles — souvenirs saints, pouvaient ensuite être monnayés pour obtenir des biens car ils avaient la « mana » et non une simple valeur utilitaire. (Cette fonction peut être à l’origine, à l’Age de la Pierre, du commerce de pierres « cérémonielles » utilisées dans des rites de distribution de type « potlach ».) Au contraire des notes de crédit mésopotamiennes, les pièces furent gravées d’images sacrées et furent considérées comme des objets « liminaux », points nodaux entre la réalité quotidienne et le monde des esprits (ainsi, la coutume de plier les pièces afin de les « spiritualiser » et de les jeter dans des puits qui sont les « yeux » de l’Autre Monde.) La dette elle-même — l’essence véritable de l’argent — est un concept hautement « spirituel ». Comme tribut (dette primitive) elle exemplifie la soumission face à un « pouvoir légitime » d’expropriation, masqué par une idéologie religieuse — mais comme « dette réelle et véritable » elle atteint à l’unique capacité spirituelle de se reproduire elle-même comme un être organique. Encore aujourd’hui, elle reste la seule substance « morte » dans le monde entier à posséder ce pouvoir — « l’argent attire l’argent ». A ce stade, l’argent commence à prendre un aspect « parodique » vis-à-vis de la religion — il semble que l’argent veuille rivaliser avec Dieu, devenir un esprit immanent en une forme purement métaphysique qui néanmoins « dirige » le monde. La Religion doit prendre conscience de la nature blasphématoire de l’argent et le condamner comme contra naturam. L’Argent et la Religion entrent en opposition — on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Mais aussi longtemps que la religion continuera à se comporter en tant qu’idéologie de la « séparation » (Etat hiérarchisé, expropriation, etc.) elle n’arrivera jamais à s’atteler au problème de l’argent. Encore et encore des réformateurs apparaissent au sein de la religion pour chasser les marchands du Temple, et toujours ceux-ci reviennent — et, en fait, assez souvent les marchands deviennent le Temple lui-même. (Ce n’est certes pas un accident si les bâtiments bancaires furent copiés de l’architecture religieuse.) Selon Weber, c’est Calvin qui a finalement résolu le problème avec sa justification théologique de « l’usure » — mais cela ne porte pas crédit aux vrais Protestants, tels les Ranters et les Niveleurs qui proposèrent que la religion soit une fois pour toutes en opposition avec l’argent — amenant ainsi l’avènement du Millenium. Il semble bien plutôt que l’on doit porter au crédit de l’Illuminisme la résolution du problème — en se débarassant de la religion comme idéologie des classes dominantes et en la remplaçant par le rationalisme (et l' »Economie Classique »). Cette formule cependant fait mauvaise justice aux véritables Illuminati qui proposèrent le démantèlement de toutes les idéologies du pouvoir et de l’autorité — cela n’aidera pas non plus à expliquer pourquoi les religions « officielles » ne réussirent pas à réaliser leur potentiel d’opposition et donne plutôt un support moral à l’Etat et au Capital.
Cependant, sous l’influence du Romantisme on voit apparaître — à l’intérieur et à l’extérieur de la religion « officielle » — un sens grandissant de spiritualité comme alternative aux aspects oppressifs du Libéralisme et de ses alliés artistiques/intellectuels. D’un côté ce courant mènera à une forme conservatrice-révolutionnaire à la réaction romantique (par exemple Novalis) — mais d’un autre côté, il nourrira l’ancienne tradition hérétique (qui commença aussi avec l' »Aube des Civilisations » comme mouvement de résistance à la théocratie) — et se trouva dans une étrange alliance avec le radicalisme rationaliste ; William , par exemple, ou les « Chapelles Blasphématoires » de Spence et de ses fidèles, représentent cette tendance. La rencontre de la spiritualité et de la résistance n’est pas un événement surréaliste ou anormal qui puisse être adouci ou rationalisé par l' »Histoire » — elle occupe une position à la racine même du radicalisme ; — et en dépit de l’athéisme militant de Marx ou de Bakounine (lui-même une sorte de mutant mystique ou « hérétique »), le spirituel reste inextricablement impliqué dans la « Bonne Vieille Cause » qu’il a aidé à créer.
Il y a quelques années, Régis Debray écrivait un article qui mettait en évidence la fait qu’en dépit des prédictions optimistes du matérialisme du XIXe siècle, la religion échappe toujours avec perversité à la disparition — et que peut-être il était grand temps pour l’avènement d’une Révolution qui mette un terme à cette mystérieuse persistance. De culture catholique, Régis Debray s’était intéressé à la « Théologie de la Libération », elle-même une projection de la vieille quasi-hérésie des « Pauvres » Franciscains et de la redécouverte du « communisme de la Bible ». S’il avait considéré la culture protestante, il aurait pu se souvenir du XVIIe siècle, et rechercher son véritable héritage ; s’il avait été musulman il aurait pu évoquer le radicalisme des Shi’ites ou des Ismaïli, ou l’anticolonialisme des néo-sufi du XIXe siècle. Chaque religion a ardemment appelé sa propre antithèse intrinsèque ; chaque religion a considéré les implications d’une opposition morale au pouvoir ; chaque tradition contient un vocabulaire de la résistance aussi bien que de la soumission à l’oppression. Pour parler largement, on peut dire que jusqu’à aujourd’hui cette « contre-tradition » — qui est intérieure et extérieure à la religion — a eu un « contenu répressif ». La question de Debray concernait ce potentiel de réalisation. La Théologie de la Libération perdit beaucoup de son support au sein de l’église quand elle ne put plus servir cette fonction de rivale (ou de complice) au Communisme Soviétique ; et elle ne put plus servir cette fonction quand le Communisme s’effondra. Mais certains théologiens de la Libération semblèrent sincères — et ils continuent à l’être (comme au Mexique) ; de plus, une tendance au sein du Catholicisme, exemplifiée dans le quasi-anarchisme scolastique d’Ivan Illich, subsiste encore dans ses origines. Des tendances similaires peuvent être identifiées au sein de l’Orthodoxie (Bakounine), du Protestantisme, du Judaïsme, de l’Islam, et (dans un sens quelque peu différent) du Bouddhisme ; de plus, dans les formes « survivantes » les plus pauvres de la spiritualité (Chamanisme) ou des syncrétismes afro-américains on peut trouver une cause commune avec de nombreuses tendances au sein des religions « majeures » sur des problèmes tels que l’environnement et la moralité de l’anti-Capitalisme. En dépit des éléments de la réaction romantique, de nombreux mouvements New-Age ou post New-Age peuvent également être associés à cette catégorie.
Dans un précédant essai, nous avons souligné les raisons de croire que l’effondrement du Communisme implique le triomphe de son unique opposant, le Capitalisme ; ainsi, selon la propagande néo-libérale globalisante, il n’y a plus qu’un seul monde qui existe aujourd’hui ; et cette situation politique a de grave implications pour la théorie de l’argent en tant que déité virtuelle (autonome, spiritualisée et toute puissante) de l’unique univers. Dans ces conditions, tout ce qui était auparavant une troisième voie (neutralité, retrait, contre-culture, le « Tiers Monde », etc.) se retrouve aujourd’hui dans une situation nouvelle. Il n’y a plus de seconde – et donc comment en concevoir une troisième ? Les « alternatives » se sont réduites catastrophiquement. Le Monde Unique est maintenant dans une position qui lui permet d’écraser tout ce qui a échappé son baisé extatique – grâce à cette malheureuse croisade essentiellement économique contre l’Empire du Mal. Il n’y a plus de troisième voie, plus d’alternative. Tout ce qui est différent sera maintenant réduit en une « mêmeté » de ce Monde Unique — ou se trouvera en opposition avec ce monde. En acceptant cette thèse comme allant de soi, nous devons nous demander où la religion va se positionner sur cette nouvelle carte des « zones » de capitulations et de résistances. Si la « Révolution » a été libérée de l’incube oppressif soviétique et est redevenu un concept valable, sommes-nous finalement dans une position où nous pouvons tenter de donner une réponse à la question de Debray ?
Si l’on considère la « religion » dans son ensemble, en ce comprises des formes comme le chamanisme qui appartient plus à la Société qu’à l’Etat (selon les termes de l’anthropologie de Clastres) ; en ce compris les polythéismes, monothéismes et athéismes ; en ce compris le mysticisme et les hérésies tout comme les orthodoxies, les églises « réformées » et les « nouvelles religions » — il est évident que le sujet ainsi considéré manque de définitions, de frontières, de cohérence et ne peut être remis en cause au risque de générer une kyrielle de réponses plutôt qu’une réponse simple. Mais la « religion » se réfère pourtant à quelque chose — appelez cela une palette de couleurs dans le spectre du devenir humain — et comme telle pourrait être considérée comme une entité dialogique et un sujet théorisable. Au sein du mouvement capitaliste triomphant – dans son instant processuel pour ainsi dire – toute religion peut être vue uniquement comme nulle, c’est-à-dire comme un bien qui doit être emballé et vendu, un actif à réaliser ou une opposition à éliminer. Toute idée (ou idéologie) qui ne peut être soumise à la « Fin de l’Histoire » du capitalisme doit être détruite. Ceci inclut à la fois la réaction et la résistance — et plus encore l' »a-separatif » « re-liage » (religio) de la conscience avec l' »esprit » en tant qu’auto-détermination sans médiateur et créatrice de valeur — le but originel de tout rituel et rite. La Religion, en d’autres mots, a perdu sa connexion avec le pouvoir au sein du monde du fait que ce pouvoir a migré hors de ce monde — il a abandonné même l’Etat et parachevé la pureté de l’apothéose, comme dieu qui a « abandonné Antoine » dans le poème de Cavafy. Les quelques Etats (principalement Islamiques) où la religion détient le pouvoir sont localisés justement dans les régions les plus opposées au Capital — (leur donnant ainsi d’aussi mauvais compagnons que Cuba !). Comme toute « troisième voie » la religion fait face une nouvelle dichotomie : capitulation totale ou révolte. Ainsi, le « potentiel révolutionnaire » de la religion apparaît clairement — bien qu’il ne soit pas clair si la résistance peut prendre la forme de la réaction ou du radicalisme – ou si vraiment la religion n’est pas déjà battue – si son refus d’avancer est celle d’un ennemi ou d’un fantôme.
En Russie et en Serbie, l’Eglise Orthodoxe semble s’être impliquée dans la réaction contre le Nouvel Ordre Mondial et se trouve ainsi un nouveau sentiment de camaraderie avec ses anciens oppresseurs bolcheviques. En Tchétchénie, l’Ordre Sufi Naqshbandi continue sa lutte centenaire contre l’impérialisme russe. Au Chiapas, il y a une étrange alliance en les « païens » Mayas et les catholiques radicaux. Certaines factions du Protestantisme américain sont arrivées à un point de paranoïa et de résistance armée (mais même les paranoïaques ont des ennemis réels) ; alors que la spiritualité amérindienne semble animée d’un petit mais miraculeux regain de vitalité — pas un simple Fantôme cette fois-ci, mais une position raisonnée et profonde contre l’hégémonie de la monoculture Capitaliste. Le Dalaï Lama apparaît parfois comme le seul « leader mondial » capable de parler vrai à la fois des reliefs de la répression Communiste et des inhumaines forces du Capitalisme, un « Tibet Libre » pourrait donner un certain point de focalisation pour un bloc « interconfessionnel » de petites nations et de groupes religieux alliés contre le social-darwinisme transcendantal du consensus. Le Chamanisme arctique peut réémerger en tant qu’idéologie de l’auto-détermination de quelques-unes des nouvelles républiques sibériennes — et quelques « nouvelles religions » (comme le néo-paganisme occidental ou les cultes psychédéliques) appartiennent par définition au pôle de l’opposition.
L’Islam s’est posé lui-même comme l’ennemi de l’impérialisme chrétien et européen dès les premiers jours de son apparition. Tout au long du XXe siècle, l’Islam a fonctionné comme une « troisième voie » contre le Communisme et le Capitalisme, et dans le contexte du nouveau Monde Unique il constitue par définition un des rares mouvements de masse qui ne puisse être englobé dans l’unité d’un pseudo-« Consensus ». Malheureusement, le fer de lance de la résistance — le « fondamentalisme » — tend à réduire la complexité de l’Islam à une idéologie artificiellement cohérente — l' »Islamisme » — qui échoue clairement à parler au désir humain normal de différence et de complexité. Le Fondamentalisme a déjà échoué à s’impliquer lui-même dans les « libertés empiriques » qui doivent constituer les revendications minimales de la nouvelle résistance ; par exemple, sa critique de l' »usure » est d’évidence une réponse inadéquate aux machinations du F.M.I. et de la Banque Mondiale. La « porte de l’Interprétation » de la Sharia doit être rouverte — et non fermée à tout jamais — et une alternative complète au Capitalisme doit émerger de cette tradition. Quoique l’on puisse penser de la Révolution Libyenne de 1969, elle a au moins eu la vertu d’être un essai de fusionner l’anarcho-syndicalisme de 68 avec l’égalitarisme néo-Sufi des Ordres Nord Africains et de créer un Islam révolutionnaire — quelque chose de similaire peut être dit du « Socialisme Shi’ite » d’Ali Shariati en Iran, qui fut écrasé par l’ulémocratie avant d’avoir pu se cristalliser en un mouvement cohérent. Le fait est que l’Islam ne peut être rejeté en tant que puritanisme monolithique tel que décrit par les médias capitalistes. Si une coalition anticapitaliste originale doit apparaître dans le monde, cela ne peut se faire sans l’Islam. Le but de toutes théories capables de sympathie avec l’Islam, je crois, est d’encourager aujourd’hui ses traditions radicales et égalitaires et de réduire ses modes d’actions réactionnaires et autoritaires. Au sein de l’Islam persiste des figures mythiques comme le « Prophète Vert » et le guide occulté des mystiques, al-Khezr, qui pourraient devenir facilement des sortes de saints patrons de l’environnementalisme islamique ; et l’histoire offre de tels modèles comme le grand sufi algérien, le combattant de la liberté, l’Emir Abdel Kader, dont le dernier acte (en exil à Damas) fut de protéger les chrétiens syriaques contre la bigoterie des ulémas. A l’extérieur de l’Islam il existe un potentiel pour les mouvements « interconfessionnels » concernés par la paix, la tolérance et la résistance à la violence post-seculaire et post-rationaliste du néo-libéralisme et de ses alliés. En effet, le « potentiel révolutionnaire » de l’Islam même s’il n’est pas encore réalisé est toutefois réel.
Puisque c’est le Christianisme qui est la religion qui a donné « naissance » (selon la terminologie wébérienne) au Capitalisme, sa position par rapport à l’apothéose actuelle du Capitalisme est de fait plus problématique que celle de l’Islam. Pendant des siècles la Chrétienté s’est tournée vers elle-même et a construit une sorte de monde « fait pour croire », dans lequel un semblant de social peut persister (et encore seulement le dimanche) — même lorsqu’elle maintenait l’illusion d’une quelconque relation avec le pouvoir. En tant qu’allié du Capital (avec son semblant d’indifférence à l’hypothèse de la Foi) contre le « Communisme Athée », la Chrétienté a pu préserver l’illusion du pouvoir — au moins jusqu’aux cinq dernières années. Aujourd’hui, le Capitalisme n’a plus besoin du christianisme et du support social dont il a joui va bientôt s’évaporer. Déjà la reine d’Angleterre a du considérer le fait de ne plus être le Chef de l’Eglise anglicane — et il est peu probable qu’elle sera remplacée par un quelconque Président de société commerciale ! L’Argent est Dieu — Dieu est vraiment mort en fin de compte ; le Capitalisme a réalisé une hideuse parodie de l’idéal d’Illumination. Mais Jésus est un dieu mourant et en résurrection. Même Nietzsche a signé sa dernière lettre « insane » en tant que « Dionysos et le Crucifié » ; à la fin c’est peu être la seule religion qui puisse triompher de la religion. Au sein du christianisme, une myriade de tendances apparaît (ou ont survécus depuis le XVIIe siècle, tels les Quakers) cherchant à faire revivre ce Messie radical qui a purifié le Temple et promis le Royaume aux déshérités. En Amérique par exemple, il semble impossible d’imaginer un mouvement de masse qui puisse vraiment l’emporter contre le capitalisme (une certaine forme de « populisme progressiste ») sans la participation des églises. De plus, la tâche théorique commence à se clarifier ; on n’a plus besoin de proposer une sorte d' »entrisme » au sein du christianisme organisé afin de le radicaliser par une conspiration de l’intérieur. Le but serait plutôt d’encourager un potentiel sincère et étendu du christianisme radical soit de l’intérieur en tant que fidèle honnête ou en tant que sympathisant sincère de l’extérieur.
Je m’attends à ce que ces idées rencontrent peu d’acceptation au sein de l’anarchisme traditionnel et athéiste ou des survivants du « matérialisme dialectique ». Le radicalisme illuministe a longtemps refusé de ne reconnaître aucune racine autre qu’historique au radicalisme religieux. Comme résultat, la Révolution jette le bébé avec l’eau du bain de l’Inquisition ou de la répression puritaine. En dépit de l’insistance de Sorel au besoin de la Révolution à avoir un « mythe », elle préfère plutôt baser tout sur la « raison pure ». Mais l’anarchisme et le communisme spirituel (tout comme la religion elle-même) ont échoué à disparaître. En fait, en devenant une anti-religion, le radicalisme est revenu à une sorte de mysticisme fait-maison, complet avec son rituel, son symbolisme et sa morale. Le remarque de Bakounine au sujet de Dieu — que s’il existait, on devrait le tuer — passerait pour de la pure orthodoxie au sein du Bouddhisme Zen ! Le mouvement psychédélique qui a offert une sorte de vérification « scientifique » (ou du moins expérimentale) de la conscience non-ordinaire, a mené à un degré de rapprochement entre la spiritualité et la politique radicale — et la trajectoire de ce mouvement ne fait que commencer. Si la religion a « toujours » été impliquée dans une forme quelconque d’enthéogénèse (« naissance du dieu intérieur ») ou de la libération de la conscience, certaines formes de propositions utopiques ou promesses d’un « paradis sur terre », et certaines formes d’actions militantes et positives pour une « justice sociale » comme plan de Dieu pour la création. Le Chamanisme est une forme de « religion » qui (comme Clastres l’a démontré) peut effectivement institutionnaliser la spiritualité contre l’émergence de hiérarchies et de séparations — et toutes les religions possèdent en elles au moins une trace chamanique.
Toutes les religions peuvent démontrer une tradition radicale, d’une manière ou d’une autre. Le Taoïsme a produit les Bonnets Jaunes — où les Tong collaborèrent avec l’anarchisme au sein de la révolution de 1911. Le Judaïsme a produit l' »anarcho-sionisme » de Marin Buber et Gershom Scholem (profondément influencé par Gustav Landauer et autres anarchistes de 1919), qui trouva sa voix la plus éloquente et paradoxale en Walter Benjamin. L’Hindouisme a donné naissance au parti terroriste Bengali ultra-radical — et aussi à M. Gandhi, le seul théoricien de la révolution non-violent qui ait eu du succès au Xxe siècle. A l’évidence, l’anarchisme et le communisme n’arriveront jamais à s’entendre avec la religion sur des sujets tels que l’autorité et la propriété ; et peut-être peut-on dire que l' »Après-Révolution » verra de telles questions rester sans réponse. Mais il semble clair que sans la religion il n’y aura aucune révolution radicale ; l’Ancienne Gauche et la (vieille) Nouvelle Gauche ne peuvent se battre seules. L’alternative à l’alliance aujourd’hui est de regarder pendant que la Réaction coopte les forces de la religion et lance une révolution sans nous. Que vous le vouliez ou non, il est nécessaire de mettre en place une forme stratégie préemptive. La Résistance demande un vocabulaire au travers duquel notre cause commune peut être discutée.
Si tant est que l’on puisse classer tout ce qui précède sous la rubrique « sentiments admirables », nous nous trouverions nous-mêmes loin d’un programme d’action évident. La religion ne va pas nous « sauver » en ce sens (et peut-être que l’inverse est vrai !) — en aucun cas la religion ne doit faire face à la même perplexité que toutes autres formes de la « troisième voie », en ce compris toutes les formes du radicalisme anti-autoritaire et anti-capitaliste. La nouvelle « totalité » et ses médias apparaissent tellement persuasifs que pour annihiler tout programme à tendance révolutionnaire, car tous les « messages » sont perçus de manière égale comme étant issus du Capital lui-même. Bien sûr la situation est désespérée — mais la stupidité seule pourrait prendre cela comme raison de désespérer ou d’accepter la défaite. L’espoir contre l’espoir — l’espoir révolutionnaire de Bloch — appartient à une « utopie » qui n’est jamais tout à fait absente même lorsqu’il y est le moins présent ; et cela appartient aussi bien à la sphère religieuse dans laquelle le désespoir est le péché absolu contre l’Esprit Saint — la trahison de la divinité intérieure — l’échec à devenir humain. « Le devoir Karmique » au sens donné par la Bhagavad Gita — ou au sens de « devoir révolutionnaire » — n’est pas quelque chose d’imposé par la Nature, comme la gravité ou la mort. C’est un don gratuit de l’esprit — on peut accepter ou refuser ce fait — et chacune de ces attitudes est périlleuse. Le refuser c’est courir le risque de mourir sans avoir vécu. L’accepter est encore plus dangereux mais offre de plus intéressantes possibilités. Une version comme celle de Pascal Wager non pas celle sur l’immortalité de l’âme mais simplement sur sa simple existence.
Pour utiliser une métaphore religieuse (que nous avons jusqu’ici essayé d’éviter), le millenium a commencé 5 ans avant la fin de ce siècle, quand le Monde Unique est apparu et qu’il a banni toute dualité. Cependant, dans une perspective judéo-islamo-chrétienne, il est le faux millenium de l' »Anté-christ » ; qui n’est pas une personne (sauf peut-être dans le monde des Archétypes) mais une entité impersonnelle, une force contra naturam — l’entropie travestie en Vie. Dans ce sens, le règne de l’iniquité doit et sera combattue dans le vrai millenium, l’avènement du Messie. Mais le Messie également n’est pas une simple personne issue du monde — mais plutôt une collectivité dans laquelle chaque individualité est réalisée et donc (à nouveau métaphoriquement ou imaginalement) immortalisée. Le « Peuple-Messie » n’entre pas dans la « mêmeté » homogène ni dans la séparation infernale du capitalisme entropique mais dans la différence et la présence de la révolution — la lutte, la « guerre sainte ». Sur cette base seule nous pouvons commencer à travailler sur une théorie de la réconciliation des forces positives de la religion et des causes de la résistance. Ce qui nous est offert ici n’est que le début du commencement.
Dublin, 1er septembre 1996.
In « Millenium » – Chapitre « Religion et Revolution »
Bey – Traduction par Abraham ibn Sabbah – Novembre 2001 e.v.