Ce texte inachevé et non daté (la date relevée sur l’ordinateur – septembre 2009 – n’est pas significative en soi, la même date ayant été relevée pour d’autres textes) revient sur son travail, Walter Benjamin, sentinelle messianique, paru chez Plon en 1990 et réédité aux Prairies ordinaires en 2010, neuf mois après son décès. « Était-il insatisfait des formules du livre, où avait-il simplement envie de continuer la recherche, d’explorer d’autres voies ? » : à cette question posée par Michael Löwy à qui nous l’avons soumis avant de le publier, nous sommes tentés de répondre par la deuxième suggestion.
Plusieurs textes de Benjamin sont présentés comme « thèses » : « Défense d’afficher » dans Sens unique, « Treize thèses contre les snobs », « Thèses provisoires et nouvelles thèses ». Les Thèses constituent d’abord une forme théologique, puis politique (les Thèses sur Feuerbach), à la fois théorique et polémique : « Sur le plan du genre, la thèse réunit le traité et l’aphorisme ; en elle le discours ne s’enfle pas, mais se brise et se morcelle […] [1] » : réplique balbutiante du cinéma, une séquence d’images s’esquisse, continuité fragmentaire ou juxtaposition globalisante.
– I –
« On connaît la légende de l’automate capable de répondre dans une partie d’échecs, à chaque coup de son partenaire et de s’assurer le succès de la partie. Une poupée en costume turc, narghilé à la bouche, est assise devant l’échiquier qui repose sur une vaste table. Un système de miroirs crée l’illusion que le regard peut traverser cette table de part en part. En vérité un nain bossu y est tapi, maître dans l’art des échecs et qui, par des ficelles, dirige la main de la poupée [2]. »
On peut se représenter en philosophie une réplique de cet appareil. La poupée appelée « matérialisme historique » gagnera toujours. Elle peut hardiment défier qui que ce soit si elle prend à son service la théologie, aujourd’hui on le sait petite et laide et qui, au demeurant, n’ose plus se montrer (traduction Gandillac).

- Le Turc mécanique, gravure de Karl Gottlieb von Windisch
L’origine de la légende de l’automate vient probablement du Joueur d’échecs de Maelzel, de Poe, où les opérations de l’automate sont réglées par l’esprit ; ou peut-être encore de la poupée satanique Olympia, d’Hoffmann, et de la transformation généralisée des humains en poupées automates. Ou, plus probablement encore, d’une fusion de ces références… Le nain y rappelle le diablotin de l’enfance, le bukliger Zweig.
« Pourquoi les poupées ont-elles une âme ? », demandent en écho Hocquenghem et Schérer. Dans Le Montreur de marionnettes, Kleist soutient la supériorité du pantin à ficelles sur la danseuse réelle. Le mouvement du premier aurait plus de grâce et de naturel parce que non entravé par la réflexion. Pourquoi faut-il que le nain de Benjamin soit hideux et bossu, pauvre théologie bossue qui donne pourtant son âme à la brillante poupée ?
L’automate évoque la mécanique, l’aspect répétitif des événements dans la conception newtonienne du temps et le cours continu de l’histoire.
Mais qu’est-ce que cette énigmatique théologie ? Pour Michael Löwy, c’est encore « l’esprit messianique » sans lequel la révolution et le matérialisme historique ne peuvent triompher.
Théologie et politique auraient en commun l’idée d’à-présent (Jetztzeit), catégorie de la crise, de l’action, de la bifurcation, du possible, tout simplement de l’événement. Ainsi, analogiquement, dans les Passages, le changement dû à la mode se soustrait à l’approche historique et n’est véritablement surmonté que par l’approche politique (théologique), qui reconnaît dans chaque constellation actuelle ce qu’elle a d’authentiquement unique et ne fait jamais retour.
Le texte est construit sur la double opposition, entre l’automate somptueux et le nain bossu, entre le matérialisme historique et la théologie, petite et laide, qui n’ose se montrer. Opposition à situer dans le contexte stalinien de la scientificité du matérialisme historique, qui épouse toute la continuité du scientisme positiviste et de l’expulsion du sujet. Elle appelle à ouvrir le feu :
• Contre [Auguste] Comte. À la manière d’Auguste Blanqui, pour qui le positivisme est « un expédiant, une ficelle, un truc ». Comte n’a rien découvert, il a seulement « classifié, nomenclaturé, pédantisé ». Le positivisme sert d’abri aux athées et aux matérialistes honteux prosternés devant le fait accompli, le résidu historique, le pratico-inerte : « Parce que les choses ont suivi ce cours, il semble qu’elles n’auraient pu en suivre d’autre. Le fait accompli a une puissance irrésistible. Il est le destin même. L’esprit en est accablé et n’ose se révolter […]. Terrible force pour les fatalistes de l’histoire, adorateurs de ce fait accompli ! Toutes les atrocités du vainqueur, la longue série de ses attentats sont froidement transformés en évolution régulière, inéluctable, comme celle de la nature [3]. » Blanqui fustige de même « le triomphe de la sociologie », en tant qu’enregistrement acritique des faits : « De sa prétendue science de la sociologie, aussi bien que de la philosophie de l’histoire, le positivisme exclut l’idée de justice. Il n’admet que la loi du progrès continu, la fatalité. Chaque chose est excellente à son heure, puisqu’elle prend place dans la série des perfectionnements. Tout est au mieux toujours. Nul critérium pour apprécier le bon ou le mauvais. » Enfin, martèle Blanqui, « le positivisme dénomme science particulière chacune des diverses sciences connues, et science générale la Philosophie positive, c’est-à-dire la classification comtiste. Il installe ainsi modestement dans l’humanité comme Science des sciences, quoi ? La fantaisie d’un pédant [4] ! »
• Contre Staline et le fait accompli du pacte germano-soviétique. Staline qui est aussi le père du matérialisme historique codifié en science positive de l’histoire et du matérialisme dialectique institué en science (positive) des sciences (voir aussi à ce sujet la critique par Gramsci du positivisme sociologique de Boukharine !).
• Contre Althusser (qui se revendique explicitement de l’héritage durkheimien) et le « procès sans sujet » qui finit par expulser l’histoire elle-même, l’événement, et les turbulences du possible, en un mot la politique, de la machinerie historique.
Pour Löwy, le lien entre le « matérialisme historique » et la théologie réside chez Benjamin dans la remémoration (Eingedenken) différente du souvenir (Andenken) qui est resté dans la dépendance étroite du vécu. Chez Péguy déjà, « l’histoire est résurrection. L’histoire passe le long de l’événement comme elle longerait un mur de cimetière. La mémoire consiste au contraire à ne pas en sortir. Elle est dans le vif. La remémoration est la quintessence de la conception théologique de l’histoire.
La remémoration, ou le « resouvenir », rend la mémoire active, alors que le souvenir, dit Proust, c’est « la mémoire glacée » [5]. La révolution est aussi restauration et sauvetage, rédemption messianique (Erlösung, l’Erlösung de Benjamin et de Rosenzweig). Paradis perdu et Terre promise s’y confondent. « L’idée du bonheur enferme celle du salut, inéluctablement », tout comme la catastrophe chez Sorel appelle en écho l’idée de délivrance : « Ce qu’il y a de plus profond dans le pessimisme, c’est la manière de concevoir la marche vers la délivrance [6]. »
Le sauvetage par la mémoire agit dans le grand comme dans l’infime. Tout doit être sauvé. Il n’y a pas, en la matière, de petites pertes, pas de détail qui tienne. D’où les chiffonniers de Benjamin. D’où le souci de la miniature et du détail caché chez Ruskin et Proust. Proust, qui jubile : « Voici que la petite figure a revécu et retrouvé son regard. » Ruskin, attentif, qui triomphe parce que « la petite figure inoffensive et monstrueuse aura ressuscité contre toute espérance de cette mort qui semble plus totale que les autres, qui est la disparition au sein de l’infini du nombre [7] ».
Car la vraie mort serait « de rester là, irregardée ». Tout comme le baiser, le regard réveille et rappelle à la vie le détail oublié. C’est là le manquement des historiens. Dans le sillage des vainqueurs, ils font œuvre de fossoyeurs, au lieu de fouiller d’un regard salvateur les champs de ruines et de décombres : « De cet ordre de créatures d’humble condition, silencieuses, inoffensives, infiniment soumises, infiniment dévouées, aucun historien ne s’occupe le moins du monde [8] ».
Plus profondément, l’alliance du matérialisme historique et de la théologie récuse l’athéisme bourgeois, la raison instrumentale, calculatrice et froide. Bloch réclamait une lecture de la Bible avec les yeux du Manifeste communiste (L’Athéisme dans le christianisme) et, réciproquement, une lecture de Marx ayant à l’esprit les interrogations pressantes venues des traditions et des textes des religieux. « Sans ce rapport vivant à l’eschatologique et au sacré subversifs l’athéisme profane est forcément appelé à dépérir, voire à se transformer dans la religion et dans la religiosité conservatrices de l’athéisme repu et obtus [9]. »
D’où la formule provocatrice de Bloch : « Seul un athée peut être un bon-chrétien, seul un chrétien peut être un bon athée. »
Prenant ses distances avec Kant, voulant revenir de la Loi (du devoir hétéronome) à l’Amour (le devoir choisi et enthousiaste), Hegel rappelait la théologie à la rescousse (cf. son Jésus-Christ de 1795). Contre le machinisme positiviste du temps, du progrès, de l’évolution, des membres disloqués et des pièces détachées, la théologie rationnelle est censée rétablir l’organicité de la vie, le rythme du devenir, la part de l’aléatoire, le jugement de valeur, la volonté, bref inscrire le moment révolutionnaire au fer rouge dans le froid édifice des structures.
Impossible de rencontrer ce renfort théologique chez Benjamin sans en chercher la source immédiate chez Rosenzweig : « Quelle tâche la théologie historique s’était-elle assignée par rapport au passé ? […] Il faut que le passé revête les traits du présent. C’est seulement ainsi qu’il devient totalement inoffensif pour ce présent. On charge l’idée d’évolution, son âme damnée, d’ordonner la matière jusqu’à un point culminant, c’est-à-dire jusqu’au miracle jadis central de la foi révélée ; on donne ensuite son congé au passé : il a acquitté sa dette, il peut s’en aller. » Le passé est alors « neutralisé par l’idée d’évolution ». « La philosophie réclame aujourd’hui, pour se libérer de ses aphorismes, et donc précisément pour sa scientificité, que les théologiens fassent de la philo. Mais des théologiens en un autre sens certes. » Dans quel sens ce théologien nouveau ? « La théologie fait donc aujourd’hui appel à la philosophie : pour parler comme la théologie,
c’est afin de jeter un pont entre la création et la révélation, un pont qui permette ensuite d’effectuer le lien, d’une importance capitale pour la théologie d’aujourd’hui, entre Révélation et Rédemption [10]. »
– II –
« “L’un des traits les plus surprenants de l’âme humaine, à côté de tant d’égoïsme dans le détail, est que le présent en général soit sans envie quant à son avenir.” Cette réflexion de Lotze conduit à penser que notre image du bonheur est marquée tout entière par le temps où nous a maintenant relégués le cours de notre propre existence. Le bonheur que nous pourrions envier ne concerne plus que l’air que nous avons respiré, les hommes auxquels nous aurions pu parler, les femmes qui auraient pu se donner à nous. Autrement dit, l’image du bonheur est inséparable de celle de la délivrance. Il en va de même de l’image du passé que l’Histoire fait sienne. Le passé apporte avec lui un index temporel qui le renvoie à la délivrance. Il existe une entente tacite entre les générations passées et la nôtre. Sur Terre nous avons été attendus. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est juste de ne la point négliger. Quiconque professe le matérialisme historique sait pour quelles raisons. »
Das Bild von Glück…
L’image du bonheur est « fonction du temps ». Illusoire ? Passagère ? Relative ? La jalousie se rapporte seulement au possible passé, pas à l’avenir. C’est pourquoi elle est liée à la Rédemption, au rappel, au sauvetage, qui reprend et corrige le passé. Il en va de même de la représentation/idée (Vorstellung) du passé « que l’histoire fait sienne ». Le passé reste lié au présent toujours à même de le citer. Le passé porte avec lui un index temporel secret/caché (Heimlich), grâce auquel il peut attendre la Rédemption/Délivrance (Erlösung).
Benjamin dialogue ici avec un interlocuteur absent. « Mon état d’âme, en avançant sur la route du temps, s’enfle continuellement de la durée qu’il ramasse ; il fait pour ainsi dire boule de neige avec lui-même [11]. » « Notre durée n’est pas un instant qui remplace un autre instant : il n’y aurait alors jamais que du présent, pas de prolongement du passé dans l’actuel, pas d’évolution, pas de durée concrète. La durée est le progrès continu du passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant [12]. » Plus loin encore, Bergson évoque « une durée où le passé, toujours en marche, se grossit sans cesse d’un présent absolument nouveau » : il faut « que nous ramassions notre passé qui se dérobe, pour le pousser, compact et indivisé dans un présent qu’il créera en s’y introduisant. Bien rares sont les moments où nous nous ressaisissons nous-mêmes à ce point : ils ne font qu’un avec nos moments vraiment libres [13] ». Le passé est donc « une pointe qui s’insère dans l’avenir en l’entamant sans cesse ».
Il n’est jamais révolu. On n’a jamais vraiment son passé derrière soi. « D’une manière générale, en droit, le passé ne revient à la conscience que dans la mesure où il peut aider à comprendre le présent et à prévoir l’avenir : c’est un éclaireur de l’action [14]. » Enfin, « comment le passé, qui, par hypothèse, a cessé d’être, pourrait-il par lui-même se conserver ?… La question est précisément de savoir si le passé a cessé d’exister ou s’il a simplement cessé d’être utile. Vous définissez arbitrairement le présent ce qui est, alors que le présent est simplement ce qui se fait. Rien n’est moins que le moment présent, si vous entendez par là cette limite indivisible qui sépare le passé de l’avenir […]. Nous ne percevons pratiquement que le passé, le présent pur étant l’insaisissable progrès du passé rongeant l’avenir. La conscience éclaire donc de sa lueur, à tout moment, cette partie immédiate du passé, qui penchée sur l’avenir, travaille à le réaliser et à se l’adjoindre [15]. »
Le passé recèle donc une possibilité captive ou endormie qu’un baiser du présent, comme dans le conte de fées, peut réveiller et délivrer. Cette catégorie de la Résurrection/Réveil est également commune à Benjamin et Blanqui : « Combien de milliards de cadavres glacés rampent ainsi dans la nuit de l’espace, en attendant l’heure de la destruction, qui sera, du même coup, celle de la résurrection ! Car les trépassés de la matière rentrent tous dans la vie […]. Si la nuit du tombeau est longue pour les astres finis, le moment vient où leur flamme se rallume comme la foudre […]. Mais quand un soleil s’éteint glacé, qui lui rendra la chaleur et la lumière ? Il ne peut renaître que soleil. » Il évoque ensuite les « légions mortes qui se heurtent pour ressaisir la vie ». « Les astres s’éteignent de vieillesse », mais « se rallument par un choc » [16]. Pour « refaire des vivants avec des morts ». Donc : « Le chemin sera long, le temps aussi, jusqu’à l’heure des vieillesses, puis des morts, enfin des résurrections. » Blanqui parle encore des « chocs résurrecteurs » et des « conflagrations rénovatrices ».
L’attente messianique existe donc en vertu d’une « entente tacite », selon laquelle nous nous savons attendus sur la Terre. Mission et dette donc, non envers le futur (non pour le confort de la descendance), mais envers le passé et les victimes de l’injustice ?
Il s’agit ni plus ni moins, en battant les cartes de l’histoire et en redistribuant le jeu, que de délivrer les vaincus de leur tourment éternel. Car, « dans le procès du passé devant l’avenir, les mémoires contemporains sont les témoins, l’histoire est le juge, et l’arrêt est presque toujours une iniquité, soit par la fausseté des dépositions, soit par leur absence ou par l’ignorance du tribunal. Heureusement, l’appel reste à jamais ouvert, et la lumière des siècles nouveaux, projetée au loin sur les siècles écoulés, y dénonce le jugement des ténèbres [17]… »
L’éclairage rétroactif laisse en perpétuel chantier la question : qu’est-ce que vaincre ? Le procès de Socrate, celui du Christ, celui de Jeanne, celui de Boukharine, et tant d’autres, en appellent aux siècles futurs. « Les grands événements de notre globe ont leur contrepartie, surtout quand la fatalité y a joué un rôle. Les Anglais ont perdu peut-être bien des fois la bataille de Waterloo sur les globes où leur adversaire n’a pas commis la bévue de Grouchy. Elle a tenu a peu […]. » Ailleurs, donc, une fois au moins, fût-ce par accident inversé sur une invisible planète, Grouchy est arrivé à temps, et la Commune a réussi. Ça a tenu à si peu ! Peut-être à la bévue de Blanqui emprisonné la veille de la bataille, en vertu d’une autre implacable fatalité…
Vaincre ne prouve jamais rien.
Les victoires « aux hanches lourdes », dont parle Péguy, ne constituent pas en elles-mêmes des signes recevables : « Les vainqueurs trouvent généralement que j’ai moins d’importance. Ils ont les élections, le plébiscite, le pouvoir. Ces ratifications leur paraissent pleines de valeur. Mais aux yeux des vaincus, je prends soudain une importance extrême. Les vaincus font appel au jugement de l’histoire [18]… » « Il y a là une pensée très profonde et très pieuse, une pensée très pauvre, très humble, une pensée très misérable et très touchante : que le jour d’aujourd’hui, si pauvre, fasse appel au pauvre jour de demain ; que l’année d’aujourd’hui, si misérable, que l’année de cette fois, que l’année d’à présent, si débile, fasse appel à la méprisable année de demain ; que ces misères fassent appel à ces misères ; et ces débilités à ces débilités ; et ces humilités à ces humilités ; et ces humanités à ces humanités [19]. »
Attendus, nous sommes dépositaires d’une modeste parcelle de pouvoir messianique.
On est toujours, fût-ce à son insu, le Messie de quelqu’un.
Puisque vaincre ne prouve décidément rien que de provisoire, d’éphémère, de transitoire, la victoire reste à déchiffrer, indéfiniment par les siècles à venir, qui ne cesseront de remanier le sens du passé.
Ainsi à nous, comme à chaque génération précédente, est confiée cette faible (pourquoi faible, fragile et précieuse, « schware ») force/capacité messianique (messianisch Kraft) sur laquelle le passé fait valoir un droit inaliénable. L’engagement, la responsabilité, répond à une « citation », ou à une « sommation » impossible à éluder. Le matérialiste historique sait pourquoi. Déjà, le texte de Benjamin comporte une allusion aux vaincus des années trente, et aux victimes à venir, y compris au pauvre suicidé de Port-Bou, qui tend la main, pour un pacte secret, à l’Enfermé solitaire du siècle précédent ?
Un pacte d’espoir messianique, par-delà les souffrances et les défaites. Mais comment être sauvé sans passer du côté des vainqueurs ?
– III –
« Le chroniqueur qui narre les événements, sans distinction entre les grands et les petits, tient compte, ce faisant, de la vérité que voici : de tout ce qui jamais advint rien ne doit être considéré comme perdu pour l’histoire. » « Certes ce n’est qu’à l’humanité délivrée qu’appartient pleinement son passé. C’est dire que pour elle seule, à chacun de ses moments, son passé est devenu citable. Chacun des instants qu’elle a vécus devient une citation à l’ordre du jour – et ce jour est justement le dernier. »
Le chroniqueur s’oppose à l’historien positiviste. Péguy disait à propos de Michelet que, quand il suit son temps, « il n’est qu’historien » ; et quand il suit son génie, « il est promu mémorialiste et chroniqueur [20] ». Car le chroniqueur recueille, sans discrimination, sans hiérarchie ; il reste dans la narration qui ne trie pas entre le gros et le petit. Il est, pour le compte de la mémoire, une sorte de chiffonnier ou de collectionneur qu’affectionne Benjamin. Il est encore dans le registre du récit non ravalé au rang du reportage.
Le chroniqueur, en effet, a le mérite d’apporter sans trier, sans sélectionner, une quantité de matériaux à interpréter, ce qui est le rôle propre de l’historien matérialiste. « L’historien, écrit Missac est un prophète tourné vers le passé [21]. » Ou tel devrait être l’historien chroniqueur, l’historien empathique et affectueusement chiffonnier, comme le souligne Irwing Wolfarth : « La promesse du bonheur n’est rien d’autre que le sauvetage intégral de notre passé [22]. » Il faut donc savoir « ne renoncer à rien ».
C’est le collectionneur qui sauve les membres épars d’une révolution avortée. Il faut que rien ne soit négligeable. Que nul ne soit exclu du banquet des mendiants. Que toutes les [choses] soient « citées » par le chroniqueur scrupuleux pour qui les détails ne sont jamais méprisables ou négligeables en raison de leur taille historique.
Collectionner les choses tombées, c’est-à-dire délivrées de leur corvée d’utilité quotidienne, est un acte d’amour (cf. dans Sens unique sur le timbre-poste et le passage « Je déballe ma bibliothèque », où l’acte de rassembler – sammeln – importe plus que le résultat ; ou plus précisément « lumpensammler » comme allégorie du travail de l’historien). Car, pour le « vrai collectionneur », « le monde est présent dans chacun de ses objets, et ceci selon un certain ordre [23] ». Il faut donc commencer par recueillir tous les « déchets » de l’histoire pour en construire une somptueuse mosaïque ; ces déchets qui sont encore les ruines accumulées par le vent du Progrès.
« Pliant sous un tas de débris », « le dos et les reins écorchés par le poids de sa botte » [24], le chiffonnier semble porter le poids du monde sur ses épaules (moderne et dérisoire Prométhée), tout ce qui a été perdu, rejeté, dédaigné. Cette hotte débordante d’oubli, comme une bosse, rapproche peut-être la silhouette s’éloignant du chiffonnier de celle du malicieux Bossu. Le Bossu, dit quelque part Benjamin, « disparaîtra à la venue du Messie ». À moins qu’il ne soit et se révèle le Messie lui-même, juste avant sa métamorphose.
« À savoir, écrivait Clément Marot, si les bossus seront droits dans l’autre monde […]. »
Chaque époque, selon Michelet, rêve la suivante. Et pour Marx, le passé « pèse sur les vivants comme un cauchemar », dont il faut s’éveiller pour que le présent puisse devenir la réalisation des rêves passés. « L’avenir en somme n’est ouvert qu’à lui-même et avant qu’il devienne le présent, à l’espérance d’une espérance [25]. » Péguy revendiquait « une sombre fidélité pour les choses tombées ». C’est chez Baudelaire enfin qu’on trouve la figure du chiffonnier reprise par Benjamin : ce chiffonnier « ramasse comme un trésor les ordures », qui seront ensuite remâchées par la divinité industrie. Le collectionneur s’attache aux choses et les délivre de leur caractère de marchandises.
De tout ce qui est advenu (ereignen), rien ne doit être considéré comme perdu (veleren – Proust) par l’histoire. Collectionné (remémoré), ce qui a été perdu, peut être retrouvé. Et ce n’est qu’à l’humanité délivrée qu’appartient vraiment son passé. En attendant cette délivrance, le passé est captif, de même que l’humanité elle-même. Privée de son passé confisqué par les vainqueurs, détroussée par les voleurs de mémoire. Pour l’humanité libérée et pour elle seulement, en chacun de ses Moments (au sens hégélien qui se réfère au Tout), le passé est devenu citable (ziterbar). Au sens où la citation, le rappel, équivaut précisément à un sauvetage. La citation est aussi l’hommage de la relecture qui vivifie le présent par la remémoration : jeu de mots où se mêlent la citation littéraire et la citation à comparaître [26]…
Ce jour de la citation est justement le dernier. Comment interpréter ici « dernier » ? La citation coïnciderait-elle avec un Jugement dernier millénariste, une fin de l’histoire qui répare l’injustice et sauve le passé, et rabat les rivages de la terre promise sur ceux du Paradis perdu ? S’agit-il de la circularité infinie retrouvée ? Du moment fini précieusement retrouvé dans l’infini, de l’instant perdu retrouvé dans l’Éternité ?
– IV –
« Occupez-vous d’abord de vous nourrir et de vous vêtir, ensuite vous écherra de lui-même le royaume de Dieu. »
Hegel, 1807.
« La lutte des classes, que jamais ne perd de vue l’historien instruit à l’école de Marx est une lutte pour les choses brutes et matérielles sans lesquelles il n’est rien de raffiné ni de spirituel. Mais, dans la lutte des classes, ce raffiné, ce spirituel se présente tout autrement que comme un butin qui échoit au vainqueur ; ici, c’est comme confiance, comme courage, comme humour, comme ruse, comme inébranlable fermeté, qu’ils vivent et agissent rétrospectivement dans le lointain du temps. Les remet en question chaque nouvelle victoire des dominants. Comme certaines fleurs orientent leur corolle vers le soleil, ainsi le passé, par une secrète sorte d’héliotropisme, tend à se tourner vers le soleil en train de se lever dans le ciel de l’histoire. Quiconque professe le matérialisme historique ne peut que s’entendre à discerner ce plus imperceptible de tous les changements. »
La première phrase de cette thèse est une profession de foi matérialiste, introduite par l’idée hégélienne de travail (se nourrir et se vêtir d’abord), engagée sur l’affirmation de la lutte de classe omniprésente, qui est une lutte pour les choses (Dinge) brutes et matérielles (rohen und materialen) opposées au raffiné et au spirituel. Négation donc du vieux dualisme.
Mais ces choses raffinées et spirituelles ne se réduisent pas dans la lutte de classe à un butin (Beuten) revenant au vainqueur (toujours la même défiance de la victoire trompeuse, et des « congrès des vainqueurs »). Le raffinement est au contraire immanent à la lutte. Ce sont des valeurs ressuscitées (comme les paroles gelées de Rabelais) : confiance, courage, ruse, inébranlable fermeté – qui vivent et agissent « dans le lointain du temps retrouvé » (selon Gandillac) ou, « agissent rétrospectivement dans le lointain du temps » (selon Missac) (sie sind in diesen Kampf lebendig, und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück). « Leur écho se répercute dans la nuit des temps passés. »
Elles viendront inlassablement remettre en question les victoires dont sont sortis les dominateurs. On retrouve ici, blottie entre les lignes, la citation cachée de Blanqui : « Malheur aux vaincus ! Ceux de juin ont vidé le calice jusqu’à la lie. C’est à qui leur trouvera des crimes. Victorieux, on leur eut demandé une place d’honneur sous leur drapeau […]. Le 26 juin est une de ces journées néfastes que la Révolution revendique en pleurant […]. Vous tous, grands inconnus que dévore par milliers la fosse commune […]. » Inversement, constatait avec désespérance V. Grossman devant les ruines de Stalingrad : on ne demande pas de comptes aux vainqueurs (Vie et Destin). Du moins pas tout de suite.
Pour Blanqui la victoire est presque toujours détournement de valeur : « Aujourd’hui, chaque mot signifie des choses diamétralement contraires. Lorsqu’une expression avec le sens admis, qui est celui du bien, est devenue un drapeau populaire, l’ennemi s’en empare pour le planter sur l’idée, absolument opposée et la faire accepter sans un pli. » Le passé, comme les fleurs solaires, est appelé et revigoré, réorienté pour le présent, ce soleil en train de se lever en permanence dans le ciel de l’histoire. Le matérialiste historique doit comprendre le plus imperceptible de ces changements. Autrement dit, lire dans les chatoiements du passé le lever de soleil qu’on ne peut, sans s’aveugler, regarder en face.
– V –
« Le vrai visage de l’histoire s’éloigne au galop. On ne retient le passé que comme une image qui, à l’instant où elle se laisse reconnaître, laisse une lueur qui jamais ne se reverra. “La vérité ne nous échappera pas” – ce mot de Gottfried Keller caractérise avec exactitude, dans l’image de l’histoire que se font les historicistes, le point où le matérialisme historique, à travers cette image, opère sa percée. Irrécupérable est en effet toute image du passé qui menace de disparaître avec chaque instant présent qui, en elle, ne s’est pas reconnu visé. (La joyeuse nouvelle qu’apporte en haletant l’historiographe du passé sort d’une bouche qui, à l’instant peut-être où elle s’ouvre, déjà parle dans le vide.). »
L’image authentique du passé s’éloigne au galop. Il ne peut être saisi (arrêté), que le temps d’un clin d’œil (Augenblick), où il jette une lueur aussitôt disparue. C’est cette révélation du passé, ce message, qu’il faut saisir comme instant précieux, dans un travail – typiquement proustien – de rappel : la madeleine, le pavé inégal, le col amidonné, le lacet de chaussure, qui sauvent le passé en le métamorphosant en art.
« La vérité ne nous échappera pas » : avidité possessive d’une histoire arrêtée et close. C’est l’image de l’histoire que se fait l’historicisme, dans la poursuite illusoire d’une vérité définitive, et c’est en ce point précisément que le matérialisme historique « le perce à jour », lui qui n’attend aucune sorte de fin. Cet historicisme revêt le visage contemporain du stalinisme érigeant au nom de sa vérité proclamée son propre tribunal de l’histoire. Prétendant avoir le dernier mot.
En réalité, toute image du passé serait irrécupérable, irrémédiablement perdue, si elle n’était rappelée par l’instant présent. Cependant, la joyeuse nouvelle qu’apporte l’historiographe haletant (à bout de souffle) sort d’une bouche qui parle dans le vide, à peine ses lèvres desserrées. Y a-t-il encore une oreille pour recueillir et faire vivre ce message du passé : « qui commande le passé commande l’avenir ; qui commande le présent commande le passé » (Orwell, 1984).
Ainsi, pour Auguste Blanqui, « l’Antiquité est une intruse qui nous a dévoyés », elle est un démenti « à la toquade du développement continu ». Ce retour en force d’un passé indépassable en son registre (cf. Péguy sur l’idée de progrès appliquée aux systèmes philosophiques) bouscule donc l’ordonnancement supposé du progrès. S’opère ici, sous nos yeux, une révolution copernicienne : le passé n’est plus, dans le sillage du temps, une trace évanescente (le pratico-inerte de Sartre) ; il n’est plus immobile et révolu ; il gravite autour du présent. Il ne dicte pas le sens (déterministe). Il reste ouvert à la fécondation du présent toujours chargé du pouvoir messianique de réveiller ses potentialités inexplorées.
« Qui sait, écrivait Breton, s’il ne convient point qu’aux époques les plus tourmentées, se creuse ainsi malgré eux la solitude de quelques êtres dont le rôle est d’éviter que périsse ce qui ne doit subsister passagèrement que dans un coin de serre, pour trouver beaucoup plus tard sa place au centre d’un nouvel ordre, marquant ainsi d’une fleur absolument présente, parce que vraie, d’une fleur en quelque sorte axiale par rapport au temps, que demain doit se conjuguer d’autant plus étroitement avec hier qu’il doit rompre d’une manière décisive avec lui » (Vases communicants).
Le temps perdu est à la fois, inséparablement, gaspillé et oublié. C’est ce passé qui est retrouvé par la remémoration (« tissage de la mémoire » ou « travail de Pénélope du souvenir ») dans l’identité du passé et du présent.
Dans cette thèse apparaît aussi, littéralement, l’idée de l’image (image dialectique) comme la forme par excellence, exclusive, sous laquelle le passé, au sens strict, se représente. L’image détient le pouvoir auratique de contredire au déroulement mécaniquement indifférent du temps devenu étalon et équivalent général des rapports sociaux. D’où d’ailleurs le pouvoir fascinant des images cinématographiques, dont les télescopages, les fondus enchaînés, les retours en arrière, défient de leur rythme ensorcelé la linéarité temporelle et conservent le rare pouvoir de faire encore rêver.
Bergson avait deviné ce pouvoir magique de la lanterne à images : « Les Formes que l’esprit isole et emmagasine dans des concepts, ne sont alors que des vues prises (des prises de vue ?) sur la réalité changeante. Elles sont des moments cueillis le long de la durée, et, précisément parce qu’on a coupé le fil qui les reliait au temps, elles ne durent plus. Elles tendent à se confondre avec leur propre définition, c’est-à-dire avec la reconstruction artificielle et l’expression symbolique qui est leur équivalent intellectuel. Elles entrent dans l’éternité, si l’on veut ; mais ce qu’elles ont d’éternel ne fait plus qu’un avec ce qu’elles ont d’irréel. Au contraire, si l’on traite le devenir par la méthode cinématographique, les Formes ne sont plus des vues prises sur le changement, elles en sont les éléments constitutifs, elles représentent tout ce qu’il y a de positif dans le devenir […]. C’est ce que Platon exprime dans son magnifique langage, quand il dit que Dieu, ne pouvant faire le monde éternel, lui donna le Temps, image immobile de l’éternité [27]. »
Le cinématographe est l’expression la plus appropriée de la temporalité imagée de la mémoire.
– VI –
« Le vrai visage de l’histoire s’éloigne au galop. On ne retient le passé que comme une image qui, à l’instant où elle se laisse reconnaître, laisse une lueur qui jamais ne se reverra. “La vérité ne nous échappera pas” – ce mot de Gottfried Keller caractérise avec exactitude, dans l’image de l’histoire que se font les historicistes, le point où le matérialisme historique, à travers cette image, opère sa percée. Irrécupérable est en effet toute image du passé qui menace de disparaître avec chaque instant présent qui, en elle, ne s’est pas reconnu visé. (La joyeuse nouvelle qu’apporte en haletant l’historiographe du passé sort d’une bouche qui, à l’instant peut-être où elle s’ouvre, déjà parle dans le vide.). »
Articuler historiquement le passé (ce qui constitue précisément le travail de l’historien) ne se résume pas à le reconnaître tel qu’il a réellement été. Ce serait l’illusion positiviste typique quant à la vérité documentaire de l’histoire, garantie par la permanence du passé en son être. Il s’agit de se rendre maître du souvenir, de le saisir au vol, de le surprendre dans sa fugacité, « tel qu’il jaillit à l’instant du danger ». Psychanalyste ? Réaction de défense qui éveille et appelle le souvenir, comme une fulgurance, un jaillissement défensif.
Pour Benjamin, comme pour Péguy, l’histoire n’est décidément pas une science mais une remémoration. La remémoration est une expérience « qui nous défend de concevoir l’histoire de manière fondamentalement a-théologique […] [28] ». Le sujet est ici présent. Explicitement. Puisqu’il s’agit pour le matérialiste historique de saisir du passé « l’image (das Bild) qui s’impose à l’improviste (unversehens) au moment du danger » au « sujet historique » (dem historischen Subjekt).
Qu’est-ce en 1939-1940 que ce danger historique ?
Et qu’en est-il alors du sujet historique ?
Ce danger « menace aussi bien le contenu de la tradition (Kabbale) que ses nouveaux dépositaires ». Car, à chaque époque, il faut tenter d’arracher (sauver encore) la tradition au conformisme qui tente de s’en emparer. Le conformisme, c’est la mise à mort de la tradition ici défendue : thématique de la révolution conservatrice (Le Guépard !) dans la Rédemption. De même, Sorel rejoignait-il Péguy dans la renaissance du traditionalisme. La catastrophe, qui, pour lui aussi peut survenir à tout instant, répond au nom de révolution conservatrice pour laquelle tout ce qui est à conserver est à nouveau à conquérir.
Le Messie ne vient donc pas seulement comme rédempteur. Il vient, vieille obsession apocalyptique, comme vainqueur de l’Antéchrist, délivrer un passé captif. Comme le souligne Ivernel, dans les Thèses, lutte de classe et messianisme « se réactivent mutuellement ».
À l’historiographe seul (Geschischtsschreiber) revient le don d’attiser pour le passé la flamme de l’espérance (das Funken der Hoffnung). Le principe espérance ! Réveillé à nouveau, attisé par l’écriveur d’histoire, convaincu que les morts eux-mêmes ne seraient pas en sécurité si l’ennemi l’emportait. Il porte sur ses épaules et dans sa plume une responsabilité rétroactive, devant le passé, plutôt que devant le tribunal de l’avenir (Pandora) : le devoir de les réveiller, qui resterait inaccompli et les condamnerait à l’éternité recommencée de la défaite, en cas de défaillance du rédempteur.
Or, précisément, cet ennemi n’a, jusqu’à présent, cessé de vaincre. L’histoire, loin de gravir l’escalier monumental du progrès, est avant tout répétition et bégaiement de la défaite. Spirale désespérante de la défaite qui introduit à la grande tristesse historique. La mélancolie qui ronge Saint-Just ou Blanqui, la mélancolie classique, plus profonde et cruelle que la mélancolie romantique. Cette tristesse, en 1939, c’est l’Allemagne, c’est l’Espagne (celle de la culpabilité rongeuse et alcoolique de Lunar Caustic ou de Geoffrey Firmin).
C’est l’imminence évidente de la guerre.
Pourquoi la défaite espagnole, dans la littérature, le cinéma, la musique a-t-elle eu une telle résonance épocale ? Comme une blessure morale, une mauvaise conscience envenimée, plus encore que comme une défaite politique ?
Nietzsche a soufflé la révolte contre les verdicts à sens unique de l’histoire : « Mais quand on apprend à courber l’échine et à baisser la tête devant la “puissance de l’histoire”, on finit par approuver de la tête, comme un magot chinois, n’importe quelle puissance… Si tout succès est dû à une nécessité rationnelle, si tout événement est une victoire de la logique ou de “l’Idée”, alors jetons-nous vite à genou devant toute la gamme des succès [29]. » Réaction anti-hégélienne dans les Considérations inactuelles ! Vision infernale de l’éternel retour des défaites pour Blanqui (1830, 1839, 1848, 1871…) comme pour Benjamin (1923, 1926, 1937, 1939…).
Plus lucidement que nombre de politiques ne perçoit-il pas instantanément le front populaire comme la « fausse couche qui tue » ou comme « dernière fausse couche de la Grande révolution ». Pour avoir laissé passer l’occasion, Paris, définitivement provincialisée, perd irrémédiablement sa place de capitale révolutionnaire.
Pour Benjamin le vaincu, le spleen de Baudelaire, vaincu lui aussi, est « le sentiment qui correspond à la catastrophe en permanence », sorte de négatif et d’envers de la révolution en permanence.
– VII –
« Rappelle-toi les ténèbres et le grand froid
Dans cette vallée résonnant de désolation. »
Brecht, L’Opéra de quat’sous
« À l’historien qui veut revivre une époque, Fustel de Coulanges recommande d’oublier tout ce qui s’est passé ensuite. Mieux vaut ne pas qualifier une méthode que le matérialisme historique a battue en brèche. C’est la méthode de l’intropathie. Elle est née de la paresse du cœur, de l’acedia qui désespère de maîtriser la véritable image historique, celle qui brille de façon fugitive. Les théologiens du Moyen-Âge considéraient l’acedia [30] comme la source de la tristesse. Flaubert, qui la connaissait bien, écrit : “Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage.” La nature de cette tristesse devient plus évidente lorsqu’on se demande avec qui proprement, l’historiographie historiciste entre en intropathie. La réponse est inéluctable : avec le vainqueur. Or quiconque domine est toujours héritier de tous les vainqueurs. Entrer en intropathie avec le vainqueur bénéficie toujours par conséquent à quiconque domine. Tous ceux qui jusqu’ici ont remporté la victoire participent à ce cortège triomphal où les maîtres d’aujourd’hui marchent sur les corps des vaincus d’aujourd’hui. À ce cortège triomphal, comme ce fut toujours l’usage, appartient aussi le butin. Ce qu’on définit comme biens culturels. Quiconque professe le matérialisme historique ne les peut envisager que d’un regard plein de distance. Car, tous en bloc, dès qu’on songe à leur origine, comment ne pas frémir d’effroi ? Ils ne sont pas nés du seul effort des grands génies qui les créèrent mais en même temps de l’anonyme corvée imposée aux contemporains de ces génies. Il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie. Et la même barbarie qui les affecte, affecte tout aussi bien le processus de leur transmission de main en main. C’est pourquoi, autant qu’il le peut, le théoricien du matérialisme historique se détourne d’eux. Sa tâche, croit-il, est de brosser l’histoire à rebrousse-poil. »
L’exergue de Brecht évoque à nouveau la désolation, le spleen douloureux de la défaite, le grand froid historique qui enveloppe les vaincus.
Fustel de Coulange est resté célèbre, nous rappelle Croce, pour avoir décrété qu’il existe « l’histoire et la philosophie, mais non la philosophie de l’histoire ». À quoi Croce réplique simplement, en bon hégélien, qu’il n’y a ni la philosophie, ni l’histoire, ni la philosophie de l’histoire, mais l’histoire qui est philosophie et la philosophie qui est histoire.
Fustel conseille donc à l’historiographie historiciste (positiviste) la méthode nécessaire à la reconstitution d’une époque, qu’il s’agit de faire revivre (nachleben). Pour cela, il faut oublier, mettre entre parenthèses, ce qui s’est passé ensuite, à commencer par le présent. C’est la méthode d’immersion dans le passé, d’identification au premier degré, d’empathie ou d’intropathie, avec laquelle le matérialisme historique a rompu, ainsi, par une autre voie, que Péguy ironisant sur cette ambition divine de l’exhaustivité historique. Cette méthode, assène Benjamin, a surgi de la « paresse du cœur », qui désespère de pouvoir saisir la véritable image historique dans l’éclat fugace de son instant.
L’acedia est la tristesse qui rend muet. Pour reconstituer Carthage, Flaubert fuit son présent. La tristesse qu’il invoque est un grand vide, une façon de s’absenter de soi-même, pareil au dandysme de Baudelaire, triste de sa « gravité dans le frivole » : « la mélancolie est le germe de la lucidité dans la catastrophe de la modernité [31] ». Pourquoi les hommes de génie sont ils des Mélancoliques (Aristote) ? On retrouve la melancolia chez Dürer. Le mélancolique regarde au-delà, et la « mélancolie réplique à la catastrophe moderne par l’expression outrée d’un désenchantement universel [32] ».
La mélancolie est ici, avant tout, une catégorie esthétique, qu’évoque l’homme sans pouvoir de Benjamin, l’homme sans qualités de Musil, ou le roi sans divertissement de Pascal. L’homme si malheureux et si vain, si « plein de mille causes essentielles d’ennui » que la moindre chose « comme un billard et une balle qu’il pousse suffisent pour le divertir » : « qu’on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin de l’esprit, sans compagnie, penser à lui tout à loisir ; et l’on verra qu’un roi sans divertissement est homme plein de misère ».
Mais ce sont misères de seigneurs, misères d’un roi dépossédé…
Blanqui est également un mélancolique devant les deux infinis, à l’instar de Pascal, le seul qu’il cite dans les premières lignes de son Éternité. Il reconnaît en lui un semblable un poète matérialiste de l’infini et de l’éternité. Comme Pascal avec Descartes, « inutile et vain », qui aurait bien voulu pouvoir se passer de Dieu mais ne garde, pour la chiquenaude originelle, qu’un Dieu accessoire et truqueur, Blanqui polémique avec Laplace. C’est « un ultramathématicien » juge-t-il, armé de la « conviction d’une harmonie et d’une solidité inaltérable de la mécanique céleste. Solide, très-solide, soit. Il faut cependant distinguer entre l’univers et une horloge [33] ». « Désormais, c’est pour nous l’inconnu. L’avenir de notre terre, comme son passé, changera des millions de fois de route. Le passé est un fait accompli ; c’est le nôtre. L’avenir sera clos seulement à la mort du globe [34]. »
D’où le désenchantement sidéral que Pascal et Blanqui, à deux siècles de distance, emplissent d’une inépuisable mélancolie esthétique : « L’homme est à l’égal de l’univers l’énigme de l’infini et de l’éternité, et le grain de sable l’est à l’égal de l’homme » ; « Au fond, elle est mélancolique cette éternité de l’homme par les astres et plus triste encore cette séquestration des mondes-frères par l’inexorable barrière de l’espace » ; « Ce que nous appelons le progrès est claquemuré sur chaque terre, et s’évanouit avec elle. Toujours et partout, dans le camp terrestre, le même drame, le même décor, sur la même scène étroite, une humanité bruyante, infatuée de sa grandeur, se croyant l’univers et vivant dans sa prison comme dans l’immensité, pour sombrer bientôt avec le globe qui a porté dans le plus profond dédain le fardeau de son orgueil. Même monotonie, même immobilisme dans les astres étrangers. L’univers se répète sans fin et piaffe sur place. L’éternité joue imperturbablement dans l’infini les mêmes représentations [35]. »
La mélancolie historiciste est autre. Elle fuit son néant pour entrer en empathie (Adorno) avec le vainqueur. Triste généalogie de la domination. Car on n’échappe pas au nœud qui unit le présent au passé. Sous prétexte de le nier, on choisit un présent. Celui qui va de soi. Celui qui, justement domine et perpétue les victoires passées. La neutralité positive est la forme d’intropathie qui lie les vainqueurs entre eux, comme un signe académique de reconnaissance.
Le cortège triomphal (Triumphzug) ne cesse de piétiner lourdement les vaincus cloués au sol. Comme toujours, le butin suit ce cortège. Érigé en patrimoine culturel, il perpétue le souvenir de la défaite et témoigne de l’enlacement meurtrier du maître et de l’esclave. Car ce patrimoine est frappé du sceau de la servitude. Il faut en faire éclater l’ambivalence, qui contredit à la marche triomphale et au tintamarre du progrès. Culture et barbarie forment un couple dialectique infernal. Et la barbarie reste omniprésente dans le processus de transmission du document de culture.
Loin donc de se laisser porter par le sens du courant ou du progrès, comme un chien crevé au fil de l’eau, le matérialiste historique tient pour son devoir (Aufgabe) de « brosser l’histoire à rebrousse-poil » (die Geschischte gegen des Strich zu bürsten).
Contre le courant, donc !
– VIII –
« La tradition des opprimés nous enseigne que l’“état d’exception” dans lequel nous vivons est la règle. Il nous faut en venir à la conception de l’Histoire qui corresponde à cet état. Dès lors nous constaterons que notre tâche consiste à mettre en lumière le véritable état d’exception ; et ainsi deviendra meilleure notre position dans la lutte contre le fascisme. La chance du fascisme n’est pas finalement que ses adversaires, au nom du progrès, le rencontrent comme une norme historique ? – Il n’est aucunement philosophique de s’étonner que soient “encore” possibles au XXe siècle les événements que nous vivons. Pareil étonnement n’a pas de place au début d’un savoir à moins que ce savoir soit de reconnaître comme intenable la conception de l’Histoire d’où naît une telle surprise. »
La tradition des opprimés nous enseigne que l’état d’exception est la règle (Brecht). Cet enseignement prend ici un sens historique précis et circonstancié. Pour la première fois, le texte aborde de front des considérations douloureusement contemporaines.
Le devoir consiste donc à mettre en lumière, rendre visible, le véritable état d’exception. Ici intervient l’idée décisive. Ce qui fait la force du fascisme, c’est qu’il soit combattu au nom de la norme apaisante du Progrès, comme déviance, fâcheux contretemps, mais, en définitive, simple détour : das Fortschritt als einer historischen Norm…
Blanqui se contentait de dénoncer la « doctrine du progrès continu » comme « une fantaisie des temps de transition » [36], et de fustiger la « manie » positiviste du progrès, qui proclame rétrograde la renaissance des lettres gréco-latines. « Il n’y a pas de progrès », car « jusqu’ici le passé pour nous représentait la barbarie et l’avenir signifiait progrès, science, bonheur. Illusions ! Ce passé a vu sur tous nos globes sosies les plus brillantes civilisations disparaître sans laisser de traces. Et elles disparaîtront encore sans en laisser davantage. » Retournant l’image des locomotives de l’histoire, Benjamin à son tour désigne plutôt la Révolution comme l’arrêt, l’interruption, le fait de tirer le signal d’alarme.
Le progrès c’est aussi l’accumulation du Kapital avec son ambivalence.
Baudelaire a aussi dénoncé le progrès comme « un fanal perfide », « une idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne » et grâce à laquelle les peuples « s’endormiront sur l’oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude ».
Péguy ajoutait en écho : « C’est la loi même, le jeu, le fonctionnement du mécanisme temporel. Les valeurs positives ne peuvent point s’y ajouter imperturbablement, en toute sécurité, indéfiniment, perpétuellement, ni surtout irrévocablement. Les valeurs négatives au contraire peuvent s’y ajouter indéfiniment, imperturbablement, en toute sécurité, perpétuellement, irrévocablement, irréparablement. Les valeurs d’accroissance, d’accroissement, de couronnement ne sont jamais sûres de leur accroissement. Les valeurs de décroissance, de décroissement, de découronnement peuvent être, peuvent devenir sûres du découronnement et de la décroissance [37] ».
Pour lui, d’ailleurs l’idée de progrès n’est jamais qu’une « idée de thésauriseurs » [38]. Et cette théorie du progrès « revient à être une théorie de caisse d’épargne. » C’est un escabeau. Un escalier que l’on monte et ne descend jamais.
Un « escalier bien fait ».
Qui a désappris à descendre.
Qui a forgé une vision du monde en termes trompeurs de normal et de pathologique.
– IX –
« À l’essor est prête mon aile,
j’aimerais revenir en arrière,
car je resterais aussi temps vivant
si j’avais moins de bonheur. »
Gershom Scholem, Salut de l’ange.
« Il existe un tableau de Klee qui s’intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble avoir dessein de s’éloigner du lieu où il se tient immobile. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l’aspect que doit avoir nécessairement l’ange de l’histoire. Il a le visage tourné vers le passé. Où se présente à nous une chaîne d’événements, il ne voit qu’une seule et unique catastrophe, qui ne cesse d’amonceler ruines sur ruines et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si forte que l’ange ne les peut plus refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l’avenir auquel il tourne le dos, cependant que jusqu’au ciel devant lui s’accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »
En citant Scholem, Benjamin vient au célèbre tableau de Klee, l’Angelus Novus, qui contredit à cette imagerie béate du progrès. L’Ange veut s’éloigner de quelque chose d’où il se tenait. L’expression de l’effroi et de la fuite : « L’Ange de l’histoire » (dévoilement du symbole) doit paraître ainsi. Effroi donc, plutôt que le bonheur tiède et l’apaisement louche de la réconciliation.
L’Ange est tourné vers le passé, non vers l’avenir. Il regarde en arrière. Cette rétrospective présente pour nous (la fameuse clef de Marx) une chaîne (Kette) d’événements, supposés liés entre eux d’un lien de causalité comme. Dans cette chaîne, B. ne voit qu’une unique catastrophe. Dans les Passages, la catastrophe prend place dans les définitions des « catégories historiques fondamentales » : « la catastrophe – laisser passer l’occasion ; l’instant critique – le statu quo menace de se maintenir […] [39] ».
Cette catastrophe entasse à ses pieds ruine sur ruines (1940 !).
L’Ange voudrait bien s’attarder, réveiller (wecken) les morts et rassembler ce qui a été brisé. Mais la tempête souffle du Paradis perdu (l’Eden, ce jardin d’amour de Malcolm Lowry) si fort, que l’Ange ne peut plus refermer les ailes ; d’où l’effroi des yeux écarquillés et de la bouche ouverte dans une protestation muette.
Il n’avance pas. Il est poussé vers un avenir auquel il tourne le dos, tandis que les ruines s’amoncellent jusqu’au ciel.
Ce qu’on nomme progrès, c’est cette tempête.
– X –
« Les objets que la règle claustrale assignait à la méditation des moines avaient pour tâche de leur enseigner le mépris du monde et de ses pompes. Nos réflexions actuelles procèdent d’une détermination analogue. À cet instant où gisent à terre les politiciens en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur espoir, où ces politiciens aggravent leur défaite en trahissant leur propre cause, nous voudrions arracher l’enfant politique du monde aux filets dans lesquels ils l’avaient enfermé. Le point de départ de notre réflexion est que l’attachement de ces politiciens au mythe du progrès, leur confiance dans la “masse” qui leur servait de “base”, et finalement leur asservissement à un incontrôlable appareil, ne furent que trois aspects d’une même réalité. Nous voudrions suggérer comme il coûte cher à nos habitudes de pensée d’aboutir à une vision de l’histoire qui refuse toute complicité avec celle à laquelle s’accrochent encore ces politiciens. »
Détachement monacal des choses terrestres. Distanciation analogue : la méditation actuelle (Gedankengang) s’éloigne du monde et de ses pompes. Les politiciens en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur confiance gisent à terre. En 1940, au lendemain du pacte germano-soviétique, ce n’est pas une métaphore, mais la réalité nue. Ils parachèvent leur défaite par la trahison (Verrat) de leur propre cause.
De Blanqui à Trotski, c’est la répétition de la révolution trahie plutôt que vaincue, défaite de l’intérieur, dans le désastre moral : « la révolution n’a fait que son métier… ; le crime est aux traîtres […] ».
À cet instant donc, d’extrême désarroi, nous voudrions arracher « l’enfant politique du monde » (das politische Weltkind) du filet dans lequel ils l’avaient pris. Libération de l’enfant politique. Quel est-il ? Et pourquoi enfant ?
Tout le désastre vient de la croyance (Glaube) fétichiste typiquement, de ces politiciens dans le Progrès. Ce mythe, cette foi des politiciens en leur « base de masse », et leur attachement servile (Einordnung, soumission) à un appareil incontrôlé sont les trois éléments interdépendants d’une culture bureaucratique. À l’idéologie mécanique du progrès (à son sens du réel), s’opposent l’aléatoire et le sens du virtuel ; au culte démagogique et moutonnier de la masse, la responsabilité consciente de l’avant-garde ; à l’appareil bureaucratique incontrôlé, la démocratie authentique.
Ces trois manquements ou défaillances, ces trois péchés capitaux de la bureaucratisation du mouvement ouvrier sont absolument communs à la social-démocratie et au stalinisme, unis ici dans une même « culture ».
En conclusion, Benjamin voudrait laisser entrevoir combien il coûte cher (teuer, souligne-t-il) d’atteindre à une conception de l’histoire refusant toute complicité (rejet du compromis, du front populaire en philosophie) avec celle à laquelle s’accrochent encore ces politiciens, au risque de succomber au bégaiement du désastre.
Pourquoi cela coûte-t-il cher ? En quoi ?
Et de quel prix s’agit-il ? Benjamin est mort seul, le 26 septembre, comme un chien, comme le consul de Lowry traité de trotskiste, cinq semaines après Trotski, autre solitaire, le 20 août…
Benjamin en avait parlé à P. Missac en 1937, après la lecture de La Révolution trahie, et à Brecht. D’après G. Scholem, Histoire d’une amitié p. 127, il avait lu Où va l’Angleterre dès 1926 (en même temps que Sodome et Gomorrhe) et sa rencontre avec Asja Lacis. Dès 1927, discussions animées avec Brecht sur la querelle Staline-Trotski et le possible antisémitisme du premier. En 1931, dès la publication, il a « lu avec enthousiasme L’Histoire de la révolution russe » et Ma vie : « depuis des années, je n’ai rien assimilé avec une pareille tension, à couper le souffle » (Ibiza, 1932). Et le 1er mai 1933, toujours d’Ibiza : « Je lis actuellement le second volume de Trotski ; c’est en dehors des promenades mon seul divertissement. Car il est rare ici d’entendre un mot sensé… »
– XI –
« Dès l’origine, vice secret de la social-démocratie, le conformisme n’affecte pas sa seule tactique politique, mais aussi bien ses vues économiques. Rien ne fut plus corrupteur pour le mouvement ouvrier allemand que la conviction de nager dans le sens du courant. Il tient le développement technique pour la pente du courant, le sens où il croyait nager. De là il n’y avait qu’un pas à franchir pour s’imaginer que le travail industriel représentait une performance politique. Avec les ouvriers allemands, sous une forme sécularisée, la vieille éthique protestante de l’ouvrage célébrait sa résurrection. Le Programme de Gotha porte déjà les traces de cette confusion. Il définit le travail comme “la source de toute richesse et de toute culture”. À quoi Marx, pressentant le pire, objectait que l’homme ne possède que sa force de travail, qu’il ne peut être que “l’esclave d’autres hommes […] qui se sont faits propriétaires”. Cependant, la confusion se répand de plus en plus, et bientôt Jospeh Dietzgen annonce : “Le travail est le Messie du monde moderne. Dans […] l’amélioration […] du travail […] réside la richesse, qui peut maintenant apporter ce que n’a réussi jusqu’à présent aucun rédempteur.” Cette conception du travail, caractéristique d’un marxisme vulgaire, ne s’attarde guère à la question de savoir comment les produits de ce travail servent aux travailleurs eux-mêmes aussi longtemps qu’ils ne peuvent en disposer. Il ne veut envisager que les progrès de la maîtrise sur la nature, non les régressions de la société. Il préfigure déjà les traits de cette technocratie qu’on rencontrera plus tard dans le fascisme. Notamment une notion de la nature qui rompt de façon sinistre avec celle des utopies socialistes d’avant 1848. Tel qu’on le conçoit à présent, le travail vise à l’exploitation de la nature, exploitation qu’avec une naïve suffisance l’on oppose à celle du prolétariat. Comparées à cette conception positiviste, les fantastiques imaginations de Fourier, qui ont fourni matière à tant de railleries, révèlent un surprenant bon sens. Pour lui l’effet du travail social bien ordonné devrait être que quatre Lunes éclairent la nuit de la terre, que la glace se retire des pôles, que l’eau de mer cesse d’être salée et que les bêtes fauves se mettent au service de l’homme. Tout cela illustre un travail qui, bien loin d’exploiter la nature, est en mesure de faire naître d’elle les créations virtuelles qui sommeillent en son sein. À l’idée corrompue du travail correspond l’idée complémentaire d’une nature qui, selon la formule de Dietzgen, “est là gratis”. »
La polémique devient explicite. La social-démocratie en est la cible. Mais Benjamin vise au-delà. Le premier mot lâché, le premier grief est celui du conformisme. Vice originel (Von Anfang) et secret. Il concerne aussi bien les vues économiques (dépassement pacifique du conflit) que politiques. Rien de plus corrupteur que la molle conviction de « nager dans le sens du courant ». À quoi s’oppose le vigoureux brossage de l’histoire à rebrousse-poil cher selon lui au matérialisme historique.
Le développement technique est devenu critère du progrès.
De là, on glisse inexorablement vers le culte du travail d’usine (et peut-être l’ouvriérisme qu’il légalise). C’est une version prolétarienne de l’éthique protestante du travail (die alte protestantische Werkmoral), cf. [Max] Weber. Éthique ressuscitée dans une version prolétarienne. Pourtant le signal vient de loin. Dès 1875, avec le fameux Programme de Gotha – dès l’origine donc – le vers était dans le fruit. Culte du travail comme source de toute richesse et toute culture. Accent biblique aux antipodes de Marx, pour qui, des Manuscrits de 1844 à la Critique du programme de Gotha, c’est le dépassement du travail qui est le critère du progrès.
Le culte de l’État revers de celui du travail.
Cette confusion s’approfondit et s’étend chez Dietzgen, lequel enrôle au service de son productivisme ravageur jusqu’au Messie en personne ! Seul le travail serait rédempteur !
Cette vieille malédiction biblique est un scandale théorique pour Walter Benjamin.
Elle traduit une conception du travail caractéristique d’un « marxisme vulgaire » qui déborde largement le cas de la social-démocratie. Car elle élude la question du fétichisme et de l’aliénation. Comme le « communisme grossier », le marxisme vulgaire, obnubilé par le travail et l’accumulation, perd le point de vue de la qualité : « comment les produits de ce travail servent au travailleur » ? Il ne mesure pas le rapport entre progrès de la maîtrise de la nature et les régressions (Rückschmitte) de la société (rapport Natur/Gesellschaft). Cet aveuglement annonce les traits de la technocratie, réalisés ultérieurement par le fascisme.
Cette conception de la Nature objectale rompt avec la nature humanisée des socialistes utopiques prémarxistes (d’avant 1848). Le travail vise à l’exploitation de la Nature. Il perpétue ce faisant l’exploitation, qu’avec une naïve suffisance on croit pouvoir opposer à celle du prolétariat.
La guerre idéologique continue. Benjamin oppose à nouveau, à ces « conceptions positivistes » les fantastiques imaginations de Fourier. Fourier, c’est « l’attraction passionnée » : « une des erreurs de la politique civilisée est de compter pour rien le plaisir, ignorer qu’il doit entrer dans toute spéculation sur le bonheur social. C’est la morale qui fausse les esprits sur ce point […] spéculant sur l’utile sans y joindre l’agréable [40]. » Annonce l’ordre sociétaire qui n’admet ni modération ni égalité, « mais veut des passions ardentes et raffinées. » Il parle aussi de « défiler en orages, en nuées qui s’entrechoquent. C’est chose inconnue en civilisation où l’on n’a jamais perfectionné les évolutions en ligne courbe, comme l’orage, la fourmilière, le serpentinage, les vagues brisées, etc. Les enfants harmoniens excelleront dans toutes ces manœuvres. »
Benjamin évoque toutes ces créations virtuelles de l’imagination, dont la réconciliation avec une nature humanisée est une humanité naturalisée. Cela illustre un travail qui, loin de piller (auszubeuten) la Nature, soit en mesure de réveiller les créations virtuelles qui dorment en elle.
Ici, l’imagination esthétique et poétique s’oppose à l’imaginaire pauvre de la technocratie. Complémentarité entre une idée corrompue du travail, à laquelle répond la nature de Dietzgen, qui s’offre vulgairement gratis, corvéable à merci. Mise en garde philosophique et écologiste profondément fidèle à Marx (citer).
– XII –
« Nous avons besoin de l’histoire, mais nous en avons besoin autrement que n’en a besoin l’oisif blasé dans le jardin du savoir. »
Nietzsche, De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire.
« Le sujet du savoir historique est la classe combattante, la classe opprimée elle-même. Chez Marx, elle se présente comme la dernière classe asservie, la classe vengeresse qui, au nom de générations vaincues, mène à son terme l’œuvre de libération. Cette conscience, qui pour un temps bref reprit vigueur dans le spartakisme, aux yeux de la social-démocratie fut toujours incongrue. En trois décennies, elle a réussi à presque effacer le nom d’un Blanqui, dont la voix d’airain avait ébranlé le XIXe siècle. Il lui plut d’attribuer à la classe ouvrière le rôle de libératrice pour les générations à venir. Ce faisant, elle énerva ses meilleures forces. À cette école la classe ouvrière désapprit tout ensemble la haine et la volonté de sacrifice. Car l’une et l’autre s’alimentent à l’image des ancêtres asservis, non point à l’idéal des petits-enfants libérés. »
Le besoin de l’histoire, placé sous la référence à Nietzsche, est admis à condition que ce ne soit pas comme objet de contemplation passive, comme passé hypostasié en souvenir de pacotille.
Le sujet de la connaissance historique reste sur le terrain de l’analogie avec la psychologie classique : la classe ou le parti comme sujets cartésiens (voir Badiou). La connaissance est ici historique (relative ?). Le sujet est la classe, non sociologiquement inerte, mais définie par un rapport d’oppression et de révolte qui constitue sa subjectivité. Walter Benjamin réunit l’oppression et la pratique (combattante) dans une même subjectivité partisane.
Il prête à Marx sa propre démarche messianique. Ce serait chez lui la classe « vengeresse » (rächende) ou rédemptrice appelée à accomplir son « œuvre de libération » au nom des générations vaincues et non de l’idéal suggéré petit bourgeois du confort des petits enfants.
Point de dette envers la postérité qui devra bien se débrouiller toute seule et remplir envers nous son rôle messianique comme nous le faisons envers nos « ancêtres asservis ».
Il n’y a de dette qu’envers ce passé confisqué prisonnier, condamné, si nous renoncions à notre mission de délivrance, à ressasser la défaite et répéter le supplice. Éternellement.
Ce qui est la définition même de la damnation (le juif errant de Lowry).
« Vaincus sont tous les hommes qui se trouvent au déclin de leur vie en désaccord avec les meilleurs de leurs semblables. Je suis un de ces vaincus […] [41]. » Voir aussi le thème des vaincus chez Péguy et Sorel.
Cette conscience qui, pour « un bref instant » (kurze Zeit), surgissement typiquement messianique, est revenue en Spartakus a toujours été incongrue pour la social-démocratie. Le nom même de Spartakus est chargé d’une puissance évocatrice (comme Mariategui, Sandino, Marti), mais il désigne en outre un moment d’absolue nouveauté et d’espérance intacte, avant la constitution du PC allemand.
Grief majeur de Benjamin : en trois décennies seulement, la social-démocratie est parvenue à effacer le nom d’un Blanqui. Exagère son rôle dans le siècle mais non la rapidité de l’effacement et de la négation, Blanqui dont la voix d’airain avait secoué le siècle.
Mise en place d’antinomies :
Spartakus/stalinisme ;
Blanqui/social-démocratie.
La social-démocratie en revanche veut attribuer à la classe non la libération des vaincus, mais l’image apaisante des générations futures portées par la vague du progrès. Ce faisant, elle ouvre à la fois, la possibilité totalitaire en s’arrogeant de parler au nom du futur (tribunal), et elle enlève à la classe ses meilleures forces de révolte. C’est en effet le passé qui révolte et nourrit la violence de Walter Benjamin comme celle de Sorel (voir Sorel sur la haine et la violence différentes de la brutalité, et l’exposition de Werner sur Walter Benjamin et la violence). À cette école la classe désapprend la haine et l’esprit de sacrifice. Car l’une et l’autre se nourrissent de l’image héroïque des ancêtres asservis et non de l’image molle et petite-bourgeoise des descendants libérés.
– XIII –
« Tous les jours notre cause devient plus claire et tous les jours le peuple devient plus sage. »
Dietzgen, La Religion de la social-démocratie.
« Dans sa théorie et plus encore dans sa praxis, la social-démocratie s’est déterminée selon une conception du progrès qui ne s’attachait pas au réel mais émettait une prétention dogmatique. Tel que l’imaginait la cervelle des sociaux-démocrates, le progrès était, primo un progrès de l’humanité même (non simplement de ses aptitudes et de ses connaissances). Il était, secundo, un progrès illimité (correspondant au caractère infiniment perfectible de l’humanité). Tertio, on le tenait pour essentiellement continu (pour automatique selon une ligne droite ou une spirale). Chacun de ces caractères prête à discussion et pourrait être critiqué. Mais, se veut-elle rigoureuse, la critique doit remonter au-delà de tous ces caractères et s’orienter vers ce qui leur est commun. L’idée d’un progrès de l’espèce humaine à travers l’histoire est inséparable de sa marche à travers un temps homogène et vide. La critique qui vise l’idée d’une telle marche est le fondement nécessaire de celle qui s’attaque à l’idée de progrès en général. »
L’exergue de Dietzgen met en relief ce qui constitue la quintessence temporelle de l’idée de progrès, l’esprit d’escalier, adapté à une conception du temps mécanique et répétitive (Alle Tage, alle Tage…). Chaque jour est censé apporter son petit plus, son petit accroissement, celui des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, pendant que le peuple s’assagit, d’une sagesse qui ressemble à une résignation.
Walter Benjamin dévoile donc une conception du progrès qui ne s’attache pas au réel (authentique : Wirklichkeit), mais émet une prétention dogmatique. Il ne s’agit pas d’un progrès immanent au mouvement historique, interrogeant et critiquant ses propres critères, mais d’un progrès hétéronome et normatif. Trois caractéristiques :
a. un progrès de l’humanité elle-même et non de ses aptitudes ou de ses connaissances ;
b. un progrès illimité conforme à la perfectibilité indéfinie de l’humanité ;
c. un progrès continu, représenté comme automatique, en ligne droite ou en spirale (chrétienne ou marxiste vulgaire).
Chacun de ces traits est passible de critique. Mais si la critique veut aller au fond des choses elle doit les prendre ensemble. L’idée d’un progrès de l’espèce (darwinisme social) dans l’histoire est inséparable de sa marche à travers un temps homogène et vide (homogene und leere Zeit). La critique de l’idée d’une telle marche est le fondement de cette attaque contre l’idée de Progrès en général.
Reprendre l’origine du temps vide (Newton, Kant, plus le K [Le Capital] – note cahier), et sa critique, d’Hegel à Sorel (les Illusions) et Bergson. [Note de D.B.]
La défiance du mouvement révolutionnaire envers la berceuse du Progrès représente déjà un héritage copieux. En fait, cette idée du progrès continu, extérieur à l’épanouissement de l’humanité, qui entasse comme on épargne, jour après jour, a partie liée au positivisme : « La manie du progrès va jusqu’à l’accusation de mouvement rétrograde et d’impulsion négative portée contre la renaissance des lettres gréco-latines, et suivant eux cette victoire sur les infâmes productions du Moyen-Âge est un recul » : « il est vrai en reparaissant au jour, comme le Rhône après sa perte, l’antiquité s’est permis de donner un rude démenti à la toquade du progrès continu » (Blanqui).
Le même Blanqui : « Voici néanmoins un grand défaut : il n’a pas de progrès. Hélas ! non, ce sont des rééditions vulgaires, des redites… Le progrès n’est ici bas que pour nos neveux (à nouveau les petits-enfants…) Ce que nous appelons le progrès est claquemuré sur chaque terre et s’évanouit avec elle. Toujours et partout, dans le camp terrestre le même drame, le même décor, sur la même scène étroite, une humanité bruyante, infatuée de sa grandeur, se croyant l’univers et vivant dans sa prison comme dans une immensité, pour sombrer bientôt avec le globe qui a porté dans le plus profond dédain le fardeau de son orgueil. Même monotonie, même immobilisme dans les astres étrangers. L’univers se répète sans fin et piaffe sur place. L’éternité joue imperturbablement dans l’infini les mêmes représentations. »
Sorel à son tour (en 1908) contre les Illusions du progrès, complaisantes envers les innovations politiques et juridiques de la Révolution française, corrigées par la bourgeoisie républicaine à son usage : « Il est très vraisemblable que l’homme n’a pas une tendance bien marquée vers le progrès et que nos pères se sont bercés d’illusions sur ce point comme sur beaucoup d’autres. Dès les premiers essais du socialisme contemporain, la notion de progrès indéfini (Walter Benjamin) a été abandonnée et on a poursuivi la réalisation prochaine d’un état meilleur ; Hegel a parfaitement interprété l’idée nouvelle quand il a dit que le but de notre action ne doit pas être un but qui fuit indéfiniment devant nous. Le socialisme a donc transformé la notion de progrès, mais il a eu tort souvent de nous montrer un paradis terrestre tout près de nous. » Walter Benjamin, Mythe et violence : référence non étonnante à Sorel.
Péguy enfin dans Clio : « […] Ici les pertes sont acquises et les gains ne le sont pas, ne peuvent pas l’être. C’est la loi commune, générale, de tout le temporel […] » (référence à l’entropie thermodynamique). « Le mouvement logique est de croire, de professer que naturellement l’auteur gagne à chaque fois, avance à chaque fois, progresse à chaque fois […]. Le Mouvement logique […], son orgueil d’escalier et son orgueil d’échelle, c’est qu’à chaque fois sachant plus, chaque fois il sait mieux […]. »
Confusion typique du quantitatif et du qualitatif.
« Misère des thésauriseurs. L’idée logique, le (premier) mouvement logique est que chaque fois constitue un progrès indéniable sur la fois précédente, puisqu’elle est après, une acquisition, ferme, un progrès, acquis, classé ; que c’est comme un escalier qu’on monte, un degré ; que cette marche est irrécusablement plus haute que la marche précédente puisque c’est un escalier, puisqu’elle est la suivante ; autrement ce ne serait pas un escalier et elle ne serait pas une marche ; telle est la théorie du progrès, et elle est la théorie logique ; telle est la croyance commune, puisque c’est la théorie logique et la théorie du progrès […]. En épargnant pour ainsi dire, en économisant d’une fois sur l’autre en mettant de côté d’une fois sur l’autre, en accumulant, en capitalisant d’une fois sur l’autre du savoir, du savoir appris, de la science, du savoir faire, du renseignement. C’est la théorie même et l’idée du progrès. Elle est au centre du monde moderne… au centre de la domination du parti intellectuel dans le monde moderne […]. »
Plus loin, Péguy critique encore « l’idée vulgaire », « les instincts modernes », « sordides », d’épargne et de capitalisation : « Cette théorie du progrès revient essentiellement à être une théorie de caisse d’épargne. »
L’idée du progrès illimité et continu fait système avec celle d’un temps mécanique, homogène et vide, désenchanté. La continuité est vacuité. Cette idée assoupissante du progrès, trompeuse, figure inversée du réveil, dogmatique, parce qu’extérieure au rythme, à l’événement, à l’immanence historique, est commune à la social-démocratie et au stalinisme.
Fantasme né de la cervelle social-démocrate (aidée activement par les sociologues, la physique sociale) qui croit au perfectionnement de l’humanité en tant qu’essence et non de ses aptitudes concrètes et connaissances historiques. Quel serait le critère d’un progrès authentique ?
En réponse rétablissant le temps dialectique contre le temps logique (de Péguy), formellement logique, la révolution n’est plus comme chez Marx la locomotive de l’histoire bien lancée sur ses rails, mais « peut être » plutôt l’interruption consistant à « tirer sur le signal d’alarme ». Benjamin comprend bien le danger : seul « le concept dialectique de temps historique » permet de rompre les « antinomies insolubles » qui découlent de la croyance dans le progrès, dans la perfectibilité indéfinie, et l’idée d’éternel retour, au fond complémentaires. Seule l’interruption laisse passer une nouveauté distincte de l’insipide modernité.
Benjamin rejoint ici Baudelaire qui craignait le jour où « les peuples s’endormiraient sur un oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude ».
Il s’oriente donc, comme Proust et Marx, vers une conception dialectique du temps. Comme Péguy aussi : « Mais moi je sais qu’il y a un tout autre temps, que l’événement, que la réalité, que l’organique suit un tout autre temps, suit une durée, un rythme de durée. » Et « Il est impossible de ne pas se demander si le monde même n’a pas une durée qui ne serait que sous-entendue, et enregistrée par le temps du monde… ; s’il n’y a pas un rythme et une vitesse propres de l’événement du monde, et des ventres et des nœuds, et des époques et des périodes, et une articulation de l’événement du monde… »
– XIV –
« L’origine est la fin. »
Karl Kraus, Paroles en vers, I.
« L’histoire est l’objet d’une construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais qui forme celui qui est plein “d’à-présent”. Ainsi pour Robespierre, la Rome antique était un passé chargé “d’à-présent” surgi du continu de l’histoire. La Révolution française s’entendait comme une Rome recommencée. Elle citait l’ancienne Rome exactement comme la mode cite un costume d’autrefois. C’est en parcourant la brousse de l’autrefois que la mode flaire le fumet de l’actuel. Elle est le saut du tigre dans le passé. Ce saut ne peut s’effectuer que dans une arène où commande la classe dirigeante. Effectué en plein air, le même saut est le saut dialectique, la révolution telle que l’a conçue Marx. »
Ursprung ist das Ziel…
L’origine est le but ? Différence d’orientation entre messianisme (sauver le passé) et l’utopie rêvant vers l’avant ? L’âge d’or de l’origine doit être restitué (rendu) comme la langue originelle (Ursprache). Théorie utopico-restitutionniste, dit Michael Löwy, qui évoque le Tikkun juif : l’expulsion du jardin d’Eden et la tempête qui éloigne les hommes du Paradis et les pousse vers l’Enfer selon la marche impitoyable du Progrès. Le Tikkun, c’est donc la restauration du paradis perdu.
L’origine se rabat dialectiquement sur la fin. L’universel n’est pas un donné perdu, mais une fin.
Après la présentation de l’Angelus et la critique du Progrès, la thèse XIV est le moment d’un renversement dialectique. L’histoire y apparaît enfin comme objet d’une construction. Elle ne vient pas remplir les intervalles de l’axe homogène et vide du temps, ou les passages répétés de la spirale. Elle est construction pleine d’intensités, de correspondances, « d’à-présent ».
Cet à-présent est une reconnaissance de moments qui communiquent par-delà la durée, comme Rome pour Robespierre. Il est aussi le moment historique, le moment stratégique à saisir de Lénine, ou l’instant précieux de Breton. C’est l’à-présent qui réveille et féconde le passé, le fait vivre. Ainsi Rome pour Robespierre qui surgit activement, par surprise, comme passé : fracture, irruption, interruption. En vertu de quoi la nouveauté inaugurale de la Révolution française est d’abord perçue comme une Rome recommencée.
La Révolution citait la vieille Rome (zietierte) au double sens de citation (référence et appel à comparaître) comme la mode (grande obsession benjaminienne que cette déchéance de l’aura dans le verdict de l’opinion) cite un costume d’autrefois. La mode c’est le rappel de ce qui peut revenir du passé. Elle a le flair pour l’actuel, pour ce qui, du passé, entre en résonance avec l’esprit du temps. L’idée de flair appelle celle du fauve. Ainsi la mode va-t-elle flairer l’actuel dans la jungle (Dickicht) de ce qui fut.
En quoi est-elle le saut du tigre dans le passé ?
Métaphore énigmatique, qui télescope des images (encore le collage) de Blanqui : « car la civilisation gréco-romaine a bondi par-dessus le christianisme […]. Si la science a pu naître c’est que l’imprimerie appuyée sur le monde ancien l’a délivrée du tigre qui la guettait au berceau ». Ici, c’est le tigre qui devient bondissant. Mais la mode est donc saut du tigre dans le passé. Part de risque : saut de l’ange ou saut de la mort ? Bond de liberté, mais de liberté encore captive de l’arène commandée par la classe dominante.
En quoi la mode reste un simulacre de liberté.
Une liberté asservie.
Un bond enchaîné, aliéné donc, un faux réveil du passé. Dans les Passages, Benjamin évoque un « mois de juin toujours en éruption révolutionnaire […] », la mode. Car elle est « l’éternelle récurrence du neuf » sous la forme du « toujours la même chose ». Simulacre de nouveauté et parodie de révolution en même temps qu’esthétisation trompeuse de la politique. Si elle prend une telle place dans la modernité du XIXe siècle, c’est qu’elle exprime un domaine résiduel de non rationnel, le domaine asservi de l’imagination, du désir de distinction sociale contre la sérialité triomphante (à nouveau le dandysme et le cercle vicieux de la différence banalisée pour Hockenghem). Car une mode généralisée (une différence banalisée) a perdu sa fonction de distinction. C’est pourquoi elle mesure toute nouveauté à l’aune de la mort, dont le mannequin est l’image figée. Mais il y a, dans la facticité de la mode l’indice de ce qui a été frustré et oublié. « Tout courant d’une mode ou d’une conception du monde prend sa source dans ce qui a été oublié [42]. » Seul le choc proustien peut réparer cette perte.
À défaut de révolution, la mode se fait révolutionnaire, sous forme du simulacre. Elle n’est que « l’éternelle récurrence du neuf » sous la forme du « toujours la même chose » [43], le domaine résiduel du non-rationnel, et de l’imagination, des rêves pacifiés de toute subversion, ramenés à la dimension de « lieux communs » (Goude).
Deux moments constitutifs de la mode : la distinction sociale et l’extension, donc la contradiction entre distinction et extension qui ne cesse de l’annuler. C’est pourquoi la mode mesure toute nouveauté à l’aune de la mort. Le mannequin est à la fois l’image et le souhait du cadavre. Pourtant, un trésor reste enfoui dans ce simulacre d’événement : ce qui a été oublié, comme envers du faux.
Qu’on imagine le bond du tigre non plus dans l’arène des suppliciés, sous le regard dominateur, vigilant et cruel, de la classe dominante, mais en plein air (à l’air libre – unter dem freien Himmel) de l’Histoire. C’est alors le saut dialectique tel que Marx l’a conçu comme Révolution.
La Révolution comme saut dialectique dans le passé, non pour le songer, mais pour le sauver. C’est l’antithèse même du temps irréversible, homogène et vide. Le temps passé n’est plus irrémédiablement perdu. Il peut être sauvé. La plénitude de l’à-présent triomphe de l’évolution creuse. L’événement bouleverse la structure.
L’interruption messianique tient en échec la catastrophe du progrès.
– XV –
« La conscience de faire éclater le continu de l’histoire est propre aux classes révolutionnaires dans l’instant de leur action. La grande Révolution introduisit un nouveau calendrier. Le jour avec lequel commence un nouveau calendrier fonctionne comme un ramasseur historique de temps. Et c’est au fond le même jour qui revient toujours sous la forme des jours de fête, lesquels sont des jours de commémoration. Ainsi, les calendriers ne comptent pas le temps comme des horloges. Ils sont les monuments d’une conscience de l’histoire dont la moindre trace semble avoir disparu en Europe depuis cent ans. La révolution de Juillet a comporté encore un incident où cette conscience a pu faire valoir son droit. Au soir du premier jour de combat, il s’avéra qu’en plusieurs endroits de Paris, indépendamment et au même moment, on avait tiré sur les horloges murales. Un témoin oculaire, qui doit peut-être sa divination à la rime, écrivit alors :
“Qui le croirait ? On dit qu’irrités contre l’heure
De nouveaux Josués, au pied de chaque tour,
Tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour.” »
La fonction spécifique des classes révolutionnaires serait de faire voler en éclat, d’un coup (im Augenblick), le continuum de l’histoire. La révolution est donc bien interruption, rupture, fracture. D’ailleurs, comme pour souligner cette discontinuité, la Grande Révolution n’a-t-elle pas introduit un nouveau calendrier. Par opposition à l’horloge dont l’avènement fait corps avec celui d’un ordre mécanique (Attali), le calendrier conserve un rapport au temps sacré (calendrier aztèque). Il garde la mémoire des événements fondateurs, il souligne les distinctions contre l’homogénéité mathématique du temps horloger. « La prise de la Bastille fut proprement une fête, ce fut la première célébration, la première commémoration, et pour ainsi dire, le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Ou enfin le “zéroième anniversaire” » (Péguy).
Le jour par lequel commence un calendrier fonctionne comme un « ramasseur de temps ». À nouveau l’image (le spectre) du chiffonnier, soucieux de ne rien laisser perdre. C’est au fond ce même jour, qui, sous la forme des fêtes et jours fériés, revient toujours (répétition) qui sont les jours de la remémoration (Eingedenken/Andenken).
Péguy encore : « L’histoire consiste à passer au long de l’événement. La mémoire consiste essentiellement, étant devant l’événement, avant tout à n’en pas sortir, à y rester, et à le remonter du dedans. » « Descendre en soi-même, c’est la grande terreur de l’homme. » Perdre « littéralement la mémoire » dans une affaire (Deyfus) c’est se transformer prématurément en historien. Qu’on y songe. Perdre la mémoire de 1968, du Front populaire, d’Octobre, de la Commune, de la Révolution française, pour en devenir les simples historiens…
« Quand on se réconcilie sur une affaire, c’est qu’on n’y entend plus rien. » Il n’y a qu’une affaire irréconciliable, c’est l’affaire Jésus. La mémoire est querelleuse. Le souvenir est autre : celui qui, « à une remémoration organique préfère un retracé historique », fait appel à ses souvenirs au lieu de « s’enfoncer dans sa mémoire ».
Le calendrier s’oppose au temps mécanique de l’horloge en ce qu’il est chargé de remémoration, de temps symbolique et messianique. Les heures horlogères ont la régularité de la mesure. Elles sont du côté du continuum et du progrès. Les calendriers sont barrés d’interruptions. Ils calculent autrement. Ils sont les monuments d’une mémoire, d’une conscience de l’histoire qui semble avoir disparu en Europe depuis cent ans, autrement dit depuis le passage de Michelet, le grand résurrecteur, et l’avènement de Fustel…
La Révolution de juillet apporte un incident où cette conscience de l’histoire fait valoir son droit. Au soir des premiers combats, en plusieurs endroits, au même moment, on a tiré sur les horloges murales. Geste de révolte contre le temps mesuré, le temps abstrait, le temps de la pointeuse tyrannique. Un appel au temps perdu de la création. Et un témoin inspiré par la rime (encore un hasard) dit que les insurgés, « irrités contre l’heure » tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour.
– XVI –
« Celui qui professe le matérialisme historique ne saurait renoncer à l’idée d’un présent qui n’est point passage [Ubergang], mais qui se tient immobile sur le seuil du temps. Cette idée définit justement le présent dans lequel, pour sa propre personne, il écrit l’histoire. »
L’écrire, en l’occurrence, c’est aussi la faire.
Au présent, saisi dans toute l’unicité de ses possibles, comme moment précieux de révélation.
Opposition :
« – l’historiciste pose l’image “éternelle” du passé » : le passé est le passé (tautologiquement), révolu (différent chez Bergson), où chaque maillon vient docilement prendre place dans la chaîne (l’enchaînement) du temps ;
– le matérialiste historique entretient avec elle une expérience unique (einzig). Le possible fait de tout présent un moment de liberté virtuelle.
Il laisse à d’autre de s’épuiser dans le bordel du « il était une fois ». Même répulsion que les surréalistes pour la banalisation du récit qui devient anecdote prisonnière de l’engrenage horloger du temporel. Présenté sous forme d’une métaphore délibérément virile et agressivement grossière. La prostituée est à la fois vendeur et marchandise. Elle est en quelque sorte la vérité de la société marchande. (Thème de la prostitution à reprendre chez Marx, Kraus, Correspondance de Walter Benjamin, Proust…).
Le matérialiste historique dans son rapport au temps s’oppose irréconciliablement au stalinien et au social-démocrate.
– XVII –
« L’historicisme culmine de plein droit dans l’histoire universelle. Par sa méthode l’historiographie matérialiste se détache de cette histoire plus clairement peut-être que de toute autre. L’historicisme manque d’armature théorique. Son procédé est additif ; il utilise la masse des faits pour remplir le temps homogène et vide. Au contraire l’historiographie matérialiste repose sur un principe constructif. À la pensée n’appartient pas seulement le mouvement des idées, mais tout aussi bien leur repos. Lorsque la pensée se fixe tout à coup dans une constellation saturée de tensions, elle lui communique un choc qui la cristallise en monade. Le tenant du matérialisme historique ne s’approche d’un objet historique que là où cet objet se présente à lui comme une monade. Dans cette structure il reconnaît le signe d’un arrêt messianique du devenir, autrement dit une chance révolutionnaire dans le combat pour le passé opprimé. Il perçoit cette chance de faire sortir par effraction du cours homogène de l’histoire une époque déterminée ; il fait sortir ainsi de l’époque une vie déterminée, de l’œuvre de vie une œuvre déterminée. Sa méthode a pour résultat que dans l’œuvre l’œuvre de vie, dans l’œuvre de vie l’époque et dans l’époque le cours entier de l’histoire sont conservés et supprimés. Le fruit nourricier de ce qui est historiquement saisi contient en lui le temps comme la semence précieuse mais indiscernable au goût. »
L’historicisme est flasque, dépourvu d’armature théorique.
Sa méthode procède par addition. En digne épargnant, il entasse la masse des fruits pour combler l’insatiable appétit du temps homogène et vide, d’une plénitude fictive, purement quantitative, qui est alors vainement cherchée. Que souligne le vide sans l’épuiser.
L’historiographie matérialiste repose au contraire sur un principe constructif. L’ordre théorique n’est pas l’ordre empirique. Il est reconstruction. Et Marx en est un fabuleux bâtisseur.
Forte perspicacité de Walter Benjamin en avance sur la marxologie de son temps. Le mouvement des idées comme leur repos appartient à la pensée et non aux faits. Paradoxe matérialiste qui affirme le côté volontariste, ou plus simplement actif, de l’idéalisme. Et lorsque la pensée fait halte (Stillstellung) et se cristallise dans une constellation saturée de tension (de contradictions) elle communique un choc (Blanqui et les constellations) dans lequel elle jaillit en tant que mémoire.
Ce choc est aussi celui du réveil (le réveil de Proust dans ses chambres, cf. sur la lecture ou les jeunes filles en fleur, la chambre à Cabourg).
Dans cette structure, le matérialiste historique reconnaît le signe (Kabbale) d’un arrêt messianique (einer messianischen Stillstellung) du devenir. Le destin est là tenu en échec par l’intrusion du possible. Il s’agit autrement dit d’une chance (encore le hasard qui triomphe du destin) dans le combat pour le passé opprimé : chance de sauvetage dans ce moment messianique. C’est la solution à l’énigme de l’inertie close de la structure.
Il saisit donc cette chance de faire sortir « par effraction » une époque déterminée du cours homogène de l’histoire. La distinction d’échapper à l’engrenage se présente comme chance. De la sorte, il fait sortir une vie déterminée de l’époque, et une œuvre déterminée de l’œuvre d’une vie : la singularité qui se détache du mouvement vide et, déterminée, lui échappe comme un relief (Hegel).
Le résultat de sa méthode n’est autre qu’un renversement ; car dans l’œuvre, c’est l’œuvre d’une vie, dans l’œuvre d’une vie, c’est une époque, et dans l’époque le cours même de l’histoire qui sont conservés et supprimés à la fois. Dépassés. Le général dans le singulier, l’histoire dans l’œuvre, dans l’irréductible singularité esthétique. C’est, chez Prout, le pan de mur jaune, la sonate, ou encore l’aleph de Borgès comme concentration du monde.
Le temps n’est plus dès lors mesure vide et visible comme un décor. Le fruit historique de ce qui est historiquement saisi incorpore le temps (réduit à son immanence) mais indiscernable au goût.
– XVIII –
« “Par rapport à l’histoire de la vie organique sur la Terre, écrit un biologiste contemporain, les misérables cinquante années de l’homo sapiens représentent quelque chose comme deux secondes à la fin d’un jour de vingt-quatre heures. À cette échelle, toute l’histoire de l’humanité civilisée remplirait un cinquième de la dernière seconde de la dernière heure.” L’à-présent, qui comme modèle du messianique, résume dans un immense abrégé l’histoire de toute l’humanité, coïncide rigoureusement avec la figure que constitue dans l’univers l’histoire de l’humanité. »
A. « L’historicisme se contente d’établir un lien causal entre les différents moments de l’histoire. » Esprit de chaîne ou d’escalier encore, mécanique et déterministe, commun à l’historicisme et au positivisme, à Newton et à Laplace, à la social-démocratie et au stalinisme. Mais aucun fait accompli ne reçoit en tant que « chose originelle » sa qualification historique. Le seul fait d’avoir été ne confère aucune dignité événementielle et significative au regard de l’histoire. Cette qualification historique ne lui vient qu’à titre posthume (toujours la rédemption qui transforme en victoire les défaites apparentes) grâce à des événements qui peuvent être séparés d’elle par des siècles. La discontinuité temporelle ne correspond donc pas aux rapports réels.
L’historien qui part de ce point de vue cesse d’égrener les événements dans ses doigts comme les grains d’un chapelet. En fait donc, positivisme et religiosité sont bien liés dans l’illusion de l’enchaînement des avants et des après selon un ordre d’intelligibilité. Le cours des événements est trompeur au même titre que la marche du progrès. Il suppose lui aussi le temps homogène et vide où, en dépit de l’entassement des événements, rien, à proprement parler, ne se passe.
L’historien souhaité par Walter Benjamin rompt au contraire ce Kontinuum pour saisir la constellation, c’est-à-dire les rapports lointains d’attraction et de gravitation (l’Éternité par les astres) dans laquelle son époque est entrée avec une époque passée déterminée. Il fonde ainsi un concept du présent comme à-présent dans lequel sont logés les éclats/échardes du temps messianique comme autant de possibilités de communication secrète avec les époques qui participent de la constellation. Plutôt que par une causalité mécanique les mouvements de l’histoire obéiraient à des « attracteurs étranges mettant de l’ordre dans leur chaos » ?
B. Retour à une intelligibilité du temps rendu à son contenu et arraché à son abstraction muette de mesure : car les devins qui l’interrogeaient ne le tenaient pas pour homogène et vide. Ils sondaient une plénitude hétérogène, productrice de sens et, par conséquent, susceptible de répondre. Qui envisage ainsi les choses pourra peut-être concevoir comment dans la remémoration (Eingedenken) le temps passé fait objet d’expérience : précisément ainsi.
On sait que les juifs n’avaient pas le droit d’explorer l’avenir. Pas plus que les rêves (double tabou, Marx et Freud). Pour eux, pas d’utopie positive donc. Blanqui : « Laissons l’avenir à lui-même… Détournons les regards de ces perspectives lointaines qui fatiguent pour rien l’œil et la pensée [44]. » En revanche, la Thora et la prière leur enseignaient le souvenir (Andenken, Erinnerung) ; Missac dit souvenir, Gandillac commémoration ; la remémoration (Eingedenken) : que ma langue se colle à mon palais, que ma main droite se dessèche si je t’oublie Jérusalem.
Cette remémoration désenchante l’avenir auquel ont succombé (ont été asservis) ceux qui cherchent des instructions chez les devins. La prévision est illusoire ou supercherie. Escroquerie de pacotille. Mais pour les juifs l’avenir ne devient pas pour autant la proie du temps homogène et vide (encore) figure de l’enfer, éternité effroyable, qui « saisit l’intelligence plus vivement encore que son immensité » (Blanqui) : « Ce que j’écris en ce moment dans un cachot du fort du Taureau, je l’ai écrit et je l’écrirai pendant l’éternité sur une table, avec une plume, sous des habits, dans des circonstances toutes semblables. Ainsi de chacun. » « L’éternité joue imperturbablement dans l’infini les mêmes représentations. » Cette répétition est l’image même de la damnation (le juif errant, le feu éternel de l’enfer, Pandora).
Il faut briser le cercle, se délivrer de l’éternité (par l’amour, chez Asimov, dans Pandora). Les juifs n’ont pas cédé à ce vertige. Car en lui chaque seconde était une porte étroite par laquelle pouvait entrer le Messie. Le possible. Idée forte de la bifurcation, commune à Blanqui et Prigogine, Péguy ? Qui rompt la continuité du temps. On retrouve aujourd’hui cette idée dans les mathématiques des catastrophes (Thom) ou la chimie de Prigogine (ordre par fluctuation) mais qui figure déjà chez Blanqui sous le même terme : « Si la nuit du tombeau est longue pour les astres finis, le moment vient où leur flamme se rallume comme la foudre… À toute minute à toute seconde, des milliers de directions différentes s’offrent à ce genre humain. Il en choisit une, abandonne à jamais les autres. Que d’écarts, à droite à gauche, modifient les individus, l’histoire… Les grands événements de notre globe ont leur contrepartie, surtout quand la fatalité y a joué un rôle. Bonaparte ne remporte pas toujours ailleurs la bataille de Marengo qui, ici, a été un accroc… Seul le chapitre des bifurcations reste ouvert à l’espérance. »
Buber l’Antéchrist dans Gog et Magog.
Landauer.
Deuxième rédaction des points A et B
A. « L’historicisme se contente d’établir un lien causal entre les divers moments de l’histoire. Mais aucune réalité de fait n’est jamais, d’entrée de jeu, à titre de cause, un fait déjà historique. Elle l’est devenue à titre posthume, grâce à des événements qui peuvent être séparés d’elle par des millénaires. L’historien qui part de là cesse d’égrener la suite des événements comme un chapelet. Il saisit la constellation dans laquelle son époque est entrée avec une époque antérieure parfaitement déterminée. Il fonde ainsi un concept du présent comme l’à-présent dans lequel ont pénétré des échardes du messianique. »
B. « Certes, les devins qui l’interrogeaient pour savoir ce qu’il recélait en son sein ne faisaient l’expérience d’un temps ni homogène ni vide. Qui envisage ainsi les choses pourra peut-être concevoir de quelle manière dans la commémoration le temps passé fut objet d’expérience : de la manière justement qu’on a dite. On le sait, il était interdit aux juifs de prédire l’avenir. La Thora et la prière s’enseignent au contraire dans la commémoration. Pour eux la commémoration désenchantait l’avenir auquel ont succombé ceux qui cherchent instruction chez les devins. Mais pour les Juifs, l’avenir ne devint pas néanmoins un temps homogène et vide. Car en lui chaque seconde était la porte étroite par laquelle pouvait passer le Messie. »
« Un cinquième de la dernière seconde de la dernière heure »
Aux heures de doute, aux limites de l’expérience historique, toujours le vertige des deux infinis, comme Pascal et Blanqui, et le sens angoissant de la relativité historique.
On retrouve ici « l’à-présent » (le Jeztzeit) ou le « temps actuel » (Missac) comme modèle de temps messianique, qui représente et rassemble une sorte d’abrégé de l’histoire de l’humanité. Obsession benjaminienne de la concentration du tout en une de ses parties, en un point infime. Tout se joue dans la partie infime. Non dans le tout sur le tout, mais dans le tout sur la partie. Cet à présent infime coïncide rigoureusement avec la Figure (?) que dessine dans l’Univers l’histoire de l’humanité. Le présent condense le temps historique.
En attendant… En passant…
Ni trop tard ni trop tôt.
Dans le temps messianique, la surprise est toujours possible. Il inclut l’idée de rupture/crise/catastrophe et caractérise le mouvement par le choc.
Le cinéma est le contraire du temps homogène et vide, domaine du montage il permet la construction du temps et le flash-back saut typique du tigre.
www.danielbensaid.org



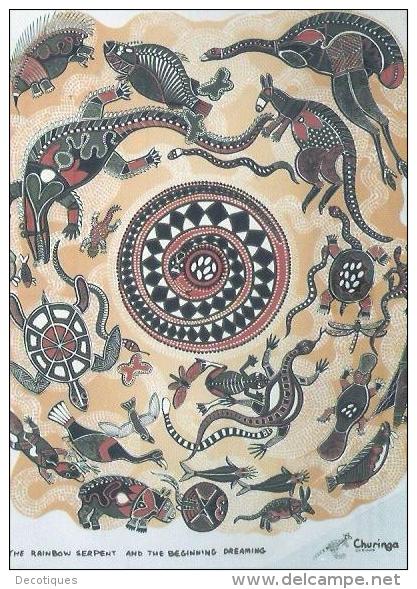






 Haut de page
Haut de page