HOLLOWAY: entrevista ‘Buen Vivir’
lundi, juin 29th, 2015Esta entrevista a John Holloway se realizo en marzo del 2012 com parte de las actividades del Primer Encuentro del Buen Vivir
Esta entrevista a John Holloway se realizo en marzo del 2012 com parte de las actividades del Primer Encuentro del Buen Vivir
La version espagnole de ce texte a été lue lors du séminaire « La pensée critique face à l’hydre capitaliste », organisé par l’EZLN (Oventic – San Cristóbal de Las Casas, Cideci-Unitierra, du 3 au 9 mai 2015).
Il serait bien insuffisant de me contenter de remercier l’EZLN pour l’invitation à ce séminaire si opportun, qui, ces jours-ci, ne fait que commencer. Ce dont je voudrais, plus profondément, remercier les zapatistes c’est, sur le plan personnel, de m’avoir offert l’opportunité, la possibilité de transformer ma vie et, de manière plus générale, d’avoir ouvert, pour tous et toutes, l’une des brèches les plus lumineuses qui existent dans le sombre monde d’aujourd’hui. De sorte qu’ils nous permettent non seulement d’entrevoir ce qu’il pourrait y avoir derrière le mur mais aussi de nous approcher, de toucher et de sentir la force sensible de la vie digne qu’ils font croître, déjà, de ce côté-ci du mur.
Ce furent des journées inquiètes et enthousiastes. Depuis la réception de l’invitation-défi à ce séminaire [1], je n’ai cessé de me demander : qu’est-ce donc que les zapatistes voient venir et dont personne ne se rend compte ni ne parle ? Cette tempête terrible qui vient comme « la catastrophe unique » que regarde l’ange et qui n’est rien d’autre que le progrès, c’est-à-dire le progrès dans l’avancée dévastatrice de l’hydre capitaliste.
Cela fait longtemps que nous savons que la catastrophe est là et que nous vivons au milieu d’un désastre que les zapatistes ont dénommé Quatrième Guerre mondiale, une guerre du capitalisme contre l’humanité [2]. Et on se demande ce qui pourrait être pire que la nuit d’Iguala dans laquelle nous nous trouvons plongés depuis le 26 septembre dernier, faisant nôtres la douleur et la rage des parents et des camarades des absents d’Ayotzinapa. Beaucoup doutent qu’il puisse y avoir quelque chose de plus terrible que ce qui est déjà. Mais les zapatistes nous rendent le service de partager avec nous l’avis de tempête : grimpé en haut du mât, ils voient s’approcher une tourmente plus brutale encore que celle que nous avons éprouvée jusqu’ici.
L’invitation-défi à ce séminaire nous demandait de remettre en question notre capacité à accomplir, depuis la pensée critique, notre tâche de guetteur des évolutions du monde. Elle nous suggérait de nous secouer pour vérifier si nous n’étions pas à demi endormis. Elle nous invitait à recommencer à scruter l’horizon pour tenter d’observer ce que les pièges de l’attention sélective pouvaient laisser caché. Elle nous priait de tenter d’apporter des pensées que nous n’avions pas déjà pensées précédemment. Et cela n’a rien d’aisé.
J’avancerai en doutant de chaque mot. Je parlerai en posant des questions, même s’il n’y a pas de signe d’interrogation.
Visages connus, têtes nouvelles…
Outre l’exploitation, la dépossession, la discrimination et la répression, l’avancée de l’hydre capitaliste provoque une triple dévastation (s’agit-il de sept têtes ?) : dévastation de la nature (au point que les conséquences de la destruction de la biosphère, et en particulier celles du changement climatique global, seront un paramètre sans cesse plus déterminant pour toute forme de pensée et d’action), dévastation des formes de vie (qui sont, très exactement, ce que les peuples, indiens et non indiens, défendent en même temps que leurs territoires), dévastation intérieure (en nous-mêmes). Le capitalisme est la société la plus pathologique qui ait jamais existé dans l’histoire de la planète Terre. Avec son haleine toxique, avec le feu brûlant qu’elle crache et les déjections qu’elle laisse sur son passage, l’hydre sème maladies et mort pour les végétaux, les animaux et les humains (c’est-à-dire pour les animaux non humains et pour les animaux que nous sommes et qui nous disons humains). Ce sont des maladies du corps qui prolifèrent comme jamais, tels que cancers, désordres endocriniens et bien d’autres. Mais ce sont aussi des maladies de l’esprit, de l’âme, du cœur, comme la dépression, l’impossibilité d’être, le vide au plus profond de soi. Crise de la présence, disent certains [3]. Bon nombre de ces pathologies sont des folies provoquées par l’Argent : obsession pour la consommation et pour les marchandises ; obsession de se conformer aux modèles de la réussite professionnelle et sociale. Hypertrophie aiguë, voire hyperaiguë, de l’ego, qui détruit certaines capacités fondamentales des êtres humains, comme celle de l’écoute ou l’art de faire avec d’autres. Obsession de la compétition, qui imprègne de la conviction pratique que pour être il faut se hisser au-dessus des autres (ce qui fait, par exemple, que de jeunes Chinois seraient disposés à se livrer à des manipulations génétiques pour peu qu’elles leur garantissent des enfants plus beaux, plus intelligents et assurés d’avoir une place à l’université d’Harvard !). Bien sûr, il y a aussi la nécessité de satisfaire les exigences sans cesse plus pressantes et pesantes du travail — ou de la recherche d’un travail — qui multiplient stress, dépression, burn out et jusqu’au suicide dans l’entreprise. Une autre maladie, provoquée par l’overdose des écrans de toutes sortes qui prolifèrent dans les espaces domestiques et privés, est la distraction structurelle et l’incapacité à fixer son attention. Ou encore l’incapacité à être vraiment là où nous sommes (puisqu’il faut être en même temps ailleurs), ainsi que d’autres troubles encore dont, selon le diagnostic précis dont nous a fait part la Compagnie Tamèrantong !, même les enfants souffrent à des âges de plus en plus précoces.
Le caractère pathogène de la société capitaliste fait partie intégrante de la guerre que nous subissons, bien souvent sans nous en rendre compte. Il fait partie de son caractère criminel. C’est l’un des points où cette guerre atteint notre âme, notre cœur, notre ch’ulel, pour les détruire, pour effacer toute possibilité d’une vie digne et ainsi pouvoir plus aisément continuer à exploiter, déposséder et dominer les peuples du monde.
Ces têtes-là de l’hydre — quatre plus trois — nous les connaissons de longue date. Je vais maintenant, non sans risque, tenter d’évoquer deux têtes particulièrement menaçantes et peut-être un peu plus nouvelles, même si leurs visages sont loin d’être inconnus. Je dirai plus loin dans quelle perspective je choisis ces deux-là.
Il s’agit de réfléchir à des phénomènes qui atteignent au Mexique des proportions particulièrement dramatiques mais qui sont mondiaux. Je me réfère à l’essor de l’activité économique illicite et d’un capitalisme criminel — c’est-à-dire plus criminel encore, si cela est possible, que celui qui passe pour légal et respectable. Un capitalisme criminel-criminel. Bien entendu, la séparation entre économie légale et illégale est de moins en moins nette. C’est si vrai que, depuis 2013, les États-Unis et plusieurs pays de l’Union européenne ont décidé d’inclure les revenus du trafic de drogue et de la prostitution dans les statistiques officielles du PIB !
Aujourd’hui, les activités illicites (drogues et autres trafics) représentent une partie de l’économie mondiale qu’il est difficile de chiffrer précisément mais que l’on peut estimer autour de dix pour cent du PIB mondial (les estimations varient entre cinq pour cent et quinze pour cent). Plus significatif encore, leur croissance actuelle est extrêmement rapide, favorisée par l’internationalisation et la dérégulation de l’économie néolibérale. De fait, il faut inclure parmi les effets avérés de la reconfiguration néolibérale du capitalisme le fait d’avoir créé les conditions structurelles d’une croissance accélérée des activités illicites et criminelles.
Les drogues comptent désormais parmi les trois marchandises les plus importantes en terme de profits, avec les armes et le pétrole. Les circuits de blanchiment d’argent créent des flux massifs qui alimentent de manière significative le système financier international. L’ensemble des activités illicites est ainsi devenu indispensable à une économie mondiale par ailleurs fragile : lui retirer cet apport de dix pour cent aurait des conséquences catastrophiques.
Au-delà de ces données, il pourrait être utile de chercher à mieux comprendre le rôle que ces secteurs jouent dans l’ensemble du système capitaliste.
a) Ils ont une fonction de contention face à la décomposition sociale provoquée par les politiques néolibérales. Celles-ci multiplient les populations « superflues » qui, ne trouvant ni travail ni aucune place dans la société, peuvent être aisément happées par les réseaux du crime organisé, comme c’est le cas au Mexique. Sous d’autres modalités, en Europe, comme ailleurs aussi, on constate que dans certains quartiers populaires, dévastés par de nombreux problèmes dont le premier est le chômage (jusqu’à cinquante pour cent parmi les jeunes), les divers trafics, de drogue ou autres, constituent l’une des rares manières permettant de survivre. C’est la raison pour laquelle les politiques publiques ne peuvent faire autre chose que de simuler une lutte pour « restaurer l’État de droit », car chacun sait que l’élimination effective de l’économie parallèle provoquerait une explosion sociale incontrôlable. Partout, drogues et activités illicites sont devenues indispensables pour contenir les effets de la décomposition sociale provoquée par le capitalisme néolibéral.
b) On sait aussi que, dans certaines régions, notamment là où abondent les ressources naturelles (minerais ou autres), la violence du crime organisé peut être instrumentalisée, afin de faire régner la terreur, de faire en sorte que les habitants abandonnent leurs territoires et, ainsi, de vaincre les résistances à la dépossession et à l’exploitation [4]. De manière générale, la violence non institutionnelle peut être utilisée comme une façon de contribuer au gouvernement de tous par la peur, mais aussi de réprimer ou d’éliminer ceux qui s’organisent et s’opposent aux avancées de la domination capitaliste.
c) La drogue est la marchandise parfaite, presque la quintessence du capitalisme. Au moment où prédominent les facteurs de crise de la production légale, les drogues permettent des taux de profits extraordinaires (non seulement du fait de sa prohibition, mais aussi grâce à la surexploitation de la main-d’œuvre, travaillant souvent en condition de quasi-esclavage, tant dans les cultures que dans d’autres domaines d’activités, comme les mines clandestines, nombreuses notamment au Mexique). C’est une marchandise presque idéale : n’oublions pas qu’un secrétaire d’État à l’Agriculture, sous la présidence de Vicente Fox, n’avait pas hésité à donner en exemple aux paysans mexicains les cartels de la drogue, fort habiles, argumentait-il, à s’insérer dans les marchés nationaux et internationaux…
C’est la marchandise parfaite également dans la mesure où elle attire grâce à son énorme pouvoir de séduction : elle promet plaisir, transgression, réalisation et dépassement de soi. Pour certains cercles des élites, elle est devenue un moyen indispensable pour soutenir les exigences de l’hyperactivité et de la soif de succès. C’est encore la marchandise parfaite en ce qu’elle provoque une dépendance à l’égard de la consommation, soit exactement ce que la forme actuelle du capitalisme cherche à généraliser. En bref, elle séduit par ses promesses de liberté et ce qu’elle apporte en réalité, c’est la dépendance et la destruction : c’est très précisément ce qui définit, en général, la marchandise capitaliste. La drogue est donc l’expression la plus manifeste et la plus dramatique de la soumission de la vie à la logique de la consommation : une fois créée la dépendance, commence l’enfer de vivre pour trouver l’argent nécessaire pour se procurer la dose suivante, au point d’être prêt à tout et à tout trahir, valeurs et amitiés comprises.
En résumé, se combinent dans les usages actuels des drogues les traits les plus saillants de la société de la marchandise : profits extrêmes pour quelques-uns, surexploitation brutale pour d’autres, culte de l’argent pour tous, dépendances consuméristes, destruction de la vie.
Je vais maintenant me risquer à évoquer l’État islamique (ISIS ou Daech, selon les différents noms qu’on lui donne). C’est une question difficile et j’hésitais à le faire. Car tout cela se passe fort loin d’ici et dans un contexte qu’il est impossible de démêler en quelques minutes. Mais soudain, la participation de nos camarades kurdes à ce séminaire a raccourci les distances. Il faut dire aussi qu’ici même, dans les séminaires de chaque jeudi, au Cideci-Université de la Terre, nous avons suivi, semaine après semaine, la bataille de Kobané et la résistance des combattants kurdes du Rojava face à l’État islamique, et nous avons aussi discuté les comparaisons que certains ont commencé à tracer entre la construction de l’autonomie zapatiste et le confédéralisme démocratique qui croît au Kurdistan [5].
Je ne peux pas parler de l’histoire, récente et moins récente, qui a conduit à la croissance de l’organisation dénommée État islamique, mais on ne peut pas ignorer la lourde responsabilité des puissances impérialistes européennes, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et, au cours des dernières décennies, celle des États-Unis, dont les interventions en Irak (guerres de 1991 et de 2003, occupation militaire jusqu’en 2011) ont conduit le pays à la décomposition dans laquelle il s’enfonce actuellement [6]. Contrôlant désormais la moitié de l’Irak et la moitié de la Syrie, l’État islamique a proclamé en juin 2014 le « califat » qui prétend constituer un État transnational, ayant vocation à s’installer dans toute la région, et jusqu’en Afrique et en Europe. Les exécutions par décapitation, diffusées via Internet, ne sont que la partie la plus visible de la terreur. Se multiplient, de manière moins médiatique, les massacres des populations chrétiennes et yézidies, mais aussi de musulmans, y compris sunnites, qui n’acceptent pas de se soumettre à l’autorité de l’État islamique (par exemple, en août 2014, l’exécution de sept cents personnes d’une tribu sunnite).
L’État islamique a opéré comme une force clairement contre-révolutionnaire, non seulement au Kurdistan mais aussi en Syrie, où la guerre civile a fait, depuis 2011, deux cent cinquante mille morts, huit cent mille blessés, trois millions de réfugiés et sept millions de déplacés (dans un pays qui compte seulement vingt-trois millions d’habitants). En Syrie, le printemps arabe avait déclenché une insurrection contre la dictature de Bachar el-Assad, soustrayant à son autorité la moitié du pays et formant, dans ces territoires, des comités locaux de villages et de quartiers qui ont su inventer des formes d’organisation populaire autonomes [7]. Mais cette révolution s’est heurtée à différents adversaires : non seulement la bestialité d’Assad, qui n’a pas hésité à utiliser des armes chimiques contre son peuple, mais aussi l’État islamique qui, moyennant d’autres formes de terreur, a récupéré le contrôle d’une grande partie des territoires que la révolution avait soustraits à l’État syrien.
Y aurait-il quelque parallèle à tracer entre la violence du crime organisé devenu État et l’État devenu criminel au Mexique, et celle du fondamentalisme religieux [8] fait État parallèle en Irak et en Syrie ? Il ne saurait s’agir de se livrer à de lugubres comparaisons entre des formes de cruauté extrême, mais plutôt d’analyser ces deux réalités comme autant de modes de déploiement d’ennemis systémiques. Pas antisystémiques, mais bien systémiques. Pour trois raisons au moins.
Dans les deux cas, ce qui se construit est l’ennemi parfait dont le pouvoir a besoin pour tenter de se (re)légitimer. Le Pouvoir a toujours besoin d’un Grand Ennemi terrifiant contre lequel il nous promet sa protection. Plus cet ennemi incarne la barbarie absolue, plus le Pouvoir peut prétendre avoir une raison d’être. De sorte qu’aussi bien le crime organisé que l’hyperfondamentalisme religieux, dans la mesure même où ils mettent en scène la violence extrême à laquelle ils ont recours, jouent à la perfection leur rôle de Grand Ennemi (sans pour autant qu’il soit nécessaire de penser que « quelqu’un » leur dicte le scénario qu’ils doivent suivre).
Le rôle que le Pouvoir revendique suppose de réussir à convaincre que lui et ses ennemis représentent des contraires absolus : la civilisation contre la barbarie ; l’État de droit contre l’illégalité ; autrement dit, le Bien contre le Mal. Mais, en réalité, ils sont l’expression du même. Il n’est pas nécessaire d’insister sur la fusion entre État et crime organisé que la nuit d’Iguala a rendu si manifeste. Quant à l’État islamique, il se présente comme la force qui va libérer les musulmans de la domination occidentale, de sa corruption et de son impiété. Cependant, il ressemble beaucoup à ses ennemis proclamés. C’est une entreprise prospère qui, depuis sa mainmise sur les puits de pétrole du nord de l’Irak, bénéficie de revenus de l’ordre d’un million de dollars par jour. Sa fortune globale est estimée à deux milliards de dollars, ce qui lui permet d’entretenir une armée de trente mille hommes [9]. Comme n’importe quelle firme transnationale, Daech publie chaque année, sur papier glacé, un luxueux rapport d’activités, rempli d’élégants graphiques et de statistiques. Sauf qu’ici ces batteries de ressources visuelles sont déployées (par exemple pour 2013) pour détailler 7 681 opérations militaires, parmi lesquelles sont distinguées 4 465 attentats à l’explosif, 537 à la voiture piégée, 160 opérations suicides, sans oublier 1 083 assassinats, etc. Tout cela pour démontrer la bonne santé de l’entreprise État islamique et son professionnalisme, en assumant les codes formels du succès corporatif, afin d’attirer les investissements de généreux hommes d’affaires saoudiens. Daech se présente donc comme la pureté de l’Islam face à l’Occident, mais n’est en fait qu’une expression de plus du monde de l’argent transnationalisé. Dans le même temps, loin de représenter la tyrannie de l’obscurantisme face à laquelle l’économie de marché et les démocraties occidentales ressemblent à un paradis, il est « un produit collatéral barbare de la globalisation capitaliste » (T. Konicz). Ou, peut-être, pas même « collatéral »…
Les forces dont il est question ici sont aussi des ennemis systémiques dans la mesure où elles permettent de canaliser et de neutraliser les énergies d’une jeunesse laissée à l’abandon par le capitalisme néolibéral. C’est le cas du crime organisé, au Mexique et ailleurs, qui utilise ces jeunes comme chair à canon, comme esclaves parfois et aussi comme consommateurs, contribuant aussi à l’essor massif du phénomène des « juvenicides ». C’est le cas de l’État islamique qui, comme d’autres organisations, recrute des djihadistes dans tous les pays arabes, ainsi qu’en Europe, où il attire quelques centaines de jeunes issus de l’immigration (mais aussi quelques convertis de fraîche date à l’islam) qui ne se sentent nullement intégrés, ni par un travail auquel ils n’ont pas accès ni par un mythe républicain plus qu’agonisant. Il est affligeant de voir ces vidéos diffusées par Internet dans lesquels ces jeunes gens, entraînés dans la logique du djihad, menacent les infidèles (et, pour eux, ce terme vise aussi les musulmans qui ne se rallient pas à leurs thèses et ne se réjouissent pas de la mort des chrétiens) : « Tuez-les, égorgez-les. Brûlez leurs voitures, brûlez leurs maisons. Le Califat va s’installer dans toute l’Europe. » Telle est la voie qu’ils adoptent pour tenter de sortir du non-sens d’une survie misérable dans un monde où il n’y a nulle place pour eux, un monde qui les exclut et les méprise. Ce qui est pathétique, c’est que l’impulsion par laquelle ils cherchent à échapper à la négation de leur existence les jette sur un chemin qui n’est pas moins dépourvu de sens, déshumanisant et criminel. À la destruction systémique, ils répondent par une destruction qui en est le reflet et, qui plus est, lui sert à se maintenir. Le plus désolant est de constater qu’ils trouvent, dans cette cause-là, une raison de donner leur vie, ce qu’ils font effectivement, vivant leur geste comme un sacrifice rédempteur, un accès à un semblant d’existence, dans et par la mort.
C’est en cela aussi que le crime organisé et le fondamentalisme religieux dans ses formes les plus extrêmes sont, l’un comme l’autre, des ennemis systémiques. Ils contribuent à faire en sorte que les sources d’une colère légitime, accumulée dans le monde de la destruction qu’est le capitalisme, soient déviées vers des fins systémiques, au lieu de venir fortifier les processus antisystémiques.
Comment parviendrons-nous à combattre l’hydre dans la mesure où ces têtes encore plus terribles [10], qui sont déjà particulièrement menaçantes dans certaines parties du globe comme le Mexique et le Moyen-Orient, se feront de plus en plus grandes ? Il faut revenir à l’hydre elle-même pour avancer dans l’analyse du problème.
Les hydres aussi pleurent…
Il s’agit de déterminer si, en dépit de sa force chaque fois plus destructrice, le monstre ne souffre pas de maladies, visibles ou invisibles, comme celles que d’anciens, ou moins anciens, docteurs, spécialisés en hydropathologie, diagnostiquent comme « contradictions internes » ou « limites » et qui font souffrir l’hydre, peuvent la paralyser et peut-être même provoquer sa mort — mais sur ce dernier point, les avis des savants divergent. Je crois qu’on peut comprendre ce séminaire, qui commence tout juste, comme une invitation à rouvrir, entre nous et avec d’autres, le débat sur la crise, afin d’actualiser, d’affiner et d’approfondir nos analyses, en incluant l’histoire clinique qui a conduit le patient à son état actuel [11].
On pourrait dire, de manière synthétique, que le capitalisme dispose actuellement de trois centres vitaux. Le premier est l’exploitation du travail, qui produit de la valeur à travers la production de biens matériels et de services marchandisés. Le second est l’accumulation par dépossession [12] qui, pour pouvoir exploiter ce qu’on appelle des ressources naturelles, multiplie les attaques contre les territoires, ce qui provoque des résistances croissantes, tant au Mexique (où les peuples indiens sont particulièrement affectés, notamment par l’avancée sans cesse plus agressive des activités minières) qu’en Europe, qu’il s’agisse des ZAD en France ou de la lutte No TAV en Italie — luttes qui s’opposent à des projets d’infrastructures, énergétiques ou touristiques, non seulement inutiles mais aussi et surtout destructeurs et illégitimes.
J’évoquerai surtout le troisième centre vital, celui du capital financier, dont on sait qu’il s’est développé au cours des dernières décennies de manière inédite, au point que les deux autres centres lui sont désormais subordonnés. De fait, il est important de souligner qu’au-delà de la reconfiguration du rôle de l’État (qui combine affaiblissement dans certains domaines et capacité d’action plus décidée dans d’autres), le néolibéralisme a au moins deux caractéristiques fondamentales. La première est la création effective d’un marché mondial, qui instaure de nouvelles conditions de compétition pour les capitalistes eux-mêmes et pour les travailleurs, avec des conséquences désastreuses pour les salaires et les conditions de travail et de vie. La seconde est la mise en place méthodique — et pour bien des aspects, depuis l’État lui-même — des conditions d’une expansion inédite du capital financier, c’est-à-dire de marchandises qui ne sont rien d’autre que des titres de propriété ou des titres de dette [13]. Ce n’est pas le lieu de décrire les invraisemblables mécanismes qui permettent d’amplifier et de soutenir les profits résultant de l’essor du capital fictif. L’un des plus élémentaires et des plus massifs est l’augmentation spectaculaire des dettes des États qui, en trois décennies, sont passées d’une moyenne de l’ordre de vingt pour cent du PIB aux environs de quatre-vingt-dix à cent pour cent de celui-ci, sans parler des cas qui excèdent largement ce taux, non seulement en Grèce mais aussi, notamment, au Japon (deux cent vingt pour cent). Un premier effet de cette situation est de transformer en rente pour les détenteurs du capital une part croissante des budgets publics. Par ailleurs, la conséquence évidente est une dépendance étroite des États vis-à-vis des marchés financiers (d’où, entre autres, le rôle nouveau des agences de notation, qui permet que la moindre des décisions prises par un État, si elle est jugée négativement, peut provoquer une augmentation immédiate des taux d’intérêt et, ainsi, contribuer à étrangler un peu plus encore le pays concerné). Il y a là un puissant mécanisme de domestication, qui tend à rendre impossible toute tentative sérieuse de s’écarter de l’orthodoxie néolibérale.
Pourquoi une expansion aussi disproportionnée du capital financier a-t-elle eu lieu ? Il serait tout à fait insuffisant de considérer que cela n’est dû qu’à l’avarice sans limite et à la frénésie spéculative de quelques banquiers et autres acteurs opérant sur les marchés. Présenter les choses ainsi conduit certains à penser qu’il serait possible de revenir à un capitalisme productif, plus sain, voire de mettre un frein, depuis le pouvoir d’État, à la voracité perverse de la finance. Nombreux sont ceux qui déterminent leur stratégie politique sur cette base. C’est donc un enjeu d’extrême importance que de souligner que l’essor du capital fictif a des raisons plus profondes.
La première est que l’économie capitaliste a un besoin impérieux de croissance. L’hydre est terriblement vorace et ne peut contenir son appétit. La taille de l’économie mondiale a été multipliée par dix au cours du dernier demi-siècle et cette expansion implique une quantité sans cesse croissante de capitaux en quête d’investissement. Bien qu’elle augmente, la production de biens et de services est insuffisante pour absorber des masses d’argent aussi phénoménales. C’est l’une des raisons pour lesquelles le secteur financier s’est développé comme un nouveau champ d’investissement, un indispensable Eldorado pour l’argent en quête de toujours plus d’argent.
Mais cela implique un sérieux problème car la croissance dans le capitalisme n’est pas linéaire mais exponentielle. Pour vivre, l’hydre a besoin de dévorer et de dévorer encore, de croître et de croître sans cesse davantage. Son corps monstrueux est en train de couvrir la totalité de la terre. Ainsi, elle nous étouffe, mais il se peut qu’elle en arrive à s’étouffer elle-même, trouvant de moins en moins aisément de nouveaux terrains à dévaster, de nouveaux horizons vers lesquels croître. Si l’on doit sans doute se méfier — en dépit même de son efficacité — de l’argument selon lequel un système fondé sur une croissance exponentielle dans un monde limité serait, pour cette seule raison, condamné à la mort, on peut prendre en compte le fait que l’une des difficultés les plus sérieuses qui affectent l’hydre est un problème de taille, un problème d’échelle, un problème d’excès.
Par ailleurs, les profits dans le secteur de la production tendent à se réduire. Du fait des innovations technologiques et de l’automatisation de la production, le travail nécessaire pour produire une marchandise se réduit sans cesse, de sorte que la valeur produite diminue, malgré le fait que la production augmente en quantité. De plus, une compétition mondiale féroce réduit toujours plus les marges des entreprises. Les rythmes d’innovation sont sans cesse plus rapides et les cycles de profit plus courts. Et c’est parce que les bénéfices tirés de la production de biens et de services sont tendanciellement insuffisants que d’immenses masses de capitaux n’ont pas d’autre option que de s’orienter vers le secteur financier [14].
Une autre raison encore tient à la contradiction, avivée par les politiques néolibérales, entre un régime de bas salaires et la nécessité de vendre des marchandises en quantité toujours plus abondante. Une solution temporaire a pu être trouvée grâce à l’expansion du crédit, ce qui a également l’avantage d’enclencher un redoutable mécanisme de soumission aux normes capitalistes, sous l’espèce d’un cycle infernal consommation-endettement-travail dans lequel se laissent prendre de plus en plus de familles des classes moyennes et populaires [15]. Mais, pour sophistiqués qu’ils soient, les échafaudages du crédit demeurent fragiles. Ce sont eux, précisément, qui ont commencé à se rompre durant la crise de 2008-2009, dont les États-Unis ont été l’épicentre et dont l’ampleur était restée inconnue depuis celle de 1929-1933. Sa propagation a néanmoins pu être jugulée par l’intervention rapide des principaux États, moyennant des plans de sauvegarde des banques et des grandes entreprises ayant atteint plusieurs centaines de milliards de dollars dans chaque pays. Cette réaction a été efficace, mais la crise n’a pris fin qu’en apparence. Non seulement rien n’a été fait, ou presque, pour remédier aux causes fondamentales de la crise (notamment pour réintroduire des formes de régulation des flux financiers), mais au contraire, les mesures prises n’ont fait qu’amplifier ces causes, en premier lieu en élevant encore le niveau d’endettement des États. En outre, de nouveaux fronts ont dû être ouverts pour soutenir l’expansion du capital fictif, en particulier à travers le rachat massif de dettes souveraines et de titres toxiques par les banques centrales, ce qui tend à affaiblir significativement les instances qui régissent le système de l’argent. Préserver la confiance dans le système financier est une tâche de plus en plus difficile et si les bons du Trésor états-uniens continuent de trouver des acquéreurs ce n’est pas tant parce qu’ils suscitent la confiance qu’en raison de l’obligation dans laquelle se trouvent ceux qui en détiennent (en premier lieu la Banque centrale chinoise) d’éviter leur brutale dévalorisation. Mais, jusqu’à quand ?
L’étape suivante de l’implosion du système financier peut se produire à tout moment. En 2008-2009, les États ont réussi à déployer des mesures efficaces, mais il s’agissait d’une arme à un seul tir, qui ne peut se répéter, dans la mesure où les déséquilibres structurels sont désormais plus sévères encore et mettent en danger la solvabilité des États eux-mêmes. Le scénario d’une extension de la crise du secteur financier vers le secteur productif, qui a été sur le point de se produire en 2008-2009, serait désormais difficile à éviter et les effets en chaîne pourraient atteindre des proportions imprévisibles. Il y aura certainement des tentatives de la part des États et des institutions internationales pour s’opposer à ces tendances et il est possible qu’ils y parviennent en partie, de sorte qu’il faut moins imaginer un effondrement se produisant d’un coup et partout à la fois qu’une série d’affaissements partiels et successifs.
Un point encore : les trois centres vitaux du capitalisme — l’exploitation du travail, l’accumulation par dépossession et l’expansion du capital financier — ont chacun leurs maladies spécifiques. Chacune peut, en elle-même, être curable, mais, dans la mesure où elles se combinent, les difficultés peuvent devenir considérables, à plus forte raison si on prend en compte la dévastation écologique et les effets du réchauffement climatique qui constitueront une dimension de plus en plus déterminante de l’état de fait, au cours des prochaines décennies. Toutefois, si le diagnostic des trois centres vitaux déjà mentionnés indique des problèmes aigus, il existe un quatrième centre vital qui, pour sa part, jouit d’une parfaite santé. C’est celui du capitalisme criminel-criminel, qui autorise des taux de profit remarquables et ne semble pas rencontrer d’autre limite que celle de la destruction totale de la vie.
Dès lors, il n’est pas exclu de se retrouver face au scénario suivant. Trois processus fondamentaux pourraient caractériser une possible transition systémique. D’un côté, iraient s’accentuant les difficultés que le capitalisme rencontre dans sa reproduction, provoquant le blocage progressif de pans entiers du système financier et productif. De l’autre, les options de vie autonomes dont il sera question dans la partie suivante parviendrait à se développer dans des espaces libérés, ou abandonnés à leur sort par la décomposition systémique. Non sans en passer par des phases d’intensification de la conflictualité, ce second processus pourrait tirer parti du premier, tout en participant à son accélération. Mais, en même temps, la situation pourrait être mise à profit par les forces du capitalisme criminel-criminel, sur la base de formes de violence extrême et de relations de production néo-esclavagistes. Les groupes du crime organisé, comme le fascisme ouvert ou déguisé sous des allures religieuses, sont suffisamment armés pour étendre leur contrôle territorial à travers la terreur et pour s’emparer des ressources naturelles et des moyens de production, ainsi qu’ils ont commencé à le faire. Alors, l’affrontement serait entre eux, si bien entraînés à une cruauté sans limite, et nous qui, pour une bonne part, sommes si désorganisés et si enclins aux bons sentiments…
La perspective n’a rien de rassurant, mais elle n’est pas non plus désespérée. Est-il tout à fait impossible de l’emporter sur les forces du capital criminel-criminel ? Non. Des exemples démontrent que l’organisation collective des peuples peut parvenir à leur résister, voire à leur disputer des espaces. C’est, au Mexique, le cas de la police communautaire du Guerrero, comme celui de la commune autonome de Cherán (Michoacán). C’est le cas de la lutte du peuple kurde contre l’État islamique, notamment avec la résistance victorieuse de la ville de Kobané.
C’est peut-être pourquoi le Mexique et le Kurdistan sont deux exemples particulièrement significatifs pour comprendre la tempête qui s’approche. Mais aussi pour comprendre les options et les espoirs qui sont nôtres.
Nos options face à l’hydre
Face à l’hydre capitaliste, nous ne pouvons pas nous contenter de penser comment nous débarrasser d’elle. Il est également indispensable de nous préoccuper de ce que nous voulons construire. Outre les NON de ce que nous rejetons, sont tout aussi importants les OUI des mondes auxquels nous voulons donner consistance, ainsi que l’a souligné l’EZLN au moment d’annoncer, dans les premiers mois de 2013, une nouvelle étape de sa lutte [16]. De fait, on ne saurait perdre de vue le lien entre ces deux versants de la lutte, car si les menaces présentes et à venir obligent à concentrer l’attention sur l’hydre elle-même et les NON qu’on lui oppose et qui permette de résister à ses avancées, les OUI font partie de ce qui donne sens, cœur et énergie à la lutte contre le monstre.
Dans cette perspective affirmative, et encore trop peu visible selon certains, il nous faut faire valoir que nous avons une option propre, qui est résolument anticapitaliste et ne se centre pas sur l’État, c’est-à-dire une option qui lutte pour construire un monde libéré de la barbarie capitaliste, de la dépossession provoquée par l’État, des relations patriarcales et de toute autre forme de domination. Nous avons déjà commencé à récupérer et à donner forme à un imaginaire alternatif, et sans doute vaudrait-il la peine d’œuvrer à le faire savoir davantage. On peut suggérer au moins quatre caractéristiques de cet imaginaire alternatif : a) il est réel, et ses prémices peuvent être éprouvées notamment dans les territoires rebelles zapatistes, même s’il est important, comme l’a souligné ici même le sous-commandant Moisés, de ne pas idéaliser la lutte zapatiste ; b) cet imaginaire est suffisamment différent, dans ses principes, des expériences qui, durant le vingtième siècle, ont conduit les désirs de libération vers de nouvelles formes d’oppression, pour qu’on puisse récuser de manière argumentée la prétention à faire mourir tout projet d’émancipation en 1989 ; c) cet imaginaire alternatif entre en résonance avec d’autres expériences historiques révolutionnaires, comme la Commune de Paris, les conseils ouvriers et paysans en Russie et dans d’autres pays européens, la révolution en Catalogne et Aragon, en 1936-1937, de sorte qu’il revitalise des traditions présentes sur plusieurs continents ; d) cette option est hautement désirable.
Cet imaginaire alternatif qui émerge des pratiques collectives peut se décliner de diverses manières. Je choisirai d’insister brièvement sur trois dimensions [17]. La première est l’autonomie comme principe politique, c’est-à-dire l’invention permanente de formes non étatiques d’organisation politique, dont l’enjeu est d’éviter la reproduction d’une dissociation entre gouvernants et gouvernés. Mais encore faut-il préciser qu’une telle logique d’autogouvernement ne vise pas à gérer par nous-mêmes la réalité systémique produite par l’hydre mais n’a de sens que si elle a pour objet d’organiser les formes de vie qui sont les nôtres, celles que les collectifs d’habitants adoptent hors des impositions du monde de la marchandise. En second lieu, l’élimination de la logique capitaliste implique de nous libérer du productivisme compulsif auquel la nécessité de la valorisation du capital soumet actuellement la planète. Cela implique, de manière plus générale, de nous libérer de l’Économie, c’est-à-dire de la centralité que l’Économie a acquise avec le capitalisme (ce qui fait de ce dernier une aberrante anomalie historique). Il s’agit ici de réintégrer les activités productives dans le tissu de la vie sociale, de les subordonner à la construction du bien vivre pour toutes et tous, dans le respect de la Terre Mère et, concrètement, de les soumettre à des décisions élaborées et assumées collectivement. En troisième lieu, dans la mesure où l’autonomie ne peut se construire qu’à partir de la singularité des lieux, des territoires, des cultures, des expériences et des mémoires, elle donne naissance nécessairement à une multiplicité de mondes, à « un monde où il y ait place pour de nombreux mondes ». Cela implique d’être capable de construire collectivement dans la pleine reconnaissance des différences qui constituent cette multiplicité. Ce principe s’avère vital et implique une autre manière de faire, tant au niveau de l’organisation politique, qui peut être conçue comme une coordination ou une confédération d’entités locales autonomes, qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Dans tous les cas, la reconnaissance effective des différences est importante non seulement quand il s’agit de différences modestes, qui nous affectent peu, mais surtout quand il s’agit de différences véritables, c’est-à-dire véritablement différentes, qui peuvent provoquer en nous de l’irritation ou de l’incompréhension.
L’option que nous pouvons choisir de défendre part de la conclusion qu’il est (devenu) vain de tenter de subvertir le capitalisme à partir de ses propres institutions et que les stratégies « graduelles », pour réalistes qu’elles puissent paraître, finissent par épuiser les énergies à des fins qui, en réalité, contribuent à assurer un peu de légitimité au système actuel et, quand bien même il serait possible d’admettre qu’elles obtiennent, dans quelques cas exceptionnels, quelques améliorations au bénéfice de la population, en aucun cas celles-ci ne sont à la hauteur des enjeux du moment historique ni ne nous rapproche d’un iota d’une sortie du désastre capitaliste. C’est pourquoi notre option consiste à construire, ici et maintenant, ce que nous pouvons considérer comme nôtre, ce qui, aussi petit, limité et imparfait soit-il, peut être reconnu comme véritablement nôtre [18]. On peut nommer cela brèche, territoires autonomes, espaces libérés, zone à défendre, commune ou comme on voudra. Il s’agit de récupérer ou de créer des espaces, territorialisés ou non, matériels, relationnels et intérieurs, depuis les plus modestes jusqu’aux plus amples. Notre option stratégique consiste à faire tout notre possible, à engager toute notre énergie pour que ces espaces, ces brèches dans le mode d’existence imposé par la domination capitaliste ne se referment pas et, au contraire, s’étendent, se multiplient, se rencontrent, échangent et s’épaulent dans la lutte contre l’ennemi commun.
Ces espaces ne peuvent pas être considérés comme des îles protégées au milieu du désastre généralisé. Ce sont bien plutôt des espaces antagoniques, attaqués de mille manières afin d’être réabsorbés par l’hydre capitaliste. C’est l’une de ces attaques, que les zapatistes ne cessent d’affronter depuis plus de vingt ans, qui a couté la vie au maestro Galeano, le 2 mai 2014, à La Realidad. Les zapatistes ne cessent de nous expliquer qu’il n’est pas possible de séparer la résistance (pour eux, la construction d’une autre réalité) et la rébellion (l’opposition aux diktats du capitalisme), qu’il est de leur responsabilité de se défendre et de résister aux provocations (agressions violentes de la part d’organisations hostiles et de groupes paramilitaires), en même temps que la construction de l’autonomie continue de se fortifier. Mais les espaces libérés sont antagoniques également parce qu’ils ne peuvent continuer à exister et à croître sans chercher comment avancer dans le combat contre l’hydre. De telle sorte que l’option consiste à construire ce qui est nôtre, c’est-à-dire les mille manières de concevoir nos mondes, et, à partir de là, continuer à attaquer l’hydre, puisque l’objectif n’est autre, comme le sous-commandant Galeano l’a rappelé dans la convocation à ce séminaire, que de « détruire le système capitaliste ».
La dimension des espaces libérés qu’il est possible de déployer dépend de la force collective que nous sommes capables de construire. Il n’est pas inutile de rappeler que la brèche zapatiste n’a pu être ouverte que sur la base d’un soulèvement armé et, donc, de l’effort d’organisation préalable que cela a supposé durant une décennie et davantage encore (même si le sous-commandant Moisés a souligné que, désormais, cette brèche ne peut continuer à croître que sur la base d’une forme de résistance qui implique de ne pas répondre de manière armée aux agressions, pour brutales qu’elles puissent être). Dans d’autres contextes, il semble que notre option consiste à multiplier les collectifs de tous types, les organisations de communautés, de villages, de communes, de régions, en même temps que les convergences pour empêcher de nouvelles matérialisations spécifiques de la marchandisation du monde. C’est indispensable, et il est certainement nécessaire de maintenir et d’approfondir les efforts en ce sens ; mais peut-être les collectifs engagés dans de telles démarches commencent-ils à éprouver qu’ils sont en partie insuffisants. Peut-être la lutte contre l’hydre implique-t-elle de prendre la mesure du monstre dans sa globalité, de cerner la diversité des têtes qui concourent à la domination capitaliste. Peut-être est-il nécessaire d’envisager la possibilité de concerter des actions simultanées, en de multiples endroits à la fois. Cela n’implique en rien une organisation unique et centralisée, ni non plus qu’une action simultanée doive être pensée depuis un seul lieu. Cela implique bien plutôt de construire patiemment les conditions d’une connaissance mutuelle afin de favoriser, le moment venu, l’extension de processus dans lesquels puissent émerger et prévaloir, au milieu de multiples difficultés, un vocabulaire en partie partagé, un sens de la fraternité et de la confiance, une capacité à faire ensemble.
Quand, au milieu de la tourmente qui vient, des mouvements de lutte et des soulèvements de plus en plus nombreux éclateront, nous partagerons tous la responsabilité collective de ne pas laisser passer cette opportunité, de faire en sorte que nous ne soyons pas vaincus par nos ennemis les plus visibles, mais pas davantage par nous-mêmes, soit parce que nous serions incapables de surmonter nos tendances à la division, soit parce que nous laisserions l’impulsion transformatrice être déviée vers des objectifs secondaires ou vers la reproduction des formes de domination dont il s’agit de se libérer. Nous préparer dans cette perspective n’est pas une tâche aisée ; et c’est peut-être à cela aussi que nous invite l’avis de tempête que nous transmettent les zapatistes. Ce qui vient sera probablement la dernière opportunité historique pour libérer la planète Terre de la barbarie et de la destruction.
Pour terminer, je vais me risquer à évoquer la Sexta, comme projet de maillage planétaire des résistances et des rébellions (laquelle, bien entendu, ne prétend nullement être le seul projet de ce type). Si elle remonte à la Sixième Déclaration de la forêt Lacandone, la Sexta a commencé à être nommée de cette manière dans les communiqués du début de l’année 2013, qui ont esquissé les traits de sa nouvelle modalité [19]. La Sexta existe parce qu’existent les organisations, collectifs et individus qui la conformons. Elle existe à travers les initiatives que ceux-ci assument au Mexique et dans d’autres parties du monde, principalement sur le continent américain et en Europe. Par exemple, c’est principalement à la Sexta que s’adresse l’initiative du présent séminaire.
Ma sensation toute personnelle est que, peut-être, la Sexta a réellement commencé à exister ce 2 mai, à Oventic, lorsque Mariano, l’un des enfants du maestro Galeano nous a expliqué que son père lui avait laissé trois familles : sa famille de sang, l’EZLN et… la Sexta. De sorte que la question est : comment ferons-nous, et que ferons-nous, pour correspondre un tant soit peu aux espérances du maestro Galeano ? Peut-être est-ce le moment de commencer à faire exister la Sexta au-delà de ce qu’elle est jusqu’à présent (nous ne savons qu’une chose à ce sujet, qu’il s’agit de cheminer en questionnant). Il pourrait être pertinent de rendre plus visible notre option et de poursuivre la construction de notre force planétaire, la seule qui, à partir de ses milliers d’inscriptions locales particulières, pourra vaincre l’hydre. Il s’agit de continuer à nous rencontrer, à nous connaître, à échanger et à inventer des techniques de chasse contre le monstre (et n’oublions pas : cautériser après avoir coupé).
J’avais une autre fin (avec même des citations bibliographiques), mais je préfère terminer par ces mots : Mariano, puissions-nous un jour être dignes, en tant que Sexta, de ce que tu nous as dit, le 2 mai, à Oventic.
Jérôme Baschet
[2] Sous-commandant Marcos, « La quatrième guerre mondiale a commencé », Le Monde diplomatique, août 1997.
[3] Comité invisible, À nos amis, Paris, La Fabrique, 2014.
[4] Pour le cas du Guerrero, voir CDAM-Che Guevara, « Ayotzinapa en la ruta de la barbarie del patrón de acumulación de capital en México ».
[5] Petar Stanchev, « From Chiapas to Rojava. More than just coincidences ».
[6] Voir par exemple Pierre-Jean Luizard, Le Piège Daech. L’État islamique ou le retour de l’Histoire, Paris, La Découverte, 2015.
[7] Voir Leila Al Shami, « Some thoughts on Siria » (31 avril 2015), Quelques pensées sur la Syrie.
[8] L’usage médiatique qui en est fait invite à se défier de la notion de fondamentalisme. Elle peut néanmoins être utilisée, pour peu que l’on précise que les phénomènes qu’elle recouvre diffèrent de ce qu’on peut appeler la religion en général. Il faut encore préciser que ce que l’on évoque ici constitue une forme ultraminoritaire de l’islam et qu’il existe aussi un fondamentalisme chrétien, un fondamentalisme juif et même un fondamentalisme athée. Tandis que la radicalité vise les racines des problèmes pour rechercher une multiplicité possible de solutions, le fondamentalisme affirme qu’il existe un seul fondement, ce qui autorise à nier ou à éliminer ceux qui ne se soumettent pas au principe en question.
[9] Voir Tomasz Konicz, « État islamique Inc. ».
[10] Une autre est celle de l’autoritarisme raciste de l’extrême droite. En Europe, il forme avec le fondamentalisme islamique un couple de phénomènes qui se répondent et s’entretiennent mutuellement.
[11] Plusieurs débats restent ouverts. S’il est impossible de les aborder ici, il conviendrait d’éviter deux postures extrêmes. La première considère que la crise économique n’est rien d’autre qu’un discours, un outil de gouvernance utilisé pour imposer davantage de contraintes (mais l’évidente instrumentalisation de la crise, à des fins de justification des politiques néolibérales, n’implique nullement que celle-ci n’ait aucune existence réelle). La seconde implique une lecture trop immédiate et déterministe de la thèse de la crise structurelle du capitalisme (alors que celle-ci n’adopte pas la perspective d’un effondrement rapide, mais celle d’une bifurcation inscrite dans le moyen terme). D’autre part, il faudrait distinguer dans nos analyses ce qui se réfère à LEUR crise et ce qui concerne la crise qu’ils provoquent en NOUS. Les deux dimensions peuvent s’entremêler et sont également importantes, mais de manières différentes. Si le second aspect est, ou devrait être, une raison de lutter contre la bête, seul le premier relève des faiblesses de l’ennemi.
[12] David Harvey, Géographie de la domination, Les Prairies ordinaires, Paris, 2008.
[13] Pour l’analyse du capital fictif et des processus qui ont conduit à sa prédominance actuelle sur l’économie productive, voir Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, La Grande Dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette de l’État ne sont pas les causes de la crise, Post-Editions, 2014.
[14] Lohoff et Trenkle, ibid.
[15] Voir Anselm Jappe, Crédit à mort. La décomposition du capitalisme et ses critiques, Lignes, Paris, 2011.
[16] Voir sous-commandants Marcos et Moisés, Eux et nous, Paris, Éditions de l’Escargot, 2013, ainsi que Eux et nous V. La Sexta.
[17] Pour plus de détails sur les options avancées ici, J. Baschet, Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014.
[18] Ce « nôtre » n’est pas défini de manière abstraite, universelle ; il est ce que chaque collectif, chaque communauté assume en affirmant « ceci est ce que nous éprouvons comme nôtre » (sans que cela implique nulle exclusivité identitaire, nulle fermeture aux autres).
[19] Voir note 16.
œuvre du compositeur estonien Arvo PÄRT écrite en 1977.
(pour l’écouter à l’intégralité ici)
Ci-dessous, la musique apparaît entrecoupée dans la vidéo des extraits de la danse de Miguel ROBLES:
no semillero
¿Reformar el capitalismo o salir de él? Un texto de John Holloway, autor de Cambiar el mundo sin tomar el poder, leído en un encuentro del EZLN.
Interferencias – propone un texto de John Holloway
http://www.eldiario.es/interferencias/Pensamiento-Critico-frente-Hidra-Capitalista_6_400419971.html
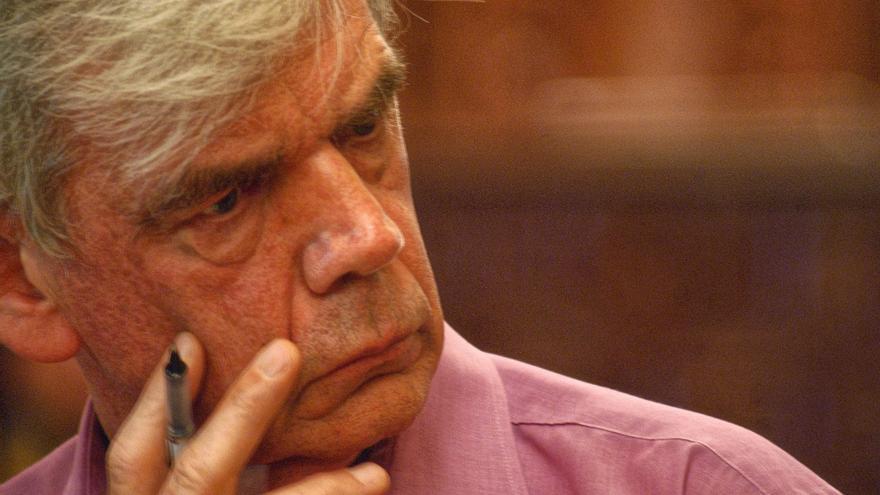
John Holloway (foto: David Ortega)
Pensamiento crítico: pensamiento que busca la esperanza en un mundo donde parece que ya no existe. Pensamiento crítico: pensamiento que abre lo cerrado, que sacude lo fijo. El pensamiento crítico es el intento de entender la tormenta y algo más. Es entender que en el centro de la tormenta hay algo que nos da esperanza.
La tormenta viene, o más bien ya está aquí. Ya está aquí y es muy probable que se vaya intensificando. Tenemos un nombre para esta tormenta que ya está aquí: Ayotzinapa. Ayotzinapa como horror, y también como símbolo de tantos otros horrores. Ayotzinapa como expresión concentrada de la cuarta guerra mundial.
¿De dónde viene la tormenta? No de los políticos –son ejecutores de la tormenta nada más. No del imperialismo, no es producto de los Estados, ni de los Estados más poderosos. La tormenta surge de la forma en la cual la sociedad está organizada. Es expresión de la desesperación, de la fragilidad, de la debilidad de una forma de organización social que ya pasó su fecha de caducidad, es expresión de la crisis del capital.
El capital es de por sí una agresión constante. Es una agresión que nos dice todos los días “tienes que moldear lo que haces de cierta forma, la única actividad que tiene validez en esta sociedad es la actividad que aporta a la expansión de la ganancia del capital”.
La agresión que es el capital tiene una dinámica. Para sobrevivir tiene que subordinar nuestra actividad cada día más intensamente a la lógica de la ganancia: “hoy tienes que trabajar más rápidamente que ayer, hoy tienes que agacharte más que ayer”.
Con eso ya podemos ver la debilidad del capital. Depende de nosotros, de que queramos y podamos aceptar lo que nos impone. Si decimos “perdón, pero hoy voy a cultivar mi milpa”, u “hoy voy a jugar con mis hijos”, u “hoy me voy a dedicar a algo que tenga sentido para mí”, o simplemente “no, nos vamos a agachar”, entonces el capital no puede sacar la ganancia que requiere, la tasa de ganancia cae, el capital está en crisis. En otras palabras, nosotros somos la crisis del capital, nuestra falta de subordinación, nuestra dignidad, nuestra humanidad. Nosotros somos la crisis del capital y orgullosos de serlo, estamos orgullosos de ser la crisis del sistema que nos está matando.
El capital se desespera en esta situación. Busca todos los métodos posibles para imponer la subordinación que requiere: el autoritarismo, la violencia, la reforma laboral, la reforma educativa. También introduce un juego, una ficción: si no podemos sacar la ganancia que requerimos, vamos a fingir que existe, vamos a crear una representación monetaria para un valor que no se ha producido, vamos a expandir la deuda para sobrevivir y tratar de usarla al mismo tiempo para imponer la disciplina que se requiere. Pero esta ficción aumenta la inestabilidad del capital y además no logra imponer la disciplina necesaria. Los peligros para el capital de esta expansión ficticia se vuelven claros con el colapso de 2008, y con eso se hace más evidente que la única salida para el capital es a través del autoritarismo: toda la negociación alrededor de la deuda griega nos dice que no hay posibilidad de un capitalismo más suave, el único camino para el capital es el camino de la austeridad, de la violencia. La tormenta que ya está, la tormenta que viene.
Nosotros somos la crisis del capital, nosotros que decimos ¡No!, nosotros que decimos ¡Ya basta del capitalismo!, nosotros que decimos que es tiempo de dejar de crear el capital, que hay que crear otra forma de vivir.
El capital depende de nosotros, porque si nosotros no creamos ganancia (plusvalor) directa o indirectamente, entonces el capital no puede existir. Nosotros creamos el capital, y si el capital está en crisis, es porque no estamos creando la ganancia necesaria para la existencia del capital, por eso nos están atacando con tanta violencia.
En esta situación, realmente tenemos dos opciones de lucha. Podemos decir: “sí, de acuerdo, vamos a seguir produciendo el capital, promoviendo la acumulación de capital, pero queremos mejores condiciones de vida”. Esta es la opción de los gobiernos y partidos de izquierda: de Syriza, de Podemos, de los gobiernos en Venezuela y Bolivia. El problema es que, aunque sí pueden mejorar las condiciones de vida en algunos aspectos, por la desesperación misma del capital existe muy poca posibilidad de un capitalismo más humano.
La otra posibilidad es decir “Chao, capital, ya vete, vamos a crear otras maneras de vivir, otras maneras de relacionarnos, entre nosotros y también con las formas no humanas de vida, maneras de vivir que no están determinadas por el dinero y la búsqueda de la ganancia, sino por nuestras propias decisiones colectivas”.
Aquí en este seminario estamos en el mero centro de esta segunda opción. Este es el punto de encuentro entre zapatistas y kurdos y miles de movimientos más que rechazamos el capitalismo, tratando de construir algo diferente. Todas y todos estamos diciendo “Ya, capital, ya pasó tu tiempo, ya vete, ya estamos construyendo otra cosa”. Lo expresamos de muchas maneras diferentes: estamos creando grietas en el muro del capital y tratando de promover su confluencia, estamos construyendo lo común, estamos comunizando, somos el movimiento del hacer contra el trabajo, somos el movimiento del valor de uso contra el valor, somos el movimiento de la dignidad contra un mundo basado en la humillación. Estamos creando aquí y ahora un mundo de muchos mundos.
Pero ¿tenemos la fuerza suficiente? ¿Tenemos la fuerza suficiente para decir que no nos interesa la inversión capitalista, que no nos interesa el empleo capitalista? ¿Tenemos la fuerza para rechazar totalmente nuestra dependencia actual del capital para sobrevivir? ¿Tenemos la fuerza para decir un “adiós” final al capital?
Posiblemente no la tenemos, todavía. Muchos de nosotros que estamos aquí tenemos nuestros sueldos o nuestras becas que vienen de la acumulación del capital o, si no, vamos a regresar la semana próxima a buscar empleo capitalista. Nuestro rechazo al capital es un rechazo esquizofrénico: queremos decirle un adiós tajante y no podemos o nos cuesta mucho trabajo. No existe pureza en esta lucha. La lucha para dejar de crear el capital es también una lucha contra nuestra dependencia del capital. Es decir, es una lucha para emancipar nuestras capacidades creativas, nuestra fuerza para producir, nuestras fuerzas productivas.
En eso estamos, por eso venimos acá. Es cuestión de organizarnos, claro, pero no de crear una Organización, sino de organizarnos de múltiples maneras para vivir desde ahora los mundos que queremos crear.
¿Cómo avanzamos, cómo caminamos? Preguntando, por supuesto, preguntando y abrazándonos y organizándonos.
§
John Holloway es profesor del posgrado de sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autor de Cambiar el mundo sin tomar el poder y Agrietar el capitalismo. Este es el texto de la ponencia presentada al Seminario sobre « El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista », organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, San Cristóbal de las Casas, del 3 al 9 de mayo de 2015. Publicado en este blog con la amable autorización del autor.
LE MONDE | 18.12.2009 à 15h21 | Propos recueillis par Propos recueillis par Isabelle Mandraud et Caroline Monnot
Voici les réponses aux questions que nous avons posées par écrit à Julien Coupat. Mis en examen le 15 novembre 2008 pour « terrorisme » avec huit autres personnes interpellées à Tarnac (Corrèze) et Paris, il est soupçonné d’avoir saboté des caténaires SNCF. Il est le dernier à être toujours incarcéré. (Il a demandé que certains mots soient en italique.)
Comment vivez-vous votre détention ?
Très bien merci. Tractions, course à pied, lecture.
Pouvez-nous nous rappeler les circonstances de votre arrestation ?
Une bande de jeunes cagoulés et armés jusqu’aux dents s’est introduite chez nous par effraction. Ils nous ont menacés, menottés, et emmenés non sans avoir préalablement tout fracassé. Ils nous ont enlevés à bord de puissants bolides roulant à plus de 170 km/h en moyenne sur les autoroutes. Dans leurs conversations, revenait souvent un certain M. Marion [ancien patron de la police antiterroriste] dont les exploits virils les amusaient beaucoup comme celui consistant à gifler dans la bonne humeur un de ses collègues au beau milieu d’un pot de départ. Ils nous ont séquestrés pendant quatre jours dans une de leurs « prisons du peuple » en nous assommant de questions où l’absurde le disputait à l’obscène.
Celui qui semblait être le cerveau de l’opération s’excusait vaguement de tout ce cirque expliquant que c’était de la faute des « services », là-haut, où s’agitaient toutes sortes de gens qui nous en voulaient beaucoup. A ce jour, mes ravisseurs courent toujours. Certains faits divers récents attesteraient même qu’ils continuent de sévir en toute impunité.
Les sabotages sur les caténaires SNCF en France ont été revendiqués en Allemagne. Qu’en dites-vous?
Au moment de notre arrestation, la police française est déjà en possession du communiqué qui revendique, outre les sabotages qu’elle voudrait nous attribuer, d’autres attaques survenues simultanément en Allemagne. Ce tract présente de nombreux inconvénients : il est posté depuis Hanovre, rédigé en allemand et envoyé à des journaux d’outre-Rhin exclusivement, mais surtout il ne cadre pas avec la fable médiatique sur notre compte, celle du petit noyau de fanatiques portant l’attaque au cœur de l’Etat en accrochant trois bouts de fer sur des caténaires. On aura, dès lors, bien soin de ne pas trop mentionner ce communiqué, ni dans la procédure, ni dans le mensonge public.
Il est vrai que le sabotage des lignes de train y perd beaucoup de son aura de mystère : il s’agissait simplement de protester contre le transport vers l’Allemagne par voie ferroviaire de déchets nucléaires ultraradioactifs et de dénoncer au passage la grande arnaque de « la crise ». Le communiqué se conclut par un très SNCF « nous remercions les voyageurs des trains concernés de leur compréhension ». Quel tact, tout de même, chez ces « terroristes »!
Vous reconnaissez-vous dans les qualifications de « mouvance anarcho-autonome » et d' »ultragauche »?
Laissez-moi reprendre d’un peu haut. Nous vivons actuellement, en France, la fin d’une période de gel historique dont l’acte fondateur fut l’accord passé entre gaullistes et staliniens en 1945 pour désarmer le peuple sous prétexte d' »éviter une guerre civile ». Les termes de ce pacte pourraient se formuler ainsi pour faire vite : tandis que la droite renonçait à ses accents ouvertement fascistes, la gauche abandonnait entre soi toute perspective sérieuse de révolution. L’avantage dont joue et jouit, depuis quatre ans, la clique sarkozyste, est d’avoir pris l’initiative, unilatéralement, de rompre ce pacte en renouant « sans complexe » avec les classiques de la réaction pure – sur les fous, la religion, l’Occident, l’Afrique, le travail, l’histoire de France, ou l’identité nationale.
Face à ce pouvoir en guerre qui ose penser stratégiquement et partager le monde en amis, ennemis et quantités négligeables, la gauche reste tétanisée. Elle est trop lâche, trop compromise, et pour tout dire, trop discréditée pour opposer la moindre résistance à un pouvoir qu’elle n’ose pas, elle, traiter en ennemi et qui lui ravit un à un les plus malins d’entre ses éléments. Quant à l’extrême gauche à-la-Besancenot, quels que soient ses scores électoraux, et même sortie de l’état groupusculaire où elle végète depuis toujours, elle n’a pas de perspective plus désirable à offrir que la grisaille soviétique à peine retouchée sur Photoshop. Son destin est de décevoir.
Dans la sphère de la représentation politique, le pouvoir en place n’a donc rien à craindre, de personne. Et ce ne sont certainement pas les bureaucraties syndicales, plus vendues que jamais, qui vont l’importuner, elles qui depuis deux ans dansent avec le gouvernement un ballet si obscène. Dans ces conditions, la seule force qui soit à même de faire pièce au gang sarkozyste, son seul ennemi réel dans ce pays, c’est la rue, la rue et ses vieux penchants révolutionnaires. Elle seule, en fait, dans les émeutes qui ont suivi le second tour du rituel plébiscitaire de mai 2007, a su se hisser un instant à la hauteur de la situation. Elle seule, aux Antilles ou dans les récentes occupations d’entreprises ou de facs, a su faire entendre une autre parole.
Cette analyse sommaire du théâtre des opérations a dû s’imposer assez tôt puisque les renseignements généraux faisaient paraître dès juin 2007, sous la plume de journalistes aux ordres (et notamment dans Le Monde) les premiers articles dévoilant le terrible péril que feraient peser sur toute vie sociale les « anarcho-autonomes ». On leur prêtait, pour commencer, l’organisation des émeutes spontanées, qui ont, dans tant de villes, salué le « triomphe électoral » du nouveau président.
Avec cette fable des « anarcho-autonomes », on a dessiné le profil de la menace auquel la ministre de l’intérieur s’est docilement employée, d’arrestations ciblées en rafles médiatiques, à donner un peu de chair et quelques visages. Quand on ne parvient plus à contenir ce qui déborde, on peut encore lui assigner une case et l’y incarcérer. Or celle de « casseur » où se croisent désormais pêle-mêle les ouvriers de Clairoix, les gamins de cités, les étudiants bloqueurs et les manifestants des contre-sommets, certes toujours efficace dans la gestion courante de la pacification sociale, permet de criminaliser des actes, non des existences. Et il est bien dans l’intention du nouveau pouvoir de s’attaquer à l’ennemi, en tant que tel, sans attendre qu’il s’exprime. Telle est la vocation des nouvelles catégories de la répression.
Il importe peu, finalement, qu’il ne se trouve personne en France pour se reconnaître « anarcho-autonome » ni que l’ultra-gauche soit un courant politique qui eut son heure de gloire dans les années 1920 et qui n’a, par la suite, jamais produit autre chose que d’inoffensifs volumes de marxologie. Au reste, la récente fortune du terme « ultragauche » qui a permis à certains journalistes pressés de cataloguer sans coup férir les émeutiers grecs de décembre dernier doit beaucoup au fait que nul ne sache ce que fut l’ultragauche, ni même qu’elle ait jamais existé.
A ce point, et en prévision des débordements qui ne peuvent que se systématiser face aux provocations d’une oligarchie mondiale et française aux abois, l’utilité policière de ces catégories ne devrait bientôt plus souffrir de débats. On ne saurait prédire, cependant, lequel d' »anarcho-autonome » ou d' »ultragauche » emportera finalement les faveurs du Spectacle, afin de reléguer dans l’inexplicable une révolte que tout justifie.
La police vous considère comme le chef d’un groupe sur le point de basculer dans le terrorisme. Qu’en pensez-vous?
Une si pathétique allégation ne peut être le fait que d’un régime sur le point de basculer dans le néant.
Que signifie pour vous le mot terrorisme?
Rien ne permet d’expliquer que le département du renseignement et de la sécurité algérien suspecté d’avoir orchestré, au su de la DST, la vague d’attentats de 1995 ne soit pas classé parmi les organisations terroristes internationales. Rien ne permet d’expliquer non plus la soudaine transmutation du « terroriste » en héros à la Libération, en partenaire fréquentable pour les accords d’Evian, en policier irakien ou en « taliban modéré » de nos jours, au gré des derniers revirements de la doctrine stratégique américaine.
Rien, sinon la souveraineté. Est souverain, en ce monde, qui désigne le terroriste. Qui refuse d’avoir part à cette souveraineté se gardera bien de répondre à votre question. Qui en convoitera quelques miettes s’exécutera avec promptitude. Qui n’étouffe pas de mauvaise foi trouvera un peu instructif le cas de ces deux ex – « terroristes » devenus l’un premier ministre d’Israël, l’autre président de l’Autorité palestinienne, et ayant tous deux reçus, pour comble, le Prix Nobel de la paix.
Le flou qui entoure la qualification de « terrorisme », l’impossibilité manifeste de le définir ne tiennent pas à quelque provisoire lacune de la législation française : ils sont au principe de cette chose que l’on peut, elle, très bien définir : l’antiterrorisme dont ils forment plutôt la condition de fonctionnement. L’antiterrorisme est une technique de gouvernement qui plonge ses racines dans le vieil art de la contre-insurrection, de la guerre dite « psychologique », pour rester poli.
L’antiterrorisme, contrairement à ce que voudrait insinuer le terme, n’est pas un moyen de lutter contre le terrorisme, c’est la méthode par quoi l’on produit, positivement, l’ennemi politique en tant que terroriste. Il s’agit, par tout un luxe de provocations, d’infiltrations, de surveillance, d’intimidation et de propagande, par toute une science de la manipulation médiatique, de l' »action psychologique », de la fabrication de preuves et de crimes, par la fusion aussi du policier et du judiciaire, d’anéantir la « menace subversive » en associant, au sein de la population, l’ennemi intérieur, l’ennemi politique à l’affect de la terreur.
L’essentiel, dans la guerre moderne, est cette « bataille des cœurs et des esprits » où tous les coups sont permis. Le procédé élémentaire, ici, est invariable : individuer l’ennemi afin de le couper du peuple et de la raison commune, l’exposer sous les atours du monstre, le diffamer, l’humilier publiquement, inciter les plus vils à l’accabler de leurs crachats, les encourager à la haine. « La loi doit être utilisée comme simplement une autre arme dans l’arsenal du gouvernement et dans ce cas ne représente rien de plus qu’une couverture de propagande pour se débarrasser de membres indésirables du public. Pour la meilleure efficacité, il conviendra que les activités des services judiciaires soient liées à l’effort de guerre de la façon la plus discrète possible », conseillait déjà, en 1971, le brigadier Frank Kitson [ancien général de l’armée britannique, théoricien de la guerre contre-insurrectionelle], qui en savait quelque chose.
Une fois n’est pas coutume, dans notre cas, l’antiterrorisme a fait un four. On n’est pas prêt, en France, à se laisser terroriser par nous. La prolongation de ma détention pour une durée « raisonnable » est une petite vengeance bien compréhensible au vu des moyens mobilisés, et de la profondeur de l’échec; comme est compréhensible l’acharnement un peu mesquin des « services », depuis le 11 novembre, à nous prêter par voie de presse les méfaits les plus fantasques, ou à filocher le moindre de nos camarades. Combien cette logique de représailles a d’emprise sur l’institution policière, et sur le petit cœur des juges, voilà ce qu’auront eu le mérite de révéler, ces derniers temps, les arrestations cadencées des « proches de Julien Coupat ».
Il faut dire que certains jouent, dans cette affaire, un pan entier de leur lamentable carrière, comme Alain Bauer [criminologue], d’autres le lancement de leurs nouveaux services, comme le pauvre M. Squarcini [directeur central du renseignement intérieur], d’autres encore la crédibilité qu’ils n’ont jamais eue et qu’ils n’auront jamais, comme Michèle Alliot-Marie.
Vous êtes issu d’un milieu très aisé qui aurait pu vous orienter dans une autre direction…
« Il y a de la plèbe dans toutes les classes » (Hegel).
Pourquoi Tarnac?
Allez-y, vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, nul ne pourra vous l’expliquer, je le crains.
Vous définissez-vous comme un intellectuel? Un philosophe ?
La philosophie naît comme deuil bavard de la sagesse originaire. Platon entend déjà la parole d’Héraclite comme échappée d’un monde révolu. A l’heure de l’intellectualité diffuse, on ne voit pas ce qui pourrait spécifier « l’intellectuel », sinon l’étendue du fossé qui sépare, chez lui, la faculté de penser de l’aptitude à vivre. Tristes titres, en vérité, que cela. Mais, pour qui, au juste, faudrait-il se définir?
Etes-vous l’auteur du livre L’insurrection qui vient ?
C’est l’aspect le plus formidable de cette procédure : un livre versé intégralement au dossier d’instruction, des interrogatoires où l’on essaie de vous faire dire que vous vivez comme il est écrit dans L’insurrection qui vient, que vous manifestez comme le préconise L’insurrection qui vient, que vous sabotez des lignes de train pour commémorer le coup d’Etat bolchevique d’octobre 1917, puisqu’il est mentionné dans L’insurrection qui vient, un éditeur convoqué par les services antiterroristes.
De mémoire française, il ne s’était pas vu depuis bien longtemps que le pouvoir prenne peur à cause d’un livre. On avait plutôt coutume de considérer que, tant que les gauchistes étaient occupés à écrire, au moins ils ne faisaient pas la révolution. Les temps changent, assurément. Le sérieux historique revient.
Ce qui fonde l’accusation de terrorisme, nous concernant, c’est le soupçon de la coïncidence d’une pensée et d’une vie; ce qui fait l’association de malfaiteurs, c’est le soupçon que cette coïncidence ne serait pas laissée à l’héroïsme individuel, mais serait l’objet d’une attention commune. Négativement, cela signifie que l’on ne suspecte aucun de ceux qui signent de leur nom tant de farouches critiques du système en place de mettre en pratique la moindre de leurs fermes résolutions; l’injure est de taille. Malheureusement, je ne suis pas l’auteur de L’insurrection qui vient – et toute cette affaire devrait plutôt achever de nous convaincre du caractère essentiellement policier de la fonction auteur.
J’en suis, en revanche, un lecteur. Le relisant, pas plus tard que la semaine dernière, j’ai mieux compris la hargne hystérique que l’on met, en haut lieu, à en pourchasser les auteurs présumés. Le scandale de ce livre, c’est que tout ce qui y figure est rigoureusement, catastrophiquement vrai, et ne cesse de s’avérer chaque jour un peu plus. Car ce qui s’avère, sous les dehors d’une « crise économique », d’un « effondrement de la confiance », d’un « rejet massif des classes dirigeantes », c’est bien la fin d’une civilisation, l’implosion d’un paradigme : celui du gouvernement, qui réglait tout en Occident – le rapport des êtres à eux-mêmes non moins que l’ordre politique, la religion ou l’organisation des entreprises. Il y a, à tous les échelons du présent, une gigantesque perte de maîtrise à quoi aucun maraboutage policier n’offrira de remède.
Ce n’est pas en nous transperçant de peines de prison, de surveillance tatillonne, de contrôles judiciaires, et d’interdictions de communiquer au motif que nous serions les auteurs de ce constat lucide, que l’on fera s’évanouir ce qui est constaté. Le propre des vérités est d’échapper, à peine énoncées, à ceux qui les formulent. Gouvernants, il ne vous aura servi de rien de nous assigner en justice, tout au contraire.
Vous lisez « Surveiller et punir » de Michel Foucault. Cette analyse vous paraît-elle encore pertinente?
La prison est bien le sale petit secret de la société française, la clé, et non la marge des rapports sociaux les plus présentables. Ce qui se concentre ici en un tout compact, ce n’est pas un tas de barbares ensauvagés comme on se plaît à le faire croire, mais bien l’ensemble des disciplines qui trament, au-dehors, l’existence dite « normale ». Surveillants, cantine, parties de foot dans la cour, emploi du temps, divisions, camaraderie, baston, laideur des architectures : il faut avoir séjourné en prison pour prendre la pleine mesure de ce que l’école, l’innocente école de la République, contient, par exemple, de carcéral.
Envisagée sous cet angle imprenable, ce n’est pas la prison qui serait un repaire pour les ratés de la société, mais la société présente qui fait l’effet d’une prison ratée. La même organisation de la séparation, la même administration de la misère par le shit, la télé, le sport, et le porno règne partout ailleurs avec certes moins de méthode. Pour finir, ces hauts murs ne dérobent aux regards que cette vérité d’une banalité explosive : ce sont des vies et des âmes en tout point semblables qui se traînent de part et d’autre des barbelés et à cause d’eux.
Si l’on traque avec tant d’avidité les témoignages « de l’intérieur » qui exposeraient enfin les secrets que la prison recèle, c’est pour mieux occulter le secret qu’elle est : celui de votre servitude, à vous qui êtes réputés libres tandis que sa menace pèse invisiblement sur chacun de vos gestes.
Toute l’indignation vertueuse qui entoure la noirceur des geôles françaises et leurs suicides à répétition, toute la grossière contre-propagande de l’administration pénitentiaire qui met en scène pour les caméras des matons dévoués au bien-être du détenu et des directeurs de tôle soucieux du « sens de la peine », bref : tout ce débat sur l’horreur de l’incarcération et la nécessaire humanisation de la détention est vieux comme la prison. Il fait même partie de son efficace, permettant de combiner la terreur qu’elle doit inspirer avec son hypocrite statut de châtiment « civilisé ». Le petit système d’espionnage, d’humiliation et de ravage que l’Etat français dispose plus fanatiquement qu’aucun autre en Europe autour du détenu n’est même pas scandaleux. L’Etat le paie chaque jour au centuple dans ses banlieues, et ce n’est de toute évidence qu’un début : la vengeance est l’hygiène de la plèbe.
Mais la plus remarquable imposture du système judiciaro-pénitentiaire consiste certainement à prétendre qu’il serait là pour punir les criminels quand il ne fait que gérer les illégalismes. N’importe quel patron – et pas seulement celui de Total –, n’importe quel président de conseil général – et pas seulement celui des Hauts-de-Seine–, n’importe quel flic sait ce qu’il faut d’illégalismes pour exercer correctement son métier. Le chaos des lois est tel, de nos jours, que l’on fait bien de ne pas trop chercher à les faire respecter et les stups, eux aussi, font bien de seulement réguler le trafic, et non de le réprimer, ce qui serait socialement et politiquement suicidaire.
Le partage ne passe donc pas, comme le voudrait la fiction judiciaire, entre le légal et l’illégal, entre les innocents et les criminels, mais entre les criminels que l’on juge opportun de poursuivre et ceux qu’on laisse en paix comme le requiert la police générale de la société. La race des innocents est éteinte depuis longtemps, et la peine n’est pas à ce à quoi vous condamne la justice : la peine, c’est la justice elle-même, il n’est donc pas question pour mes camarades et moi de « clamer notre innocence », ainsi que la presse s’est rituellement laissée aller à l’écrire, mais de mettre en déroute l’hasardeuse offensive politique que constitue toute cette infecte procédure. Voilà quelques-unes des conclusions auxquelles l’esprit est porté à relire Surveiller et punir depuis la Santé. On ne saurait trop suggérer, au vu de ce que les Foucaliens font, depuis vingt ans, des travaux de Foucault, de les expédier en pension, quelque temps, par ici.
Comment analysez-vous ce qui vous arrive?
Détrompez-vous : ce qui nous arrive, à mes camarades et à moi, vous arrive aussi bien. C’est d’ailleurs, ici, la première mystification du pouvoir : neuf personnes seraient poursuivies dans le cadre d’une procédure judiciaire « d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », et devraient se sentir particulièrement concernées par cette grave accusation. Mais il n’y a pas d’« affaire de Tarnac » pas plus que d' »affaire Coupat », ou d' »affaire Hazan » [éditeur de L’insurrection qui vient]. Ce qu’il y a, c’est une oligarchie vacillante sous tous rapports, et qui devient féroce comme tout pouvoir devient féroce lorsqu’il se sent réellement menacé. Le Prince n’a plus d’autre soutien que la peur qu’il inspire quand sa vue n’excite plus dans le peuple que la haine et le mépris.
Ce qu’il y a, c’est, devant nous, une bifurcation, à la fois historique et métaphysique: soit nous passons d’un paradigme de gouvernement à un paradigme de l’habiter au prix d’une révolte cruelle mais bouleversante, soit nous laissons s’instaurer, à l’échelle planétaire, ce désastre climatisé où coexistent, sous la férule d’une gestion « décomplexée », une élite impériale de citoyens et des masses plébéiennes tenues en marge de tout. Il y a donc, bel et bien, une guerre, une guerre entre les bénéficiaires de la catastrophe et ceux qui se font de la vie une idée moins squelettique. Il ne s’est jamais vu qu’une classe dominante se suicide de bon cœur.
La révolte a des conditions, elle n’a pas de cause. Combien faut-il de ministères de l’Identité nationale, de licenciements à la mode Continental, de rafles de sans-papiers ou d’opposants politiques, de gamins bousillés par la police dans les banlieues, ou de ministres menaçant de priver de diplôme ceux qui osent encore occuper leur fac, pour décider qu’un tel régime, même installé par un plébiscite aux apparences démocratiques, n’a aucun titre à exister et mérite seulement d’être mis à bas ? C’est une affaire de sensibilité.
La servitude est l’intolérable qui peut être infiniment tolérée. Parce que c’est une affaire de sensibilité et que cette sensibilité-là est immédiatement politique (non en ce qu’elle se demande « pour qui vais-je voter ? », mais « mon existence est-elle compatible avec cela ? »), c’est pour le pouvoir une question d’anesthésie à quoi il répond par l’administration de doses sans cesse plus massives de divertissement, de peur et de bêtise. Et là où l’anesthésie n’opère plus, cet ordre qui a réuni contre lui toutes les raisons de se révolter tente de nous en dissuader par une petite terreur ajustée.
Nous ne sommes, mes camarades et moi, qu’une variable de cet ajustement-là. On nous suspecte comme tant d’autres, comme tant de « jeunes », comme tant de « bandes », de nous désolidariser d’un monde qui s’effondre. Sur ce seul point, on ne ment pas. Heureusement, le ramassis d’escrocs, d’imposteurs, d’industriels, de financiers et de filles, toute cette cour de Mazarin sous neuroleptiques, de Louis Napoléon en version Disney, de Fouché du dimanche qui pour l’heure tient le pays, manque du plus élémentaire sens dialectique. Chaque pas qu’ils font vers le contrôle de tout les rapproche de leur perte. Chaque nouvelle « victoire » dont ils se flattent répand un peu plus vastement le désir de les voir à leur tour vaincus. Chaque manœuvre par quoi ils se figurent conforter leur pouvoir achève de le rendre haïssable. En d’autres termes : la situation est excellente. Ce n’est pas le moment de perdre courage.
Propos recueillis par Isabelle Mandraud et Caroline Monnot
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/12/18/julien-coupat-la-prolongation-de-ma-detention-est-une-petite-vengeance_1197456_3224.html#oFSA8i1zvd0ZyZdZ.99
Encore une autre découverte grâce au Séminaire Zapatiste…
https://www.ababord.org/Ventres-asservis-au-capital
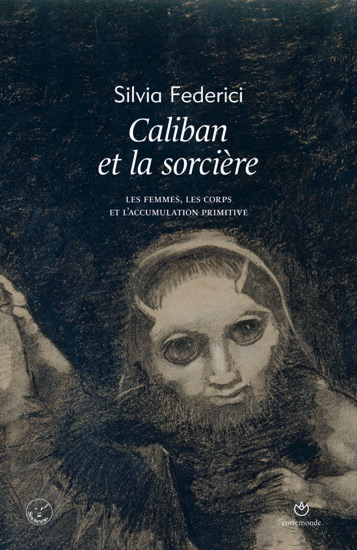
Nous vous proposons la version intégrale de la recension du livre de Silvia Federici, Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, éditions Entremonde, 2014. Une version plus courte paraît dans notre numéro de juin 2015.
Qu’il est difficile de parler de la « production d’enfants », en cette ère et cette région du monde où la parentalité baigne dans un luxe romantique inouï ! C’est pourtant ce à quoi s’attelle l’essayiste italienne Silvia Federici dans Caliban et la sorcière. Le fait qu’elle évoque une autre époque facilite peut-être un peu les choses. On n’a pas l’impression qu’elle parle de nous, là, maintenant. Nous poussons de hauts cris devant la politique d’enfant unique de la Chine. Cela nous paraît barbare. Ici, c’est autrement plus civilisé : la mère est « glamourisée », l’enfant esthétisé. Or, n’est-ce pas la même logique qui y préside, mais articulée différemment ? Car entre avortements forcés et avortements interdits – ou difficiles d’accès –, stérilisation forcée et procréation assistée, prenons-en acte : la reproduction est bel et bien gérée, contrôlée, comme dans « contrôle des naissances ».
Les femmes, leur spécificité reproductive, ont été asservies au projet capitaliste des nations et tous les événements et discours qui ont concouru à cet objectif ont eu des effets collatéraux sur la définition de la féminité. C’est là la thèse essentielle de Federici dans son livre Caliban et la sorcière. Si l’histoire des sorcières, de leur chasse et des horreurs qu’on leur faisait subir – on les brûlait réellement, ce n’est pas une métaphore tirée d’un conte pour enfants – est tout de même assez bien connue, la raison qui motivait cette histoire restait sans ancrage.
Fabrications des ressources humaines
Christine Delphy nous avait donné un texte fondateur sur l’économie et la relégation des femmes au rang de servantes qui fournissent du travail gratuit et des enfants [1], Colette Guillaumin un excellent texte sur l’appropriation des femmes par les hommes et la naturalisation de leur « contribution » reproductive spécifique [2]. C’est dans cette ligne du féminisme matérialiste que s’inscrit cet ouvrage de Federici, qui s’attarde à un moment précis de l’asservissement des femmes, celui du passage du féodalisme au capitalisme, en montrant comment s’articulent les rapports sociaux de sexe sous la bannière du patriarcat à cette époque. Ce qui se passe alors concerne plus précisément l’instrumentalisation de la fonction reproductrice des femmes au bénéfice de l’État et du capital naissant. Ainsi, de la même façon que les États-Unis ont engrangé leurs richesses sur le travail gratuit rendu possible par l’esclavagisation de la population noire issue de la traite, le patriarcat a engrangé ses profits sur le dos des femmes ; en fait, il faudrait trouver une autre formule, car c’est bien sur l’exploitation du ventre des femmes que s’est érigée la richesse des hommes, leur pouvoir. « [L]e corps féminin a été approprié par l’État et les hommes et contraint de fonctionner comme moyen de la reproduction et de l’accumulation du travail. » Formulation radicale ? Certainement. Et démonstration impeccable.
Le premier chapitre plante l’arrière-plan historique, insistant sur les transformations économiques liées au partage du territoire lors de ce passage au capitalisme. Y sont relatées « les luttes que le prolétariat de l’Europe médiévale [petits paysans, artisans, journaliers] mena contre le pouvoir féodal ». Y est notamment remis en question le mythe du progrès qui se serait accompli là et discuté comment « les rapports entre hommes et femmes et la reproduction de la force de travail furent redéfinis en s’opposant à l’ordre féodal » à travers la distribution des terres et leur privatisation (et, par extension, la privatisation des capitaux, provoquant une transformation des liens sociaux). Au seuil historique du capitalisme donc, où les humains deviennent des ressources humaines.
« Accumuler le travail et avilir les femmes » est l’objet du deuxième chapitre. Federici montre la façon dont l’asservissement des femmes s’articule au projet capitaliste de production de la main d’œuvre, notamment par « la transformation du corps en machine-outil ». Elle insiste, ce faisant, sur les lourdes conséquences de cet axiome sur les femmes, dans le cadre d’un projet démographique et ses ramifications expansionnistes, qui s’expriment dans la colonisation du Nouveau Monde. Elle le formule clairement : « [L]es changements que l’avènement du capitalisme amenèrent dans à [sic] la position sociale des femmes, en particulier au niveau du prolétariat, que ce soit en Europe ou en Amérique, étaient tout d’abord dictés par la recherche de nouvelles sources de travail et de nouvelles formes d’assujettissement et de division de la force de travail. » C’est ainsi que « l’histoire des femmes et de la reproduction dans la transition entre féodalisme et capitalisme doit être comprise », de même que les visées d’expansion coloniale. Mais parce qu’elle tire profit d’un trait physiologique, bien vite cependant « l’importance économique de la reproduction de la force de travail effectuée dans le foyer et sa fonction dans l’accumulation du capital devint invisible, mythifiée comme aspiration naturelle et qualifiée de “travail de femme” ».
Le troisième chapitre porte sur les conquêtes coloniales : détour utile pour illustrer la pression sur la production de « combattants ». Le quatrième chapitre s’arrête à cette période de la chasse aux sorcières, où des milliers de femmes ont été sacrifiées sur l’autel du patriarcat, phénomène mieux connu, ayant fait l’objet de plusieurs incursions historiques. Enfin, le dernier montre les liens établis entre colonisation, patriarcat et christianisation : car il fallut bientôt fabriquer des chrétiens pour assurer l’hégémonie de sa religion.
Federici se livre à une lecture féministe de la genèse du capitalisme, démontrant comment la force de reproduction a été canalisée, voire mutée en force de travail – et ce travail asservi au capital. Elle s’emploie à révéler la nette articulation entre subordination des femmes et capitalisme. En ce sens, cet essai est un peu le chaînon manquant entre Marx et Delphy, article fondateur du féminisme matérialiste contemporain. Notamment, Federici se penche sur quelques aspects « oubliés » chez Marx : « 1) le développement d’une nouvelle division sexuée du travail assujettissant le travail des femmes et leur fonction reproductive à la reproduction de la force de travail ; 2) la construction d’un nouvel ordre patriarcal, fondé sur l’exclusion des femmes du travail salarié et leur soumission aux hommes ; 3) la mécanisation du corps prolétaire et sa transformation, dans le cas des femmes, en une machine de production de nouveaux travailleurs ». Si la dernière affirmation peut encore une fois sembler brutale, la démonstration est fine, minutieuse et convaincante. Federici illustre les effets néfastes pour les femmes de l’accumulation primitive, jumelée avec la chasse aux sorcières (qui est un symbole marquant de l’exclusion des femmes du « travail », dans la mesure où les savoirs véhiculés par elles ont par la suite été usurpés et revendiqués par les hommes, à travers l’institution de la médecine, à travers aussi maintes autres officines de fabrication du savoir). Selon elle, « [l]a persécution des sorcières […] a été aussi importante pour le développement du capitalisme que la colonisation et l’expropriation de la paysannerie européenne ». Et c’est au fonctionnement de cette triade (colonisation et privatisation des terres, accumulation primitive et assujettissement des femmes) qu’elle consacre sa démonstration.
Comment la féminité complait la ressource
Plus encore, pour Federici, « la “féminité” s’est constituée dans la société capitaliste comme fonction dissimulant la production de la force de travail sous couvert de fatalité biologique, alors que “l’histoire des femmes” est “histoire de classe” ». On pourrait extrapoler et avancer que découle directement de cette construction qu’est la féminité, l’idée même du désir d’enfant – et ses différents avatars : instinct maternel, horloge biologique, etc. Chose certaine, toute la conception de la famille patriarcale (dite nucléaire, comme dans : noyau de production) découle de cette mécanique.
Mais loin des rêveries romantiques, il s’agit, pour les chefs de famille tout comme pour les chefs de pays (aujourd’hui assujettis à l’entreprise), d’accumuler du capital-ressources humaines, qui pourra être utilisé tout autant pour produire des biens que pour défendre des biens (territoriaux). Ainsi, même si le désir d’enfant – ou la fiction du désir d’enfant – enrobe la reproduction d’enfants d’une aura sentimentale dessinant l’idéal de famille, il reste que la production finit par échapper aux producteurs dans nos sociétés « capitalivores ». Car en amont, il fut un jour où ce désir d’enfant n’existait pas, pas plus que n’importe quelle politique visant à favoriser la famille. Si l’argument de nature est trop souvent convoqué pour justifier l’ordre social, il est également malmené, la plupart du temps, et complètement dévoyé. Le « rêve » d’avoir un enfant pourrait aussi être questionné dans sa dimension capitaliste – que désire-t-on quand on désire un enfant ? Mais ces choses là sont sensibles, car même soulever ceci en théorie, en hypothèse quant à l’existence d’un système, reste délicat.
Biopolitique de la reproduction
Sur le plan politique, il apparaît qu’encore aujourd’hui « “femmes” est une catégorie d’analyse légitime, et les activités associées à la “reproduction” demeurent un terrain de lutte essentiel pour les femmes », ce dont nous convainquent chaque jour les actualités internationales. Aussi devrait-on toujours se méfier lorsque les gouvernant·e·s s’adressent aux familles – non plus aux citoyen·ne·s donc, mais bien aux producteurs d’enfants, ce qui comporte une dimension spécifique pour les reproductrices. La lecture de l’essai de Federici nous rappelle qu’il s’agit bien là de biopolitique. Or, le patriarcat est une biopolitique. La gestion de la procréation, bien qu’articulée différemment à l’ère des technologies de reproduction, est toujours le prétexte d’une gestion du féminin. Et du contrôle de la reproduction à celui de la sexualité puis du corps, il n’y a qu’un pas. C’est bien vite toute la femme/toutes les femmes qu’il faut contrôler. C’est bien à ce projet patriarcal – faire nation – que les femmes furent asservies.
Lire certains phénomènes contemporains et actuels à la lumière de cet essai ébranle. Comment comprendre les meurtres commis par les hommes sur les femmes ? Alors même qu’on est en train de tuer des ventres – selon la perspective capitaliste – et que l’État devrait réagir, qui ne réagit pourtant pas, force est de constater que la misogynie intervient dans la balance. La haine des femmes dépasserait, dans certains cas, la reconnaissance de leur utilité reproductive. Dans ce contexte, l’absence d’action face aux meurtres commis à l’endroit de milliers de femmes autochtones au pays ressemble en effet à un génocide qui reçoit l’assentiment tranquille du colonisateur…
[1] Christine Delphy, « L’ennemi principal », L’Ennemi principal, vol. 1, Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2002.
[2] Colette Guillaumin, « Pratique du pouvoir et idée de nature (I) L’appropriation des femmes », « Pratique du pouvoir et idée de Nature (II) Le discours de la Nature », Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Côté-femmes, 1992.
Ivan Segré étudie le talmud pour éclairer le présent. Asterix et Obélix, Israël, Thierry Fragnoli et rédemption. Dernier épisode.
Des notes:
« Le banditisme (même celui dit ‘social’) reste une force conservatrice. Il n’est pas porteur de la révolution comme un mouvement social. »
Ivan Segré étudie le talmud pour éclairer le présent. Cette semaine, il s’en prend à la police.
Ivan Segré étudie le talmud pour éclairer le présent. Cette semaine, il continue son exégèse et nous parle de géométrie, de thermes et de prostitution.
« Et donc évidemment avec un nom comme ça on ne peut que bien traduire… surtout quand il s’agit de Cabale. On est en plein dans la Cabale. Et donc Désiré Elbeze comment est-ce qu’il traduit ? Voilà : « Rabbi Shimon prit la parole et dit : — Tout ce qu’ils ont institué ils ne l’ont fait que pour servir leurs intérêts : ils ont aménagé l’habitat pour pouvoir y installer des prostituées, construit des bains pour leur propre plaisir et lancé des ponts pour encaisser un droit de péage. » Et ça c’est une traduction littérale. Une traduction littérale où éclate d’emblée la raison de la colère de Rabbi Shimon et la puissance politique de son propos. Puissance politique qui est rendue par la littéralité de la traduction du rabbinat et qui est occultée par la spiritualisation d’Abraham Heschel et de Guy Casari. Parce que finalement c’est ça qui est intéressant dans l’orthodoxie, c’est qu’elle est la garde de la lettre, même dans son inconscience au fond. Donc même si on peut penser que l’orthodoxie ne réfléchit pas à la portée politique de ces propos de Rabbi Shimon au moins elle en a la garde… par sa fidélité à la lettre. Et c’est d’autant plus flagrant ici que l’inconscient du signifiant il est écrit dans le nom du traducteur, qui est un nom cabalistique. »
Ivan Segré étudie le talmud pour éclairer notre présent. Cette semaine, il a accepté d’exposer à LundiMatin les origines historiques, politiques et religieuses de la notion de tiqqun et ce faisant, son antagonisme fondamental avec l’ordre sous lequel nous vivons.
(Wikitionnaire)
| Singulier | Pluriel |
|---|---|
| tiqqun | tiqquns |
| \ti.kun\ | |
tiqqun \ti.kun\ masculin
(Wikipédia)
Tiqqun est le nom d’une revue philosophique française, fondée en 19991 avec pour but de « recréer les conditions d’une autre communauté ». Elle fut animée par divers écrivains, avant de se dissoudre à Venise en 2001 à la suite des attentats du 11 septembre2. La revue a été l’objet d’un certain intérêt dans les médias en novembre 20081 après l’arrestation de Julien Coupat3, l’un de ses fondateurs.
Le Tiqqun est aussi un concept philosophique, éponyme de la revue dans laquelle il a été développé.
Tiqqun est enfin le nom sous lequel ont été publiés plusieurs livres reprenant des textes de la revue, pour désigner, si ce n’est leur auteur collectif4, du moins « un point de l’esprit d’où ces écrits émanent5 ».
Le nom de la revue vient de la grande importance que les rédacteurs accordent au concept philosophique de Tiqqun6. C’est la transcription francisée du terme d’origine hébraïque Tikkoun olam, un concept issu du judaïsme souvent employé dans la tradition kabalistique et messianique, qui signifie tout à la fois réparation, restitution et rédemption, et qui recouvre en grande partie, et entre autres, la conception juive de la justice sociale.
Comunicado ESP / ING / FRA / CAT / PTG
A los pueblos del mundo:
Nosotrxs, los medios libres, alternativos, independientes, autónomos o como se llamen, hemos estado desde hace tiempo informando desde y con las luchas, organizándonos y tomando nuestras necesidades comunicativas en nuestras propias manos, cuestionando la manipulación que los medios comerciales hacen de los hechos y de las noticias, desmitificando la idea de que los periodistas son objetivos.
No nos sentimos poseedorxs de «verdades absolutas» pero comunicamos honestamente desde nuestras reconocidas subjetividades, con ideales de libertad. Nos situamos del lado de quienes resisten y construyen en su cotidiano nuevas formas de relacionarse que se anteponen a la lógica de destrucción y muerte. Rompemos el cerco informativo. Defendemos la libertad de expresión creando y sosteniendo medios o procesos de comunicación que no pertenecen y sirven a lxs que nos someten.
México se encuentra inmerso en una de las mayores crisis políticas de los últimos años. Los terribles sucesos del 26 y 27 de septiembre [2014] en Iguala, Guerrero, han evidenciado la enorme complicidad entre el crimen organizado y el Estado mexicano. No hay una distinción entre mafia y gobierno, ni entre policía, narco y paramilitares. Todos ellxs, junto con la mayoría de los medios de paga, actúan del mismo lado, protegiendo sus propios intereses.
Apenas unas horas después de que la policía asesinara a seis personas y trasladara en sus patrullas a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, sin que hasta la fecha haya certeza sobre su paradero, algunos medios de «comunicación» «informaron» de un supuesto enfrentamiento entre normalistas y policías. Desde entonces, el manejo mediático que han hecho de esta crisis ha buscado su provecho y la del Estado, repartiendo culpas y otorgando perdones.
El común denominador no ha sido informar a la población de lo que pasa, ni mucho menos ir al fondo de los hechos para desenmascarar las redes de corrupción de los de arriba –puesto que las empresas mediáticas figuran en dichas telarañas– sino ganar clicks y rating para sus medios y ayudar al gobierno a administrar la información, sin respetar el dolor de las víctimas y la inteligencia de la gente. Hay medios que no se guiaron únicamente con este criterio, sobre todo periodistas-trabajadorxs de la prensa, usuarixs de redes sociales y personas de a pie; a quienes dirigimos estas palabras.
La dignidad de los estudiantes de Ayotzinapa, así como la fuerza y entereza de sus compañerxs, familiares y amigxs crece cada día y ha ido despertando más rabias, acumuladas por el sinfín de injusticias que se viven y se han vivido en este país desde hace ya 522 años.
En México y en diversos territorios, miles de personas han salido a las calles para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, pero el memorial de agravios es tan grande que las movilizaciones están poniendo sobre la mesa la violencia cotidiana que se vive en este país, las miles de desapariciones y asesinatos, así como los miles de feminicidios que suceden en este Estado policiaco y militarizado.
Es esa violencia la que muchos medios pretenden invisibilizar. Como si la memoria y la dignidad tuvieran fecha de caducidad, como si el dolor y el sufrimiento pudieran ser condenados al olvido.
Les invitamos a caminar juntxs, a sumar nuestras voces y miradas en la construcción de un mejor presente, a entretejer la comunicación desde abajo; a consultar y ser partícipes de los medios libres, alternativos, independientes, autónomos o como se llamen.
Toma los medios, siémbralos libres.
México, 2014
>..<
PORTUGUES
Nós a mídia livre, alternativa, independente, autônoma ou seja qual for o seu nome, desde há tempo temos estado informando desde e com as lutas, organizando-nos e assumindo com a nossas próprias mãos as nossas necessidades comunicativas, questionando a manipulação que a mídia comercial faz dos fatos e das noticias, desmitificando a ideia de que os jornalistas são objetivos.
Não sentimos ser os donos da “verdade absoluta” porem comunicamos honestamente nossas reconhecidas subjetividades com ideais de liberdade. O melhor está por vir e temos que lutar para obtê-lo, é por isso que nos colocamos do lado de quem resiste e constrói no cotidiano novas formas de se relacionar que se antepõem á logica da destruição e da morte. Quebramos o cerco informativo. Defendemos a liberdade de expressão, criando e mantendo meios ou processos de comunicação que não pertencem nem estão ao serviço dos que nos submetem.
O país encontra-se imerso em uma das maiores crises politicas dos últimos anos. Os terríveis acontecimentos dos dias 26 e 27 de setembro (2014) em Iguala, Guerrero, revelaram a enorme cumplicidade entre o crime organizado e o Estado mexicano. Não existe distinção entre a máfia e o governo, nem entre policia, traficantes e paramilitares. Todos eles, junto com a maioria da mídia empresarial agem do mesmo lado, protegendo o seus próprios interesses.
Logo de umas horas depois de que a policia assassinara a seis pessoas e trasladara nas suas patrulhas a 43 estudantes, sem que ate agora exista certeza sobre o paradeiro deles, alguns meios de “comunicação” “informaram” de um suposto enfrentamento entre normalistas e policias. Desde então, o manejo mediático que tem-se realizado desta crises tem tido a intenção de beneficiar os poderes estabelecidos nos meios de comunicação e ao Estado, atribuindo culpas e concedendo perdões.
O comum denominador não tem sido informar á população do que está acontecendo, nem muito menos ir ao fundo dos fatos para desmascarar as redes de corrupção daqueles de arriba – pois as empresas mediáticas figuram em ditas teias de aranha- senão ganhar clicks e ratings para o seus meios e ajudar ao governo a administrar a informação sem respeitar o dor das vítimas e a inteligência das pessoas. Contudo houve meios que não guiaram-se unicamente por este critério sobre tudo jornalistas-trabalhadores da imprensa, usuários das redes sociais e pessoas de a pé, a quem dirigimos estas palavras.
A dignidade dos estudantes de Ayotzinapa , assim como a força e integridade dos companherxs, familiares e amigxs cresce cada dia e tem acordado mais raivas, acumuladas pelo sem-fim das injustiças que se vivem e que se tem vivido neste pais ha já muitos anos.
No México assim como em diferentes países, milhares de pessoas tem saído para as ruas para exigir justiça pelos 43 estudantes desaparecidos, mas o memorial de agressões é tão grande que as mobilizações estão pondo sobre a mesa a violência cotidiana que vive-se neste pais, os milhares de desaparições e assassinatos, os milhares de feminicídios em um Estado policial e militarizado.
É essa violência que a mídia comercial pretende ocultar. Como se a memoria e a dignidade tiveram data de caducidade, como se o dor e o sofrimento puderam ser condenados ao esquecimento.
Os convidamos a caminhar juntxs, a adicionar nossas vozes e olhares na construção de um melhor presente, a entretecer a comunicaOs convidamlhor presente, a entretejer a comunicaas voices e miradas nto puderam ser condenados ao esquecimento. usticriterio soção desde abaixo, a consultar e ser parte da mídia livre, alternativa, independente, autônoma ou seja qual for o seu nome.
>..<
FRANÇAIS
Aux peuples du monde,
Sur la situation actuelle qui se vit au Mexique :
Nous, les médias libres, alternatifs, indépendants, autonomes ou quel que soit leur nom, nous consacrons à diffuser des informations depuis les luttes et avec elles depuis bien longtemps. Nous le faisons en nous organisant et en prenant nous-même en main nos besoins en termes de communication, en remettant en question la manipulation des faits et des informations de la part des médias commerciaux, en démythifiant l’idée selon laquelle les journalistes sont objectifs.
Nous n’avons pas le sentiment de détenir « la vérité absolue », mais nous communiquons de manière honnête à partir de nos subjectivités assumées et de nos idéaux de liberté. Le meilleur reste à venir, et nous devons lutter pour l’obtenir. C’est pour cette raison que nous nous positionnons aux côtés de celles et ceux qui résistent et construisent au quotidien de nouvelles formes de vivre ensemble, qui s’opposent aux logiques de mort et de destruction.
Nous brisons la censure médiatique. Nous défendons la liberté d’expression en donnant vie à des médias et processus de communication qui n’appartiennent ni ne servent les intérêts de ceux qui nous soumettent.
Actuellement, notre pays est plongé dans une des plus graves crises politiques qu’il ait connu ces dernières années. Les terribles événements des 26 et 27 septembre à Iguala, Guerrero, ont dévoilé l’énorme complicité qu’il existe entre le crime organisé et l’État mexicain. Il n’y a aucune distinction entre mafia et gouvernement, ni entre police, narcotrafiquants et paramilitaires. Tous, main dans la main avec la grande majorité des médias de masse, agissent dans le même camp et protègent les intérêts qui leur sont propres.
À peine une heure après que la police ait assassiné 6 personnes et enlevé 43 étudiants – sans que l’on ne sache encore avec certitude où ils se trouvent aujourd’hui – des médias de « communication » ont commencé à diffuser « l’information » selon laquelle un affrontement avait eu lieu entre les élèves de l’école normale et la police. Depuis lors, le traitement médiatique de cette crise n’a fait que rechercher des profits pour ces médias et pour l’État, tout en dispersant les responsabilités et en octroyant des pardons.
Leur but n’a pas été d’informer la population de ce qu’il se passe, et encore moins d’analyser les faits en profondeur pour lever le voile sur les réseaux de corruption de « ceux d’en haut » – sachant que les grands groupes de presse sont parties intégrantes de cette toile – mais bien de faire en sorte que leurs médias gagnent en popularité et d’aider le gouvernement à gérer l’information, sans respecter ni la douleur des victimes, ni l’intelligence de la population.
Il y a pourtant quelques personnes, principalement des journaliste et travailleurs-euses du monde de la presse, des membres des réseaux sociaux ou de simples membres de la société, qui ne se sont pas contentés de suivre ce chemin. C’est à elles et eux que nous nous adressons.
La dignité des étudiants d’Ayotzinapa, tout comme la force et l’intégrité de leurs camarades, familles et ami-e-s, grandit jour après jour et réveille chaque fois plus de colères, issues des innombrables injustices dont souffre le pays depuis de nombreuses années.
Au Mexique et dans beaucoup d’autres endroits du monde, des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour exiger que justice soit faite pour les 43 étudiants disparus. La liste des plaintes est si longue que les mobilisations mettent également sur le tapis la violence quotidienne qui se vit dans le pays, les milliers de disparitions et assassinats, les milliers de féminicides qui ont lieu dans cet État policier et militarisé.
C’est bien cette violence que nombre de médias tentent d’invisibiliser. Comme si la mémoire et la dignité avait une date de péremption, comme si la douleur et la souffrance pouvaient être condamnées à l’oubli.
Nous vous invitons à vous joindre à nous, à nos voix et nos regards, pour la construction d’un présent meilleur, à tisser ensemble une communication depuis le bas, à consulter et faire partie des médias libres, alternatifs, indépendants, autonomes ou quel que soit leur nom.
http://www.lodoludicoliberdade.blogspot.cz/2012/03/singular-idade.html
http://solaridade.blogspot.com.br/2012/04/singular-idade.html