Il serait bien insuffisant de me contenter de remercier l’EZLN pour l’invitation à ce séminaire si opportun, qui, ces jours-ci, ne fait que commencer. Ce dont je voudrais, plus profondément, remercier les zapatistes c’est, sur le plan personnel, de m’avoir offert l’opportunité, la possibilité de transformer ma vie et, de manière plus générale, d’avoir ouvert, pour tous et toutes, l’une des brèches les plus lumineuses qui existent dans le sombre monde d’aujourd’hui. De sorte qu’ils nous permettent non seulement d’entrevoir ce qu’il pourrait y avoir derrière le mur mais aussi de nous approcher, de toucher et de sentir la force sensible de la vie digne qu’ils font croître, déjà, de ce côté-ci du mur.
Ce furent des journées inquiètes et enthousiastes. Depuis la réception de l’invitation-défi à ce séminaire [1], je n’ai cessé de me demander : qu’est-ce donc que les zapatistes voient venir et dont personne ne se rend compte ni ne parle ? Cette tempête terrible qui vient comme « la catastrophe unique » que regarde l’ange et qui n’est rien d’autre que le progrès, c’est-à-dire le progrès dans l’avancée dévastatrice de l’hydre capitaliste.
Cela fait longtemps que nous savons que la catastrophe est là et que nous vivons au milieu d’un désastre que les zapatistes ont dénommé Quatrième Guerre mondiale, une guerre du capitalisme contre l’humanité [2]. Et on se demande ce qui pourrait être pire que la nuit d’Iguala dans laquelle nous nous trouvons plongés depuis le 26 septembre dernier, faisant nôtres la douleur et la rage des parents et des camarades des absents d’Ayotzinapa. Beaucoup doutent qu’il puisse y avoir quelque chose de plus terrible que ce qui est déjà. Mais les zapatistes nous rendent le service de partager avec nous l’avis de tempête : grimpé en haut du mât, ils voient s’approcher une tourmente plus brutale encore que celle que nous avons éprouvée jusqu’ici.
L’invitation-défi à ce séminaire nous demandait de remettre en question notre capacité à accomplir, depuis la pensée critique, notre tâche de guetteur des évolutions du monde. Elle nous suggérait de nous secouer pour vérifier si nous n’étions pas à demi endormis. Elle nous invitait à recommencer à scruter l’horizon pour tenter d’observer ce que les pièges de l’attention sélective pouvaient laisser caché. Elle nous priait de tenter d’apporter des pensées que nous n’avions pas déjà pensées précédemment. Et cela n’a rien d’aisé.
J’avancerai en doutant de chaque mot. Je parlerai en posant des questions, même s’il n’y a pas de signe d’interrogation.
Visages connus, têtes nouvelles…
Outre l’exploitation, la dépossession, la discrimination et la répression, l’avancée de l’hydre capitaliste provoque une triple dévastation (s’agit-il de sept têtes ?) : dévastation de la nature (au point que les conséquences de la destruction de la biosphère, et en particulier celles du changement climatique global, seront un paramètre sans cesse plus déterminant pour toute forme de pensée et d’action), dévastation des formes de vie (qui sont, très exactement, ce que les peuples, indiens et non indiens, défendent en même temps que leurs territoires), dévastation intérieure (en nous-mêmes). Le capitalisme est la société la plus pathologique qui ait jamais existé dans l’histoire de la planète Terre. Avec son haleine toxique, avec le feu brûlant qu’elle crache et les déjections qu’elle laisse sur son passage, l’hydre sème maladies et mort pour les végétaux, les animaux et les humains (c’est-à-dire pour les animaux non humains et pour les animaux que nous sommes et qui nous disons humains). Ce sont des maladies du corps qui prolifèrent comme jamais, tels que cancers, désordres endocriniens et bien d’autres. Mais ce sont aussi des maladies de l’esprit, de l’âme, du cœur, comme la dépression, l’impossibilité d’être, le vide au plus profond de soi. Crise de la présence, disent certains [3]. Bon nombre de ces pathologies sont des folies provoquées par l’Argent : obsession pour la consommation et pour les marchandises ; obsession de se conformer aux modèles de la réussite professionnelle et sociale. Hypertrophie aiguë, voire hyperaiguë, de l’ego, qui détruit certaines capacités fondamentales des êtres humains, comme celle de l’écoute ou l’art de faire avec d’autres. Obsession de la compétition, qui imprègne de la conviction pratique que pour être il faut se hisser au-dessus des autres (ce qui fait, par exemple, que de jeunes Chinois seraient disposés à se livrer à des manipulations génétiques pour peu qu’elles leur garantissent des enfants plus beaux, plus intelligents et assurés d’avoir une place à l’université d’Harvard !). Bien sûr, il y a aussi la nécessité de satisfaire les exigences sans cesse plus pressantes et pesantes du travail — ou de la recherche d’un travail — qui multiplient stress, dépression, burn out et jusqu’au suicide dans l’entreprise. Une autre maladie, provoquée par l’overdose des écrans de toutes sortes qui prolifèrent dans les espaces domestiques et privés, est la distraction structurelle et l’incapacité à fixer son attention. Ou encore l’incapacité à être vraiment là où nous sommes (puisqu’il faut être en même temps ailleurs), ainsi que d’autres troubles encore dont, selon le diagnostic précis dont nous a fait part la Compagnie Tamèrantong !, même les enfants souffrent à des âges de plus en plus précoces.
Le caractère pathogène de la société capitaliste fait partie intégrante de la guerre que nous subissons, bien souvent sans nous en rendre compte. Il fait partie de son caractère criminel. C’est l’un des points où cette guerre atteint notre âme, notre cœur, notre ch’ulel, pour les détruire, pour effacer toute possibilité d’une vie digne et ainsi pouvoir plus aisément continuer à exploiter, déposséder et dominer les peuples du monde.
Ces têtes-là de l’hydre — quatre plus trois — nous les connaissons de longue date. Je vais maintenant, non sans risque, tenter d’évoquer deux têtes particulièrement menaçantes et peut-être un peu plus nouvelles, même si leurs visages sont loin d’être inconnus. Je dirai plus loin dans quelle perspective je choisis ces deux-là.
Il s’agit de réfléchir à des phénomènes qui atteignent au Mexique des proportions particulièrement dramatiques mais qui sont mondiaux. Je me réfère à l’essor de l’activité économique illicite et d’un capitalisme criminel — c’est-à-dire plus criminel encore, si cela est possible, que celui qui passe pour légal et respectable. Un capitalisme criminel-criminel. Bien entendu, la séparation entre économie légale et illégale est de moins en moins nette. C’est si vrai que, depuis 2013, les États-Unis et plusieurs pays de l’Union européenne ont décidé d’inclure les revenus du trafic de drogue et de la prostitution dans les statistiques officielles du PIB !
Aujourd’hui, les activités illicites (drogues et autres trafics) représentent une partie de l’économie mondiale qu’il est difficile de chiffrer précisément mais que l’on peut estimer autour de dix pour cent du PIB mondial (les estimations varient entre cinq pour cent et quinze pour cent). Plus significatif encore, leur croissance actuelle est extrêmement rapide, favorisée par l’internationalisation et la dérégulation de l’économie néolibérale. De fait, il faut inclure parmi les effets avérés de la reconfiguration néolibérale du capitalisme le fait d’avoir créé les conditions structurelles d’une croissance accélérée des activités illicites et criminelles.
Les drogues comptent désormais parmi les trois marchandises les plus importantes en terme de profits, avec les armes et le pétrole. Les circuits de blanchiment d’argent créent des flux massifs qui alimentent de manière significative le système financier international. L’ensemble des activités illicites est ainsi devenu indispensable à une économie mondiale par ailleurs fragile : lui retirer cet apport de dix pour cent aurait des conséquences catastrophiques.
Au-delà de ces données, il pourrait être utile de chercher à mieux comprendre le rôle que ces secteurs jouent dans l’ensemble du système capitaliste.
a) Ils ont une fonction de contention face à la décomposition sociale provoquée par les politiques néolibérales. Celles-ci multiplient les populations « superflues » qui, ne trouvant ni travail ni aucune place dans la société, peuvent être aisément happées par les réseaux du crime organisé, comme c’est le cas au Mexique. Sous d’autres modalités, en Europe, comme ailleurs aussi, on constate que dans certains quartiers populaires, dévastés par de nombreux problèmes dont le premier est le chômage (jusqu’à cinquante pour cent parmi les jeunes), les divers trafics, de drogue ou autres, constituent l’une des rares manières permettant de survivre. C’est la raison pour laquelle les politiques publiques ne peuvent faire autre chose que de simuler une lutte pour « restaurer l’État de droit », car chacun sait que l’élimination effective de l’économie parallèle provoquerait une explosion sociale incontrôlable. Partout, drogues et activités illicites sont devenues indispensables pour contenir les effets de la décomposition sociale provoquée par le capitalisme néolibéral.
b) On sait aussi que, dans certaines régions, notamment là où abondent les ressources naturelles (minerais ou autres), la violence du crime organisé peut être instrumentalisée, afin de faire régner la terreur, de faire en sorte que les habitants abandonnent leurs territoires et, ainsi, de vaincre les résistances à la dépossession et à l’exploitation [4]. De manière générale, la violence non institutionnelle peut être utilisée comme une façon de contribuer au gouvernement de tous par la peur, mais aussi de réprimer ou d’éliminer ceux qui s’organisent et s’opposent aux avancées de la domination capitaliste.
c) La drogue est la marchandise parfaite, presque la quintessence du capitalisme. Au moment où prédominent les facteurs de crise de la production légale, les drogues permettent des taux de profits extraordinaires (non seulement du fait de sa prohibition, mais aussi grâce à la surexploitation de la main-d’œuvre, travaillant souvent en condition de quasi-esclavage, tant dans les cultures que dans d’autres domaines d’activités, comme les mines clandestines, nombreuses notamment au Mexique). C’est une marchandise presque idéale : n’oublions pas qu’un secrétaire d’État à l’Agriculture, sous la présidence de Vicente Fox, n’avait pas hésité à donner en exemple aux paysans mexicains les cartels de la drogue, fort habiles, argumentait-il, à s’insérer dans les marchés nationaux et internationaux…
C’est la marchandise parfaite également dans la mesure où elle attire grâce à son énorme pouvoir de séduction : elle promet plaisir, transgression, réalisation et dépassement de soi. Pour certains cercles des élites, elle est devenue un moyen indispensable pour soutenir les exigences de l’hyperactivité et de la soif de succès. C’est encore la marchandise parfaite en ce qu’elle provoque une dépendance à l’égard de la consommation, soit exactement ce que la forme actuelle du capitalisme cherche à généraliser. En bref, elle séduit par ses promesses de liberté et ce qu’elle apporte en réalité, c’est la dépendance et la destruction : c’est très précisément ce qui définit, en général, la marchandise capitaliste. La drogue est donc l’expression la plus manifeste et la plus dramatique de la soumission de la vie à la logique de la consommation : une fois créée la dépendance, commence l’enfer de vivre pour trouver l’argent nécessaire pour se procurer la dose suivante, au point d’être prêt à tout et à tout trahir, valeurs et amitiés comprises.
En résumé, se combinent dans les usages actuels des drogues les traits les plus saillants de la société de la marchandise : profits extrêmes pour quelques-uns, surexploitation brutale pour d’autres, culte de l’argent pour tous, dépendances consuméristes, destruction de la vie.
Je vais maintenant me risquer à évoquer l’État islamique (ISIS ou Daech, selon les différents noms qu’on lui donne). C’est une question difficile et j’hésitais à le faire. Car tout cela se passe fort loin d’ici et dans un contexte qu’il est impossible de démêler en quelques minutes. Mais soudain, la participation de nos camarades kurdes à ce séminaire a raccourci les distances. Il faut dire aussi qu’ici même, dans les séminaires de chaque jeudi, au Cideci-Université de la Terre, nous avons suivi, semaine après semaine, la bataille de Kobané et la résistance des combattants kurdes du Rojava face à l’État islamique, et nous avons aussi discuté les comparaisons que certains ont commencé à tracer entre la construction de l’autonomie zapatiste et le confédéralisme démocratique qui croît au Kurdistan [5].
Je ne peux pas parler de l’histoire, récente et moins récente, qui a conduit à la croissance de l’organisation dénommée État islamique, mais on ne peut pas ignorer la lourde responsabilité des puissances impérialistes européennes, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et, au cours des dernières décennies, celle des États-Unis, dont les interventions en Irak (guerres de 1991 et de 2003, occupation militaire jusqu’en 2011) ont conduit le pays à la décomposition dans laquelle il s’enfonce actuellement [6]. Contrôlant désormais la moitié de l’Irak et la moitié de la Syrie, l’État islamique a proclamé en juin 2014 le « califat » qui prétend constituer un État transnational, ayant vocation à s’installer dans toute la région, et jusqu’en Afrique et en Europe. Les exécutions par décapitation, diffusées via Internet, ne sont que la partie la plus visible de la terreur. Se multiplient, de manière moins médiatique, les massacres des populations chrétiennes et yézidies, mais aussi de musulmans, y compris sunnites, qui n’acceptent pas de se soumettre à l’autorité de l’État islamique (par exemple, en août 2014, l’exécution de sept cents personnes d’une tribu sunnite).
L’État islamique a opéré comme une force clairement contre-révolutionnaire, non seulement au Kurdistan mais aussi en Syrie, où la guerre civile a fait, depuis 2011, deux cent cinquante mille morts, huit cent mille blessés, trois millions de réfugiés et sept millions de déplacés (dans un pays qui compte seulement vingt-trois millions d’habitants). En Syrie, le printemps arabe avait déclenché une insurrection contre la dictature de Bachar el-Assad, soustrayant à son autorité la moitié du pays et formant, dans ces territoires, des comités locaux de villages et de quartiers qui ont su inventer des formes d’organisation populaire autonomes [7]. Mais cette révolution s’est heurtée à différents adversaires : non seulement la bestialité d’Assad, qui n’a pas hésité à utiliser des armes chimiques contre son peuple, mais aussi l’État islamique qui, moyennant d’autres formes de terreur, a récupéré le contrôle d’une grande partie des territoires que la révolution avait soustraits à l’État syrien.
Y aurait-il quelque parallèle à tracer entre la violence du crime organisé devenu État et l’État devenu criminel au Mexique, et celle du fondamentalisme religieux [8] fait État parallèle en Irak et en Syrie ? Il ne saurait s’agir de se livrer à de lugubres comparaisons entre des formes de cruauté extrême, mais plutôt d’analyser ces deux réalités comme autant de modes de déploiement d’ennemis systémiques. Pas antisystémiques, mais bien systémiques. Pour trois raisons au moins.
Dans les deux cas, ce qui se construit est l’ennemi parfait dont le pouvoir a besoin pour tenter de se (re)légitimer. Le Pouvoir a toujours besoin d’un Grand Ennemi terrifiant contre lequel il nous promet sa protection. Plus cet ennemi incarne la barbarie absolue, plus le Pouvoir peut prétendre avoir une raison d’être. De sorte qu’aussi bien le crime organisé que l’hyperfondamentalisme religieux, dans la mesure même où ils mettent en scène la violence extrême à laquelle ils ont recours, jouent à la perfection leur rôle de Grand Ennemi (sans pour autant qu’il soit nécessaire de penser que « quelqu’un » leur dicte le scénario qu’ils doivent suivre).
Le rôle que le Pouvoir revendique suppose de réussir à convaincre que lui et ses ennemis représentent des contraires absolus : la civilisation contre la barbarie ; l’État de droit contre l’illégalité ; autrement dit, le Bien contre le Mal. Mais, en réalité, ils sont l’expression du même. Il n’est pas nécessaire d’insister sur la fusion entre État et crime organisé que la nuit d’Iguala a rendu si manifeste. Quant à l’État islamique, il se présente comme la force qui va libérer les musulmans de la domination occidentale, de sa corruption et de son impiété. Cependant, il ressemble beaucoup à ses ennemis proclamés. C’est une entreprise prospère qui, depuis sa mainmise sur les puits de pétrole du nord de l’Irak, bénéficie de revenus de l’ordre d’un million de dollars par jour. Sa fortune globale est estimée à deux milliards de dollars, ce qui lui permet d’entretenir une armée de trente mille hommes [9]. Comme n’importe quelle firme transnationale, Daech publie chaque année, sur papier glacé, un luxueux rapport d’activités, rempli d’élégants graphiques et de statistiques. Sauf qu’ici ces batteries de ressources visuelles sont déployées (par exemple pour 2013) pour détailler 7 681 opérations militaires, parmi lesquelles sont distinguées 4 465 attentats à l’explosif, 537 à la voiture piégée, 160 opérations suicides, sans oublier 1 083 assassinats, etc. Tout cela pour démontrer la bonne santé de l’entreprise État islamique et son professionnalisme, en assumant les codes formels du succès corporatif, afin d’attirer les investissements de généreux hommes d’affaires saoudiens. Daech se présente donc comme la pureté de l’Islam face à l’Occident, mais n’est en fait qu’une expression de plus du monde de l’argent transnationalisé. Dans le même temps, loin de représenter la tyrannie de l’obscurantisme face à laquelle l’économie de marché et les démocraties occidentales ressemblent à un paradis, il est « un produit collatéral barbare de la globalisation capitaliste » (T. Konicz). Ou, peut-être, pas même « collatéral »…
Les forces dont il est question ici sont aussi des ennemis systémiques dans la mesure où elles permettent de canaliser et de neutraliser les énergies d’une jeunesse laissée à l’abandon par le capitalisme néolibéral. C’est le cas du crime organisé, au Mexique et ailleurs, qui utilise ces jeunes comme chair à canon, comme esclaves parfois et aussi comme consommateurs, contribuant aussi à l’essor massif du phénomène des « juvenicides ». C’est le cas de l’État islamique qui, comme d’autres organisations, recrute des djihadistes dans tous les pays arabes, ainsi qu’en Europe, où il attire quelques centaines de jeunes issus de l’immigration (mais aussi quelques convertis de fraîche date à l’islam) qui ne se sentent nullement intégrés, ni par un travail auquel ils n’ont pas accès ni par un mythe républicain plus qu’agonisant. Il est affligeant de voir ces vidéos diffusées par Internet dans lesquels ces jeunes gens, entraînés dans la logique du djihad, menacent les infidèles (et, pour eux, ce terme vise aussi les musulmans qui ne se rallient pas à leurs thèses et ne se réjouissent pas de la mort des chrétiens) : « Tuez-les, égorgez-les. Brûlez leurs voitures, brûlez leurs maisons. Le Califat va s’installer dans toute l’Europe. » Telle est la voie qu’ils adoptent pour tenter de sortir du non-sens d’une survie misérable dans un monde où il n’y a nulle place pour eux, un monde qui les exclut et les méprise. Ce qui est pathétique, c’est que l’impulsion par laquelle ils cherchent à échapper à la négation de leur existence les jette sur un chemin qui n’est pas moins dépourvu de sens, déshumanisant et criminel. À la destruction systémique, ils répondent par une destruction qui en est le reflet et, qui plus est, lui sert à se maintenir. Le plus désolant est de constater qu’ils trouvent, dans cette cause-là, une raison de donner leur vie, ce qu’ils font effectivement, vivant leur geste comme un sacrifice rédempteur, un accès à un semblant d’existence, dans et par la mort.
C’est en cela aussi que le crime organisé et le fondamentalisme religieux dans ses formes les plus extrêmes sont, l’un comme l’autre, des ennemis systémiques. Ils contribuent à faire en sorte que les sources d’une colère légitime, accumulée dans le monde de la destruction qu’est le capitalisme, soient déviées vers des fins systémiques, au lieu de venir fortifier les processus antisystémiques.
Comment parviendrons-nous à combattre l’hydre dans la mesure où ces têtes encore plus terribles [10], qui sont déjà particulièrement menaçantes dans certaines parties du globe comme le Mexique et le Moyen-Orient, se feront de plus en plus grandes ? Il faut revenir à l’hydre elle-même pour avancer dans l’analyse du problème.
Les hydres aussi pleurent…
Il s’agit de déterminer si, en dépit de sa force chaque fois plus destructrice, le monstre ne souffre pas de maladies, visibles ou invisibles, comme celles que d’anciens, ou moins anciens, docteurs, spécialisés en hydropathologie, diagnostiquent comme « contradictions internes » ou « limites » et qui font souffrir l’hydre, peuvent la paralyser et peut-être même provoquer sa mort — mais sur ce dernier point, les avis des savants divergent. Je crois qu’on peut comprendre ce séminaire, qui commence tout juste, comme une invitation à rouvrir, entre nous et avec d’autres, le débat sur la crise, afin d’actualiser, d’affiner et d’approfondir nos analyses, en incluant l’histoire clinique qui a conduit le patient à son état actuel [11].
On pourrait dire, de manière synthétique, que le capitalisme dispose actuellement de trois centres vitaux. Le premier est l’exploitation du travail, qui produit de la valeur à travers la production de biens matériels et de services marchandisés. Le second est l’accumulation par dépossession [12] qui, pour pouvoir exploiter ce qu’on appelle des ressources naturelles, multiplie les attaques contre les territoires, ce qui provoque des résistances croissantes, tant au Mexique (où les peuples indiens sont particulièrement affectés, notamment par l’avancée sans cesse plus agressive des activités minières) qu’en Europe, qu’il s’agisse des ZAD en France ou de la lutte No TAV en Italie — luttes qui s’opposent à des projets d’infrastructures, énergétiques ou touristiques, non seulement inutiles mais aussi et surtout destructeurs et illégitimes.
J’évoquerai surtout le troisième centre vital, celui du capital financier, dont on sait qu’il s’est développé au cours des dernières décennies de manière inédite, au point que les deux autres centres lui sont désormais subordonnés. De fait, il est important de souligner qu’au-delà de la reconfiguration du rôle de l’État (qui combine affaiblissement dans certains domaines et capacité d’action plus décidée dans d’autres), le néolibéralisme a au moins deux caractéristiques fondamentales. La première est la création effective d’un marché mondial, qui instaure de nouvelles conditions de compétition pour les capitalistes eux-mêmes et pour les travailleurs, avec des conséquences désastreuses pour les salaires et les conditions de travail et de vie. La seconde est la mise en place méthodique — et pour bien des aspects, depuis l’État lui-même — des conditions d’une expansion inédite du capital financier, c’est-à-dire de marchandises qui ne sont rien d’autre que des titres de propriété ou des titres de dette [13]. Ce n’est pas le lieu de décrire les invraisemblables mécanismes qui permettent d’amplifier et de soutenir les profits résultant de l’essor du capital fictif. L’un des plus élémentaires et des plus massifs est l’augmentation spectaculaire des dettes des États qui, en trois décennies, sont passées d’une moyenne de l’ordre de vingt pour cent du PIB aux environs de quatre-vingt-dix à cent pour cent de celui-ci, sans parler des cas qui excèdent largement ce taux, non seulement en Grèce mais aussi, notamment, au Japon (deux cent vingt pour cent). Un premier effet de cette situation est de transformer en rente pour les détenteurs du capital une part croissante des budgets publics. Par ailleurs, la conséquence évidente est une dépendance étroite des États vis-à-vis des marchés financiers (d’où, entre autres, le rôle nouveau des agences de notation, qui permet que la moindre des décisions prises par un État, si elle est jugée négativement, peut provoquer une augmentation immédiate des taux d’intérêt et, ainsi, contribuer à étrangler un peu plus encore le pays concerné). Il y a là un puissant mécanisme de domestication, qui tend à rendre impossible toute tentative sérieuse de s’écarter de l’orthodoxie néolibérale.
Pourquoi une expansion aussi disproportionnée du capital financier a-t-elle eu lieu ? Il serait tout à fait insuffisant de considérer que cela n’est dû qu’à l’avarice sans limite et à la frénésie spéculative de quelques banquiers et autres acteurs opérant sur les marchés. Présenter les choses ainsi conduit certains à penser qu’il serait possible de revenir à un capitalisme productif, plus sain, voire de mettre un frein, depuis le pouvoir d’État, à la voracité perverse de la finance. Nombreux sont ceux qui déterminent leur stratégie politique sur cette base. C’est donc un enjeu d’extrême importance que de souligner que l’essor du capital fictif a des raisons plus profondes.
La première est que l’économie capitaliste a un besoin impérieux de croissance. L’hydre est terriblement vorace et ne peut contenir son appétit. La taille de l’économie mondiale a été multipliée par dix au cours du dernier demi-siècle et cette expansion implique une quantité sans cesse croissante de capitaux en quête d’investissement. Bien qu’elle augmente, la production de biens et de services est insuffisante pour absorber des masses d’argent aussi phénoménales. C’est l’une des raisons pour lesquelles le secteur financier s’est développé comme un nouveau champ d’investissement, un indispensable Eldorado pour l’argent en quête de toujours plus d’argent.
Mais cela implique un sérieux problème car la croissance dans le capitalisme n’est pas linéaire mais exponentielle. Pour vivre, l’hydre a besoin de dévorer et de dévorer encore, de croître et de croître sans cesse davantage. Son corps monstrueux est en train de couvrir la totalité de la terre. Ainsi, elle nous étouffe, mais il se peut qu’elle en arrive à s’étouffer elle-même, trouvant de moins en moins aisément de nouveaux terrains à dévaster, de nouveaux horizons vers lesquels croître. Si l’on doit sans doute se méfier — en dépit même de son efficacité — de l’argument selon lequel un système fondé sur une croissance exponentielle dans un monde limité serait, pour cette seule raison, condamné à la mort, on peut prendre en compte le fait que l’une des difficultés les plus sérieuses qui affectent l’hydre est un problème de taille, un problème d’échelle, un problème d’excès.
Par ailleurs, les profits dans le secteur de la production tendent à se réduire. Du fait des innovations technologiques et de l’automatisation de la production, le travail nécessaire pour produire une marchandise se réduit sans cesse, de sorte que la valeur produite diminue, malgré le fait que la production augmente en quantité. De plus, une compétition mondiale féroce réduit toujours plus les marges des entreprises. Les rythmes d’innovation sont sans cesse plus rapides et les cycles de profit plus courts. Et c’est parce que les bénéfices tirés de la production de biens et de services sont tendanciellement insuffisants que d’immenses masses de capitaux n’ont pas d’autre option que de s’orienter vers le secteur financier [14].
Une autre raison encore tient à la contradiction, avivée par les politiques néolibérales, entre un régime de bas salaires et la nécessité de vendre des marchandises en quantité toujours plus abondante. Une solution temporaire a pu être trouvée grâce à l’expansion du crédit, ce qui a également l’avantage d’enclencher un redoutable mécanisme de soumission aux normes capitalistes, sous l’espèce d’un cycle infernal consommation-endettement-travail dans lequel se laissent prendre de plus en plus de familles des classes moyennes et populaires [15]. Mais, pour sophistiqués qu’ils soient, les échafaudages du crédit demeurent fragiles. Ce sont eux, précisément, qui ont commencé à se rompre durant la crise de 2008-2009, dont les États-Unis ont été l’épicentre et dont l’ampleur était restée inconnue depuis celle de 1929-1933. Sa propagation a néanmoins pu être jugulée par l’intervention rapide des principaux États, moyennant des plans de sauvegarde des banques et des grandes entreprises ayant atteint plusieurs centaines de milliards de dollars dans chaque pays. Cette réaction a été efficace, mais la crise n’a pris fin qu’en apparence. Non seulement rien n’a été fait, ou presque, pour remédier aux causes fondamentales de la crise (notamment pour réintroduire des formes de régulation des flux financiers), mais au contraire, les mesures prises n’ont fait qu’amplifier ces causes, en premier lieu en élevant encore le niveau d’endettement des États. En outre, de nouveaux fronts ont dû être ouverts pour soutenir l’expansion du capital fictif, en particulier à travers le rachat massif de dettes souveraines et de titres toxiques par les banques centrales, ce qui tend à affaiblir significativement les instances qui régissent le système de l’argent. Préserver la confiance dans le système financier est une tâche de plus en plus difficile et si les bons du Trésor états-uniens continuent de trouver des acquéreurs ce n’est pas tant parce qu’ils suscitent la confiance qu’en raison de l’obligation dans laquelle se trouvent ceux qui en détiennent (en premier lieu la Banque centrale chinoise) d’éviter leur brutale dévalorisation. Mais, jusqu’à quand ?
L’étape suivante de l’implosion du système financier peut se produire à tout moment. En 2008-2009, les États ont réussi à déployer des mesures efficaces, mais il s’agissait d’une arme à un seul tir, qui ne peut se répéter, dans la mesure où les déséquilibres structurels sont désormais plus sévères encore et mettent en danger la solvabilité des États eux-mêmes. Le scénario d’une extension de la crise du secteur financier vers le secteur productif, qui a été sur le point de se produire en 2008-2009, serait désormais difficile à éviter et les effets en chaîne pourraient atteindre des proportions imprévisibles. Il y aura certainement des tentatives de la part des États et des institutions internationales pour s’opposer à ces tendances et il est possible qu’ils y parviennent en partie, de sorte qu’il faut moins imaginer un effondrement se produisant d’un coup et partout à la fois qu’une série d’affaissements partiels et successifs.
Un point encore : les trois centres vitaux du capitalisme — l’exploitation du travail, l’accumulation par dépossession et l’expansion du capital financier — ont chacun leurs maladies spécifiques. Chacune peut, en elle-même, être curable, mais, dans la mesure où elles se combinent, les difficultés peuvent devenir considérables, à plus forte raison si on prend en compte la dévastation écologique et les effets du réchauffement climatique qui constitueront une dimension de plus en plus déterminante de l’état de fait, au cours des prochaines décennies. Toutefois, si le diagnostic des trois centres vitaux déjà mentionnés indique des problèmes aigus, il existe un quatrième centre vital qui, pour sa part, jouit d’une parfaite santé. C’est celui du capitalisme criminel-criminel, qui autorise des taux de profit remarquables et ne semble pas rencontrer d’autre limite que celle de la destruction totale de la vie.
Dès lors, il n’est pas exclu de se retrouver face au scénario suivant. Trois processus fondamentaux pourraient caractériser une possible transition systémique. D’un côté, iraient s’accentuant les difficultés que le capitalisme rencontre dans sa reproduction, provoquant le blocage progressif de pans entiers du système financier et productif. De l’autre, les options de vie autonomes dont il sera question dans la partie suivante parviendrait à se développer dans des espaces libérés, ou abandonnés à leur sort par la décomposition systémique. Non sans en passer par des phases d’intensification de la conflictualité, ce second processus pourrait tirer parti du premier, tout en participant à son accélération. Mais, en même temps, la situation pourrait être mise à profit par les forces du capitalisme criminel-criminel, sur la base de formes de violence extrême et de relations de production néo-esclavagistes. Les groupes du crime organisé, comme le fascisme ouvert ou déguisé sous des allures religieuses, sont suffisamment armés pour étendre leur contrôle territorial à travers la terreur et pour s’emparer des ressources naturelles et des moyens de production, ainsi qu’ils ont commencé à le faire. Alors, l’affrontement serait entre eux, si bien entraînés à une cruauté sans limite, et nous qui, pour une bonne part, sommes si désorganisés et si enclins aux bons sentiments…
La perspective n’a rien de rassurant, mais elle n’est pas non plus désespérée. Est-il tout à fait impossible de l’emporter sur les forces du capital criminel-criminel ? Non. Des exemples démontrent que l’organisation collective des peuples peut parvenir à leur résister, voire à leur disputer des espaces. C’est, au Mexique, le cas de la police communautaire du Guerrero, comme celui de la commune autonome de Cherán (Michoacán). C’est le cas de la lutte du peuple kurde contre l’État islamique, notamment avec la résistance victorieuse de la ville de Kobané.
C’est peut-être pourquoi le Mexique et le Kurdistan sont deux exemples particulièrement significatifs pour comprendre la tempête qui s’approche. Mais aussi pour comprendre les options et les espoirs qui sont nôtres.
Nos options face à l’hydre
Face à l’hydre capitaliste, nous ne pouvons pas nous contenter de penser comment nous débarrasser d’elle. Il est également indispensable de nous préoccuper de ce que nous voulons construire. Outre les NON de ce que nous rejetons, sont tout aussi importants les OUI des mondes auxquels nous voulons donner consistance, ainsi que l’a souligné l’EZLN au moment d’annoncer, dans les premiers mois de 2013, une nouvelle étape de sa lutte [16]. De fait, on ne saurait perdre de vue le lien entre ces deux versants de la lutte, car si les menaces présentes et à venir obligent à concentrer l’attention sur l’hydre elle-même et les NON qu’on lui oppose et qui permette de résister à ses avancées, les OUI font partie de ce qui donne sens, cœur et énergie à la lutte contre le monstre.
Dans cette perspective affirmative, et encore trop peu visible selon certains, il nous faut faire valoir que nous avons une option propre, qui est résolument anticapitaliste et ne se centre pas sur l’État, c’est-à-dire une option qui lutte pour construire un monde libéré de la barbarie capitaliste, de la dépossession provoquée par l’État, des relations patriarcales et de toute autre forme de domination. Nous avons déjà commencé à récupérer et à donner forme à un imaginaire alternatif, et sans doute vaudrait-il la peine d’œuvrer à le faire savoir davantage. On peut suggérer au moins quatre caractéristiques de cet imaginaire alternatif : a) il est réel, et ses prémices peuvent être éprouvées notamment dans les territoires rebelles zapatistes, même s’il est important, comme l’a souligné ici même le sous-commandant Moisés, de ne pas idéaliser la lutte zapatiste ; b) cet imaginaire est suffisamment différent, dans ses principes, des expériences qui, durant le vingtième siècle, ont conduit les désirs de libération vers de nouvelles formes d’oppression, pour qu’on puisse récuser de manière argumentée la prétention à faire mourir tout projet d’émancipation en 1989 ; c) cet imaginaire alternatif entre en résonance avec d’autres expériences historiques révolutionnaires, comme la Commune de Paris, les conseils ouvriers et paysans en Russie et dans d’autres pays européens, la révolution en Catalogne et Aragon, en 1936-1937, de sorte qu’il revitalise des traditions présentes sur plusieurs continents ; d) cette option est hautement désirable.
Cet imaginaire alternatif qui émerge des pratiques collectives peut se décliner de diverses manières. Je choisirai d’insister brièvement sur trois dimensions [17]. La première est l’autonomie comme principe politique, c’est-à-dire l’invention permanente de formes non étatiques d’organisation politique, dont l’enjeu est d’éviter la reproduction d’une dissociation entre gouvernants et gouvernés. Mais encore faut-il préciser qu’une telle logique d’autogouvernement ne vise pas à gérer par nous-mêmes la réalité systémique produite par l’hydre mais n’a de sens que si elle a pour objet d’organiser les formes de vie qui sont les nôtres, celles que les collectifs d’habitants adoptent hors des impositions du monde de la marchandise. En second lieu, l’élimination de la logique capitaliste implique de nous libérer du productivisme compulsif auquel la nécessité de la valorisation du capital soumet actuellement la planète. Cela implique, de manière plus générale, de nous libérer de l’Économie, c’est-à-dire de la centralité que l’Économie a acquise avec le capitalisme (ce qui fait de ce dernier une aberrante anomalie historique). Il s’agit ici de réintégrer les activités productives dans le tissu de la vie sociale, de les subordonner à la construction du bien vivre pour toutes et tous, dans le respect de la Terre Mère et, concrètement, de les soumettre à des décisions élaborées et assumées collectivement. En troisième lieu, dans la mesure où l’autonomie ne peut se construire qu’à partir de la singularité des lieux, des territoires, des cultures, des expériences et des mémoires, elle donne naissance nécessairement à une multiplicité de mondes, à « un monde où il y ait place pour de nombreux mondes ». Cela implique d’être capable de construire collectivement dans la pleine reconnaissance des différences qui constituent cette multiplicité. Ce principe s’avère vital et implique une autre manière de faire, tant au niveau de l’organisation politique, qui peut être conçue comme une coordination ou une confédération d’entités locales autonomes, qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Dans tous les cas, la reconnaissance effective des différences est importante non seulement quand il s’agit de différences modestes, qui nous affectent peu, mais surtout quand il s’agit de différences véritables, c’est-à-dire véritablement différentes, qui peuvent provoquer en nous de l’irritation ou de l’incompréhension.
L’option que nous pouvons choisir de défendre part de la conclusion qu’il est (devenu) vain de tenter de subvertir le capitalisme à partir de ses propres institutions et que les stratégies « graduelles », pour réalistes qu’elles puissent paraître, finissent par épuiser les énergies à des fins qui, en réalité, contribuent à assurer un peu de légitimité au système actuel et, quand bien même il serait possible d’admettre qu’elles obtiennent, dans quelques cas exceptionnels, quelques améliorations au bénéfice de la population, en aucun cas celles-ci ne sont à la hauteur des enjeux du moment historique ni ne nous rapproche d’un iota d’une sortie du désastre capitaliste. C’est pourquoi notre option consiste à construire, ici et maintenant, ce que nous pouvons considérer comme nôtre, ce qui, aussi petit, limité et imparfait soit-il, peut être reconnu comme véritablement nôtre [18]. On peut nommer cela brèche, territoires autonomes, espaces libérés, zone à défendre, commune ou comme on voudra. Il s’agit de récupérer ou de créer des espaces, territorialisés ou non, matériels, relationnels et intérieurs, depuis les plus modestes jusqu’aux plus amples. Notre option stratégique consiste à faire tout notre possible, à engager toute notre énergie pour que ces espaces, ces brèches dans le mode d’existence imposé par la domination capitaliste ne se referment pas et, au contraire, s’étendent, se multiplient, se rencontrent, échangent et s’épaulent dans la lutte contre l’ennemi commun.
Ces espaces ne peuvent pas être considérés comme des îles protégées au milieu du désastre généralisé. Ce sont bien plutôt des espaces antagoniques, attaqués de mille manières afin d’être réabsorbés par l’hydre capitaliste. C’est l’une de ces attaques, que les zapatistes ne cessent d’affronter depuis plus de vingt ans, qui a couté la vie au maestro Galeano, le 2 mai 2014, à La Realidad. Les zapatistes ne cessent de nous expliquer qu’il n’est pas possible de séparer la résistance (pour eux, la construction d’une autre réalité) et la rébellion (l’opposition aux diktats du capitalisme), qu’il est de leur responsabilité de se défendre et de résister aux provocations (agressions violentes de la part d’organisations hostiles et de groupes paramilitaires), en même temps que la construction de l’autonomie continue de se fortifier. Mais les espaces libérés sont antagoniques également parce qu’ils ne peuvent continuer à exister et à croître sans chercher comment avancer dans le combat contre l’hydre. De telle sorte que l’option consiste à construire ce qui est nôtre, c’est-à-dire les mille manières de concevoir nos mondes, et, à partir de là, continuer à attaquer l’hydre, puisque l’objectif n’est autre, comme le sous-commandant Galeano l’a rappelé dans la convocation à ce séminaire, que de « détruire le système capitaliste ».
La dimension des espaces libérés qu’il est possible de déployer dépend de la force collective que nous sommes capables de construire. Il n’est pas inutile de rappeler que la brèche zapatiste n’a pu être ouverte que sur la base d’un soulèvement armé et, donc, de l’effort d’organisation préalable que cela a supposé durant une décennie et davantage encore (même si le sous-commandant Moisés a souligné que, désormais, cette brèche ne peut continuer à croître que sur la base d’une forme de résistance qui implique de ne pas répondre de manière armée aux agressions, pour brutales qu’elles puissent être). Dans d’autres contextes, il semble que notre option consiste à multiplier les collectifs de tous types, les organisations de communautés, de villages, de communes, de régions, en même temps que les convergences pour empêcher de nouvelles matérialisations spécifiques de la marchandisation du monde. C’est indispensable, et il est certainement nécessaire de maintenir et d’approfondir les efforts en ce sens ; mais peut-être les collectifs engagés dans de telles démarches commencent-ils à éprouver qu’ils sont en partie insuffisants. Peut-être la lutte contre l’hydre implique-t-elle de prendre la mesure du monstre dans sa globalité, de cerner la diversité des têtes qui concourent à la domination capitaliste. Peut-être est-il nécessaire d’envisager la possibilité de concerter des actions simultanées, en de multiples endroits à la fois. Cela n’implique en rien une organisation unique et centralisée, ni non plus qu’une action simultanée doive être pensée depuis un seul lieu. Cela implique bien plutôt de construire patiemment les conditions d’une connaissance mutuelle afin de favoriser, le moment venu, l’extension de processus dans lesquels puissent émerger et prévaloir, au milieu de multiples difficultés, un vocabulaire en partie partagé, un sens de la fraternité et de la confiance, une capacité à faire ensemble.
Quand, au milieu de la tourmente qui vient, des mouvements de lutte et des soulèvements de plus en plus nombreux éclateront, nous partagerons tous la responsabilité collective de ne pas laisser passer cette opportunité, de faire en sorte que nous ne soyons pas vaincus par nos ennemis les plus visibles, mais pas davantage par nous-mêmes, soit parce que nous serions incapables de surmonter nos tendances à la division, soit parce que nous laisserions l’impulsion transformatrice être déviée vers des objectifs secondaires ou vers la reproduction des formes de domination dont il s’agit de se libérer. Nous préparer dans cette perspective n’est pas une tâche aisée ; et c’est peut-être à cela aussi que nous invite l’avis de tempête que nous transmettent les zapatistes. Ce qui vient sera probablement la dernière opportunité historique pour libérer la planète Terre de la barbarie et de la destruction.
*
Pour terminer, je vais me risquer à évoquer la Sexta, comme projet de maillage planétaire des résistances et des rébellions (laquelle, bien entendu, ne prétend nullement être le seul projet de ce type). Si elle remonte à la Sixième Déclaration de la forêt Lacandone, la Sexta a commencé à être nommée de cette manière dans les communiqués du début de l’année 2013, qui ont esquissé les traits de sa nouvelle modalité [19]. La Sexta existe parce qu’existent les organisations, collectifs et individus qui la conformons. Elle existe à travers les initiatives que ceux-ci assument au Mexique et dans d’autres parties du monde, principalement sur le continent américain et en Europe. Par exemple, c’est principalement à la Sexta que s’adresse l’initiative du présent séminaire.
Ma sensation toute personnelle est que, peut-être, la Sexta a réellement commencé à exister ce 2 mai, à Oventic, lorsque Mariano, l’un des enfants du maestro Galeano nous a expliqué que son père lui avait laissé trois familles : sa famille de sang, l’EZLN et… la Sexta. De sorte que la question est : comment ferons-nous, et que ferons-nous, pour correspondre un tant soit peu aux espérances du maestro Galeano ? Peut-être est-ce le moment de commencer à faire exister la Sexta au-delà de ce qu’elle est jusqu’à présent (nous ne savons qu’une chose à ce sujet, qu’il s’agit de cheminer en questionnant). Il pourrait être pertinent de rendre plus visible notre option et de poursuivre la construction de notre force planétaire, la seule qui, à partir de ses milliers d’inscriptions locales particulières, pourra vaincre l’hydre. Il s’agit de continuer à nous rencontrer, à nous connaître, à échanger et à inventer des techniques de chasse contre le monstre (et n’oublions pas : cautériser après avoir coupé).
J’avais une autre fin (avec même des citations bibliographiques), mais je préfère terminer par ces mots : Mariano, puissions-nous un jour être dignes, en tant que Sexta, de ce que tu nous as dit, le 2 mai, à Oventic.
Jérôme Baschet













































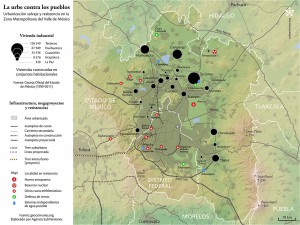








 17:14
17:14 51:05
51:05 





















